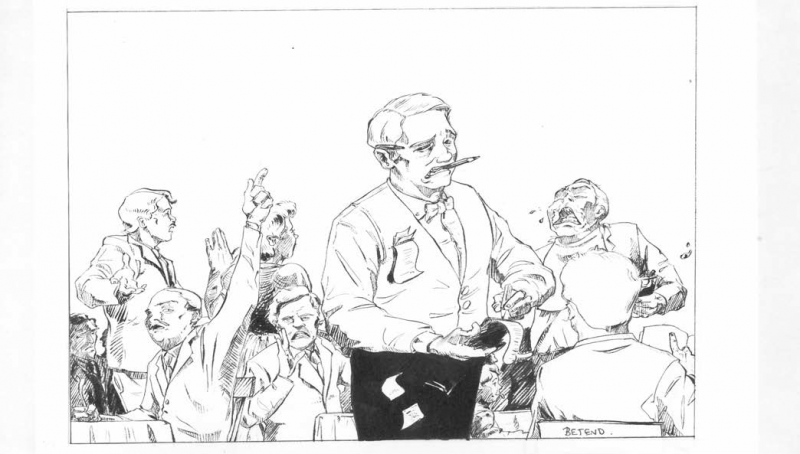Comme tous les vieux radoteurs, la première phrase qui m’est venue, c’est « dix ans déjà »… Ou, pour reprendre les termes d’un vieux camarade à propos de tout autre chose : « si proche et déjà d’une autre histoire ». Je suppose qu’en me demandant un texte pour ponctuer les dix ans de Canal Psy, l’équipe actuelle s’adressait à un dépositaire présumé de la mémoire : ce qui est n’est guère fondé quant aux cinq dernières années, pour lesquelles je ne suis pas plus qualifié que n’importe quel autre lecteur, mais, il est vrai, beaucoup plus quant à la préhistoire et la protohistoire de la publication, que j’ai en effet suivies d’assez près, après en avoir été l’initiateur.
Préhistoire
En fait, si l’on y inclut les deux tentatives qui ont précédé, sous les titres de Pratiques sociales à l’université et de La Gazette de la FPP, on est plus proche des vingt ans que des dix, puisque la première remonte à 1984. Il s’agissait – déjà – de créer un outil commun à deux espaces de formation en direction des praticiens demandeurs d’un parcours universitaire, et qui étaient alors gérés par la même composante de l’université : le Diplôme Universitaire des Pratiques Sociales (DUPS), qui remonte lui-même à 1975, – et la FPP, fondée quatre ans plus tard.
L’idée était encore modeste – rassembler sous l’auvent d’un « journal » les documents d’information de toute sorte qui faisaient l’objet d’un courrier relativement important entre les étudiants et l’université. Mais à l’arrière-plan de cette démarche pragmatique, l’enjeu était de marquer fortement l’unité des démarches et des publics concernés, au-delà des visées différentes des diplômes. Le titre n’était pas anodin : transposé d’une publication impulsée par Jean Laplanche – Psychanalyse à l’université – il reflétait ce qui était alors mon souci majeur : tenter de greffer un espace d’élaboration des pratiques sociales en tant que telles à l’intérieur de l’institution universitaire.
Je passe sur les avatars institutionnels qui ont abouti au découplage des deux diplômes, le DUPS se retrouvant géré par l’Institut des Sciences et Pratiques d’Éducation et de Formation et FPP par l’Institut de Psychologie. Le champ du journal se retrouvait de facto réduit à la FPP, si bien que lorsque Jean-Marie Charron1 accepte d’en prendre la responsabilité, il ne fait que prendre acte d’une réalité déjà bien installée en le baptisant La Gazette de la FPP – d’autant qu’auparavant déjà, quelques étudiants réunis autour de Michèle Thévenin, première secrétaire de la FPP, avaient entrepris d’élargir un contenu éditorial quelque peu aride, dans l’ambition d’en faire véritablement l’organe de la « communauté FPP ».
Si cette dernière initiative avait tourné un peu court, faute de structuration sérieuse de l’équipe bénévole qui l’avait lancée, elle est reprise méthodiquement autour de Jean-Marie Charron. Aux « messages » envoyés aux étudiants par l’encadrement de la FPP s’ajoutent notes de lecture, témoignages divers, dessins humoristiques, tribunes libres… In petto, je l’appelais affectueusement « notre bulletin paroissial ». Tout en me réjouissant, depuis mes vieilles utopies autogestionnaires, de l’appropriation dont la gazette était l’objet de la part des étudiants, je gardais la nostalgie d’une ambition plus large, contribuant plus à ouvrir cette communauté sur l’extérieur, et ajoutant à la fonction de soutien – essentielle quand on sait la solitude profonde des étudiants engagés dans la vie professionnelle dans les intervalles entre les regroupements – une fonction plus directement formatrice. J’avais en outre pu remarquer chez les étudiants une corrélation entre l’envie d’investir l’animation de la vie collective et l’évitement discret de l’épreuve du dossier et des jurys, ce qui induisait quelque scrupule à les y encourager.
Cette dernière remarque n’est pas anecdotique : elle s’inscrit dans une contradiction fondatrice entre la certitude qu’aucun processus de formation n’est effectif s’il n’est totalement approprié par les personnes en formation, et la certitude non moins forte que dans les conditions rigoureuses des reprises d’études en milieu de vie, rien n’est possible sans un important investissement par l’institution de ses fonctions de « holding ». Marie-France Corteval, qui succéda à Michèle Thévenin et précéda Marie-Thérèse Carteron, me disait souvent « Vous les couvez trop ». Et je lui répondais qu’« ils » avaient déjà bien assez à faire en ajoutant à leur vie professionnelle et familiale un gigantesque et douloureux travail de lecture, d’écriture, d’élaboration, pour qu’on ne charge pas encore plus la barque. Tout en étant conscient d’aller en cela à l’encontre de la tradition universitaire, qui est, s’adressant à des publics juvéniles en train de sortir du cocon familial et scolaire, de les soumettre énergiquement à l’épreuve salutaire du « débrouille-toi mon grand ».
Protohistoire
C’est dans ce contexte qu’au début des années 90 s’ouvre l’opportunité de répéter ce qui avait déjà été tenté avec le DUPS : développer à l’intention de ce public de praticiens en demande de formation universitaire un ensemble cohérent de dispositifs d’inspiration commune, mais d’architecture différente, en fonction des besoins divers de la population ainsi définie. Mais entre-temps, l’organisateur symbolique s’était déplacé. Prenant acte de l’impasse à laquelle avait abouti l’invocation du signifiant « pratiques sociales » comme centre de gravité du dispositif, je m’étais résolu à lui substituer clairement le signifiant « psychologie » – acceptant enfin d’admettre qu’elle et la sociologie s’étaient historiquement imposées comme discours d’appui savants des pratiques sociales, et qu’il était vain de vouloir en bâtir artificiellement d’autres. On aura compris que de Pratiques sociales à l’université à Canal Psy, le glissement sémantique ne doit rien au hasard.
La naissance de la publication s’inscrit donc dans le mouvement d’ensemble qui fit surgir successivement la cellule de Formation Continue de Psychologie, le CFP (préfiguré en 1992-1993 par un dispositif de transition plus léger, dit, d’ailleurs assez improprement, « Enseignement à Distance »), le département FSP (comme cadre institutionnel de l’ensemble), et enfin le DURePP.
Le changement déterminant fut l’embauche, début 93, de deux salariés à temps partiel, respectivement pour la rédaction et la fabrication. Cette embauche était adossée à un « cahier des charges », qui définissait ainsi les objectifs :
« Prioritairement, créer un lien entre l’Institut de Psychologie et les étudiants, notamment engagés dans la vie professionnelle, à qui leurs contraintes de temps et d’espace interdisent le contact constant avec l’Institution universitaire, et contribuer à pallier les handicaps que cette situation impose à leur formation. Subsidiairement, faciliter la communication entre l’Institut et les milieux professionnels qui peuvent être intéressés à son activité. »
La même dualité (et la même hiérarchie) se retrouvait dans la définition du public : l’abonnement était, et est toujours, compris dans l’inscription pour les étudiants FPP et EAD (puis CFP), et proposé d’autre part aux autres étudiants, ainsi qu’« à tous ceux que l’activité de l’Institut de Psychologie intéresse : organismes professionnels et de formation, autres départements universitaires de psychologie, anciens étudiants, praticiens, etc. » Dans le même esprit, l’éditorial du premier numéro définit Canal Psy par l’ambition d’un « lien mensuel entre tous ceux qui, sous l’invocation de la psychologie, sont rattachés à la Communauté Universitaire par une inscription (à tous les sens du terme, surtout l’autre…), tandis que la force des choses et d’abord les contraintes du temps et de l’espace, les tient à l’écart de l’espace concret où cette communauté s’incarne ».
De nouveau, il s’agissait à la fois de franchir un cran dans le niveau qualitatif, en profitant des économies d’échelle autorisées par l’extension du dispositif, mais aussi et surtout de désenclaver un « village gaulois » en multipliant ses liens avec l’extérieur.
Le choix de Sabine Gigandon-Valette pour gérer l’aspect rédactionnel s’avéra pertinent au-delà de toute espérance, comme d’ailleurs, un peu plus tard après un essai malheureux, celui de Gaëlle Chevrier pour la fabrication et la distribution. Tout en mettant leur point d’honneur à respecter scrupuleusement le cahier des charges, elles déployèrent une énergie et une créativité sidérante pour transformer un simple bulletin intérieur en une vraie publication de standard professionnel. Le Canal Psy d’aujourd’hui reste profondément marqué par leur œuvre commune.
Les contradictions des six premières années
La transition fut un peu difficile au sein de la FPP. Pendant six mois d’ailleurs, la Gazette subsista parallèlement : mais personne ne s’y trompa, le nouveau venu menaçait le premier né, et suscita des débats entre les nostalgiques de « leur » journal et ceux qui accueillaient la nouveauté avec confiance. Une tribune libre d’une étudiante dans l’avant-dernier numéro de la gazette, intitulée « La dépossession ?… Oui mais alors l’appartenance aussi » reflète assez exactement cette ambivalence.
Certes, le compromis finalement trouvé – joindre en annexe au journal tel que le recevaient les abonnés « extérieurs » un supplément propre respectivement à la FPP et au CFP, paraissait formellement faire leur juste part aux enjeux antagonistes. Mais il faut bien dire que quelque chose s’était rompu, et cela éclate aux yeux quand on relit la collection. Les contributions des étudiants se raréfient jusqu’à disparaître complètement au bout de deux ans – si l’on excepte celle de décembre 1997, qui est en fait une lettre adressée par une étudiante sortante à Albert Ciccone, et publiée à l’initiative de celui-ci. Au cours de ces premières années aussi, une enquête sur les attentes des lecteurs, quelques appels à contributions témoignent que l’équipe du journal conserve le souci d’une certaine interactivité. Puis plus rien : le journal est devenu sans partage un objet adressé aux étudiants.
Mais d’autres contradictions étaient en puissance dans l’ampleur du « cahier des charges » initial : fournir des ressources pour aider le travail des étudiants, faire lien à l’intérieur du Département, faire lien avec l’Institut de Psychologie, faire lien avec les lieux de pratique extérieurs, et produire un périodique de qualité professionnelle. En outre, dès le départ, d’autres enjeux encore vinrent s’ajouter. D’abord, l’équipe avait été recrutée dans le seul vivier possible pour des emplois à temps partiel, exigeant un haut niveau de qualification en psychologie et un fort investissement : parmi les étudiants avancés ou les jeunes professionnels issus du régime général – et, à l’exception de Monique Charles de 1997 à 2000, il en a toujours été ainsi. On conçoit qu’inévitablement elles aient importé dans l’entreprise la sous-culture de leur terreau d’origine et les enjeux qui y étaient liés. Dès la rentrée 93, par exemple, une vente au numéro était lancée dans les locaux de Bron. D’autre part, et un peu dans le même sens, le lancement de la publication eut beaucoup de succès parmi les enseignants titulaires de l’Institut de Psychologie, et la pression pour faire de Canal Psy une sorte de bulletin intérieur de l’Institut n’a pas été négligeable.
L’ambition de tenir tout à la fois était séduisante sur le papier, mais elle supposait des vertus d’équilibriste, une attention de tous les instants… et une aisance matérielle qui aurait dispensé de faire trop de choix : car d’une part chaque fonction assignée prenait beaucoup de temps, et d’autre part tout tenir serait revenu à faire grossir le journal : ce qui aurait demandé plus d’argent. Or déjà le budget initial pesait lourdement dans le budget du département, et il n’était pas question d’augmenter encore la contribution des étudiants (je me demandais souvent à voix haute si ce journal n’était pas « ma danseuse », même si les retours dans les groupes d’étudiants témoignaient abondamment de sa réelle utilité dans le processus de formation), et la croissance très appréciable des abonnements « libres » (non compris dans des frais d’inscription) ne parvenait pas à atteindre un niveau suffisant. Il fallait tout faire tenir sur seize pages et deux mi-temps. Non seulement on ne pouvait grossir : il fallut même réduire ; et ce fut la périodicité qui servit de variable d’équilibre : Canal Psy devait comporter au départ dix numéros dans l’année, il passa rapidement à six et il en est aujourd’hui à cinq, voire quatre.
Dans ce contexte il était inévitable qu’à terme certaines fonctions s’étiolent. Mais il était difficile au départ de savoir lesquelles l’emporteraient. Pour ma part j’étais surtout partagé entre « prévenir toute tentation de nous laisser enfermer dans les limites étriquées d’un bulletin intérieur » et sauvegarder la spécificité fondatrice de la centration sur les praticiens engagés dans des études de psychologie. Ce dernier enjeu se traduisit surtout dans la multiplicité des rubriques destinées à diversifier l’accès aux ressources (« Infos pratiques », « Agenda », « Du coq à l’âne », « Bibliofil », « Échos ») et à faire lien avec les pratiques (« Être psychologue en… »). Quant au premier, il se marque essentiellement par l’apparition de deux rubriques essentielles : l’une, qui est bien plus qu’une rubrique, est le dossier. L’autre, au gré de l’actualité des publications, est l’interview d’un enseignant de l’Institut de Psychologie à propos d’un de ses livres.
La nouvelle maquette de 1999 et la position d’équilibre actuelle
Un tournant majeur dans l’histoire de Canal Psy est, à la rentrée 99, la nouvelle maquette, celle qui prévaut encore aujourd’hui. Je n’étais plus dans les coulisses, et c’est donc maintenant en simple lecteur que je m’exprime.
L’effet le plus voyant est que les rubriques « informatives » s’y trouvent réduites à la portion congrue. L’éditorial qui l’annonçait prévoyait de conserver la diversité de ces rubriques, mais de fait, malgré des résurgences ponctuelles, seul l’agenda a vraiment survécu. En revanche, toute la place est désormais occupée par le dossier, qui s’étoffe de plus en plus (il finit par définir l’identité de chaque numéro, par la place qu’il occupe sur la page de couverture comme sur le rappel des derniers numéros auquel est consacrée maintenant la dernière page) – et par la mise en valeur de l’œuvre des enseignants en psychologie, titulaires ou vacataires, de l’université Lyon 2, soit par le biais des interviews, soit par celui des hommages à l’occasion des départs en retraite, ou, hélas, de deux décès qui affectèrent douloureusement la communauté de l’Institut. Il est remarquable d’ailleurs que la rubrique « Aperçu », prévue en ses débuts pour « accueillir (les) articles (des lecteurs) et pour (qu’ils proposent) une avant-première ou une reprise de (leurs) travaux », n’a jamais été consacrée qu’à des travaux d’enseignants titulaires ou vacataires.
Clairement, le parti-pris est, et restera à partir de cette date, de diffuser exclusivement une information à visée théorique, selon l’évidence implicite que rien ne distingue ce qui est bon pour les étudiants engagés dans la vie professionnelle, et ce qui est bon pour n’importe quelle personne intéressée par l’actualité de la psychologie et plus particulièrement son actualité locale.
La mutation est plus spectaculaire encore si l’on analyse l’évolution des thèmes de dossier. Sur les 39 premiers numéros, les thèmes s’inscrivent dans une grande variété de registres. Beaucoup se centrent sur un champ de pratique (gérontologie, marginalité économique, école, santé, sport, déficits visuels). Beaucoup d’autres sur la psychologie comme réalité sociale concrète ; sur le métier de psychologue (pratique en libéral, déontologie), ses outils (le conte), ses frontières (la parapsychologie). Sur la psychologie universitaire aussi, ses sous-disciplines (projective, cognitive, clinique, sociale), à la fois macrocosme (la psychologie dans le monde) et microcosme lyonnais (les stages, la formation continue, la FPP). Plus près encore des questions concrètes des étudiants, un numéro sur la réforme des études (enfin, l’une des innombrables réformes, celle de 1993), et quatre dossiers autour des pratiques d’écriture et de théorisation (les références théoriques, écrit et oral, écrire la clinique, les revues). Dans cette efflorescence, les sujets théoriques font presque figure de parents pauvres : trois, significativement sans doute, autour des questions de génération, de transmission et d’origines ; d’autres sur les grandes questions d’actualité, l’éthique, l’interculturalité, la violence ; enfin un sur le jeu et un sur le corps.
À partir du numéro 40, en revanche, l’éventail se resserre, et les proportions s’inversent : un numéro sur la criminologie ; un sur les errances urbaines ; un sur le phénomène sectaire ; un sur les étudiants en psychologie ; un sur la psychologie, ses contextes et ses pratiques ; un sur les médiations. Et en face un large balayage des objets théoriques de la psychologie : ses frontières épistémologiques (la politique, l’histoire), un auteur (Lacan), et des questions comme le lien groupal et la différence, l’émotion, l’espace, la voix, plus trois numéros autour des relations amoureuses et familiales.
Ainsi s’est-on rapproché d’une sorte de mini-revue savante, qui certes est loin de remplacer les « grandes » : mais qui travaille surtout à faire découvrir, à amorcer des pistes, à donner à penser. À mes yeux, c’est la grande vertu du Canal Psy d’aujourd’hui. Mais n’ayant plus de contact réel avec son lectorat, je ne suis pas sûr d’en être représentatif. Peut-être serait-il intéressant de profiter de cet anniversaire pour redonner à ses lecteurs l’occasion de dire ce qu’eux y trouvent, ce qu’eux en pensent.