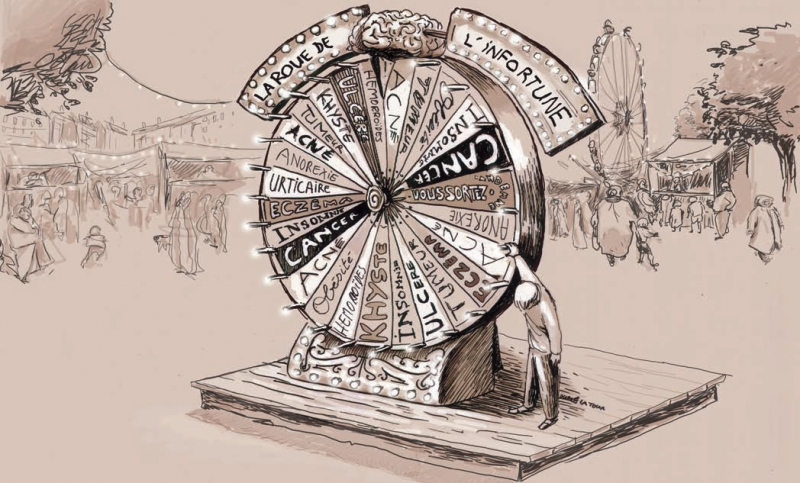Canal Psy : Voulez-vous nous présenter votre livre, l’esprit dans lequel vous l’avez écrit, ainsi que les lecteurs à qui il est destiné ?
M. Grosclaude : Réanimation et coma. Soin psychique et vécu du patient est un livre d’information et de pratique avec une double perspective : d’une part faire connaître et éclairer le vécu de la réanimation, du coma, de l’éveil et « l’après », ses implications pour le patient et les différents partenaires (équipe soignante, proches), d’autre part proposer des pistes, idées-clés et outils conceptuels pour aborder et comprendre cette clinique d’exception à la fois si répandue et méconnue, et pour penser un soin psychique aussi indispensable que spécifique. Le livre s’insère dans la pratique clinique, psychologique et relationnelle de la réanimation. Il propose également une théorisation indispensable sur celle-ci, ouvrant aussi sur le fonctionnement de l’être humain pris dans son ensemble et qui nous concerne tous, et intègre l’ensemble des apports sur la question (ceux issus de mes travaux depuis 1982, mais aussi au sein du REIRPR, réseau de recherche Psychologie et Réanimation créé en 1990). J’ai voulu mettre en circulation dans cet ouvrage, de façon plus large et pragmatique que dans mes précédents travaux (publiés dans des circuits plus spécialisés), un message à l’intention de l’ensemble du public concerné par la réanimation ou susceptible de s’y intéresser – professionnels, médecins, soignants et psy, familles, et les patients eux-mêmes. J’ai voulu faire connaître l’existence de cette clinique de l’extrême, si différente de ce que véhiculent les médias et la littérature sur les expériences dites proches de la mort (NDE), coma, et autres voyages dans l’au-delà réputés merveilleux, et rendre compte de ce qu’elle implique à la fois de particulier et de commun pour l’humain, ainsi que d’un soin psychique nécessaire et possible relevant des spécialistes de la psyché (qui l’ignorent souvent) et différemment des équipes soignantes. Il s’inscrit également dans l’engagement pris à l’égard de nombre de patients qui m’ont exprimé leur demande de « dire aux autres », dire ce que c’est que cette expérience d’un « autre monde », et qu’« il faut parler au malade ». Enfin, dans un autre cadre, j’ai voulu redire ce message personnel plus théorico-clinique, d’une éthique du Sujet, à savoir qu’il y peut y avoir « quelqu’un » là où l’on pense qu’il n’y a plus personne, et que dans l’ignorance cela mérite d’en considérer l’existence et le soin psychique.
Extrait de l’ouvrage : « La réanimation “c’est un autre monde”, “c’est un trou”, “c’est un cauchemar” » (p.37)
Canal Psy : Cette notion d’une « clinique de la réanimation » est assez récente, comment avez-vous construit votre place de clinicienne dans ce service très médicalisé ?
M. Grosclaude : La notion d’une clinique de la réanimation s’est dégagée de mes premières expériences et travaux en réanimation dès 1982, alors que seuls quelques isolés (les Dr Ch. Phéline à Orléans, J.-C. Colombel à Cerbère) s’interrogeaient sur ces questions. Ma démarche a progressé rapidement à travers quelques étapes essentielles : contrats de recherche sur les enjeux psychiques de la réanimation que j’ai soumis à l’INSERM (1986, 1989) et auxquels se sont associés des médecins, équipes de réanimation et psy de différentes régions, un grand Colloque interdisciplinaire fondateur que j’ai organisé en 1990 à Strasbourg et la création du REIRPR (Réseau de recherche Psychologie et Réanimation), puis celle d’une revue en 1992 (Les Cahiers du Réseau Psychologie et Réanimation), et des journées d’étude annuelles. Cette dynamique a fait tache d’huile dans les circuits spécialisés, dont l’une des clés est son ouverture interdisciplinaire et sa nature clinique. Ma place de clinicienne dans le service s’est faite de façon étonnamment simple, sans difficultés majeures (a fortiori à l’époque !), dans des conditions particulières il est vrai, mais avec une facilité que je n’ai mesurée que dans l’après-coup, et que je m’explique par trois raisons : la première est le label « Recherche » (j’étais clinicienne mais aussi universitaire) et le projet de recherche avec lequel j’ai engagé ma démarche en frappant à la porte du service, sur la base d’hypothèses, certes claires pour moi, mais entièrement à vérifier : à savoir que l’expérience subjective de la réanimation existe ; laisse des traces traumatiques, et est psychologiquement abordable par une pratique adaptée. Elles se fondaient sur ma pratique et sa théorisation alors déjà bien engagées dans la clinique lourde des états psychotiques et démentiels. J’ai donc commencé avec cet objectif de recherche clinique inséré dans une pratique auprès des patients comateux et éveillés. L’accueil médical fut respectueux mais plein de scepticisme quant aux résultats avec des malades réputés inconscients et amnésiques. Mais les résultats éclairants immédiats firent le reste pour une collaboration active. La seconde raison concerne l’accueil médical et soignant et l’attention témoignée aux contenus des observations et des travaux : je pense que tous se doutaient de cette réalité psychologique mise au jour, qui compliquait tout mais qu’il fallait prendre en compte, et donc se mettre au travail. C’est encore mon constat actuel : même si la diffusion de l’information reste limitée et la pratique psychologique rarissime en réanimation, l’existence de cette clinique subjective ne suscite ni refus ni ironie (à la différence d’autres domaines) dans les circuits de médecine. Par contre, la difficulté réside dans les modifications indispensables à apporter tant dans les structures de Santé, hospitalières, de formation, budgétaires que dans les positionnements individuels. C’est une chose de savoir, une autre de faire et de changer. Quant à mes motivations elles étaient déjà celles du livre : un intérêt personnel pour le Sujet humain poussé dans ses extrêmes et qui semble avoir déserté, l’engagement dans une pratique psychothérapique dans ces zones lourdes de la déstructuration et de la détresse psychique, la curiosité intellectuelle pour explorer, penser et surtout (re)trouver la psyché et le Sujet perdu, enfin le souci de diffuser le message d’information sur ces réalités méconnues et de mettre en place des formations pour de nouvelles pratiques psychologiques et soignantes.
Extrait de l’ouvrage : Quelques paroles d’un patient à son retour en chirurgie : « Vous êtes la dame de la réa […] Je vous reconnais… Je pensais que vous étiez allemande (l’échange se faisait en allemand en réanimation) qui devait me sauver […] Je savais qu’on devait me faire traverser le Rhin (il avait été admis après une intervention sur le rein) sur un bateau pour me sauver chez une Allemande, je pensais que c’était vous » (p.49)
Canal Psy : Vous définissez la clinique de la réanimation comme une clinique « du sujet extrême » et à ce propos vous évoquez la nécessité de penser les « besoins psychiques propres » du patient dans le coma. Que sait-on aujourd’hui de leur vécu et de ses conséquences ?
M. Grosclaude : J’entends par « clinique du Sujet extrême » un état de déstructuration (l’éveil) où font retour des expériences originaires, jusqu’à un état aux limites de l’existence psychique et aux orées de sa disparition (le coma), néanmoins habité en dépit des apparences, par un Sujet – ou une virtualité subjective – plongé dans des éprouvés extrêmes, archaïques, de déliaison, de violence originaire, et de risque vital de la psyché. Cette clinique psychotiforme, marquée par la permanence d’une psyché en suspens, reprenant sa constance corporelle des origines, paraît inaccessible, voire absente, si l’on ne dispose pas d’outils conceptuels pour l’aborder et la penser (concepts kleiniens de la position persécutive, winicottiens d’agonies primitives, freudiens de la notion de « Nebenmensch », du traumatique de Ferenczi, etc.). Il est aussi caractérisé par une dépendance psychique (corporalisée) extrême à l’égard du tiers, de sa voix, de la parole. Une autre réalité affleure alors, celle d’« un autre monde » (selon l’expression des patients), et d’un traumatisme, « le Trou-Réa ». Les besoins psychiques propres alors identifiables sont ceux-là même de ces états originaires, foetaux (le coma) ou persécutifs (l’éveil), appelant une pratique du soin psychique spécifique, formellement éloignée de l’orthodoxie analytique et néanmoins toute proche pour peu que l’on se tourne vers celle du bébé ou de la névrose traumatique.
Extrait de l’ouvrage : « Le “rêve de réa” indique un état intermédiaire entre hallucination, rêve et réalité » (p.99)
Canal Psy : Il arrive que les soignants aient recours à la contention au moment du réveil du patient. Quelles sont les problématiques associées à cette pratique de protection du patient contre lui-même ?
M. Grosclaude : La contention est la règle et non l’exception. Seule une présence constante à côté du patient peut en dispenser hélas. Cette réalité, dure, est incompréhensible de prime abord au psychologue. Elle découle, d’une part, de l’expérience psychotiforme, persécutive du Sujet, confus, souvent agité, pour qui la seule chose qui compte est de « se sauver », donc de se débarrasser de ses tubulures, d’autre part de la nécessité technique et vitale de multiples branchements. Elle demeure comme un souvenir « terrible », de « torture » pour bon nombre de patients et entre dans l’expérience traumatique qui relève du soin psychique.
Extrait de l’ouvrage : « Son intubation, Mme A. l’a vécue “comme un bâton enfoncé dans sa gorge pour l’empêcher de respirer, par le Dr X. qui l’a intubée exprès” » (p.50)
Canal Psy : Quelle est la place dans ce contexte de réanimation des relations avec l’entourage, famille et soignants ?
M. Grosclaude : La réanimation est en soi, d’emblée, exclusive de relation : lieu de la priorité technique, de l’urgence vitale et du faire d’un côté, de l’absence (par perte de conscience, confusion, intubation qui empêche de parler), de l’isolement subjectif de l’autre côté, pour le réanimé. La relation y apparaît comme antinomique, luxe inutile dans l’immédiat. Mais son éclipse et son besoin caractérisent précisément la psychopathologie d’un Sujet réanimé en détresse et en rupture de liens avec lui-même, les autres, la réalité, dans l’attente vitale d’une « Autre secourable ». Et tous, patients, soignants, proches sont sous le coup d’un manque de relation souvent cruellement ressenti. De plus les enjeux, besoins, et situations relationnels pour les différents partenaires divergent et impliquent de prendre en compte, comprendre et gérer cette complexité (ainsi la famille a besoin d’une relation accompagnante et d’information pour elle-même, alors que sa présence auprès du patient peut être problématique, le patient peut se sentir menacé par la présence d’un conjoint pourtant aimant qu’il ne reconnaît pas, d’autres disent au contraire avoir été sauvés par le maintien d’une relation continue avec un proche, etc.). Enfin l’établissement d’une relation n’a pas la même urgence ni la même fonction selon la personne et le moment. Pour répondre de façon réductrice à votre question, j’envisage évidemment la place de la relation comme essentielle en réanimation, tant comme partie intégrante et constitutive du soin psychique du patient, que sous des formes spécifiques pour la « bonne santé » psychique des soignants, des proches, en des modalités, avec des objectifs propres. Il y faut bien sûr là aussi des moyens, du temps, des compétences.
Canal Psy : Cette clinique avoisine inévitablement la question de la mort ; comment celle-ci se manifeste-t-elle et quelle attitude privilégiez-vous face à cette question difficile ?
M. Grosclaude : Comme d’autres de vos questions, celle-ci est complexe et impossible à traiter en quelques mots. Rappelons simplement qu’entre les grands débats médiatisés sur l’euthanasie ou l’acharnement thérapeutique, la mort est paradoxalement omniprésente : en négatif, évacuée par l’urgence, la priorité vitale, interdite par la définition-même de la réanimation (le « maintien des grandes fonctions vitales »), et en positif par sa survenue qui peut être fréquente. Mais en deçà le patient est plongé dans une expérience du Réel de la mort difficile à imaginer pour l’humain structuré et éveillé. Elle se manifeste par exemple dans sa certitude de sa propre mort programmée, l’impossibilité de savoir s’il est mort ou vivant, sa lutte pour la vie au prix de mourir en s’extubant etc. et ce hors d’un risque vital réel. Elle appelle donc un soin psychique continu même hors de ce risque. Par ailleurs, la survenue de la mort dans la réalité pose la question de l’accompagnement du patient et de ses proches. Toutes ces situations et ces problématiques appellent des interventions psychologiques, relationnelles, soignantes diverses, toutes importantes. La question de l’entrée des soins palliatifs en réanimation est aussi posée par certains. Les positions, quand il y en a, divergent… L’attitude que personnellement je privilégie est celle d’un soin psychique continu et éclairé, à l’intention du patient mourant ou pas : quelle que soit la réalité du risque vital, pour lui la mort est là. Quant à la question de la survenue de la mort biologique, je défends l’option d’un « esprit soins palliatifs » soutenu par l’équipe soignante de réanimation elle-même, et non pas l’entrée de spécialistes extérieurs lorsqu’un patient va décéder. C’est un débat important qui engage notamment la formation des équipes de réa.
Extrait de l’ouvrage : « [Certains patients qui ont pu se sentir] retenus à la vie par [une présence familiale] insistent sur l’importance d’ouvrir davantage les services de réanimation aux familles […] d’autres disent ultérieurement leur regret et leur culpabilité de l’avoir rejeté ou soupçonné de complicité avec les persécuteurs » (p.56)
Canal Psy : Un lieu d’analyse de leur pratique est-il proposé aux soignants de ce service qui sont confrontés quotidiennement, comme vous le soulignez, à l’émergence de vécus très archaïques ?
M. Grosclaude : Non. Et c’est un besoin majeur incontournable, ressenti dans tous les services par tous les soignants : la nécessité impérative d’un espace/temps pour métaboliser, élaborer, ressourcer le fonctionnement de chacun pour la qualité d’un soin somato-psychique humain, et son instauration institutionnelle, de « santé publique » s’imposent pour les équipes comme pour leurs retombées sur les patients, sans se réduire à un groupe de parole pour simplement décompresser et recommencer à l’identique. Mais là aussi il faut une volonté collective et individuelle impliquant de profonds changements dans la conception du soin, du patient extrême, et de la Santé.