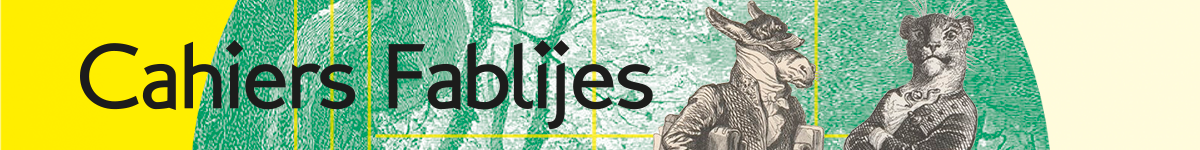Dirigé par Jeanne-Justine Fouqueau de Pussy, le Journal des demoiselles, fondé en 1833, est un journal mensuel destiné aux jeunes filles de quatorze à dix-huit ans qui appartiennent aux classes aisées1. On y trouve des articles sur l’économie domestique, l’apprentissage des langues étrangères, le dessin et la musique, sur la mode et les « travaux de femme », sur l’hygiène, la botanique, l’histoire, la littérature et les arts. Les articles, qui dépassent rarement six à dix pages à double colonne, sont voués à transmettre des connaissances utiles, un jugement sain et une moralité sage à celles qui sont destinées à devenir épouses et mères. Dans les pages du Journal, on rend compte aussi de certains livres, de spectacles et du Salon. On insère régulièrement un patron de couture, de broderie ou de tapisserie et une gravure de mode. À l’occasion, on publie la partition d’une romance ou le texte d’une petite pièce de théâtre. Ces pièces figurent-elles dans le journal, à l’instar des partitions, pour que les jeunes abonnées puissent perfectionner leurs talents d’agrément et de sociabilité en les lisant ou en les jouant chez elles ? L’étude que nous entendons mener ici partira de l’idée d’une analogie possible entre les textes à caractère pratique, les partitions musicales et les textes dramatiques comme source d’actions à la fois formatives et performatives. Aussi examinera-t-on dans ce sens un petit échantillon de pièces publiées dans le Journal des demoiselles dans les années 1830 afin d’en dégager les caractéristiques esthétiques et pédagogiques.
Les pièces qu’on étudiera ici sont le fait de trois auteurs : Adélaïde-Esther-Charlotte Dabillon de Savignac (1790-1847), qui signe ses écrits tantôt du nom d’Alida de Savignac, tantôt de celui d’Esther Dabillon2 ; Henri Burat de Gurgy (1817-1849) ; et Narcisse Fournier (1803-1880). Un des textes de notre petit corpus est appelé « Une charade en action » mais les trois autres sont des « proverbes ». Ces désignations correspondent au genre de récréations dramatiques typiques des pensionnats et des familles aristocratiques ou nanties des années 1830. Les quatre textes que nous avons retenus mettent en scène un monde qui ressemble à celui où vivent les lectrices du journal et racontent des histoires qui pourraient leur arriver. Cette reproduction de lieux, de situations, de personnages et de langage d’un monde familier n’est pas le fait du hasard. Elle est destinée à favoriser l’identification des lectrices avec les personnages de la pièce et à insuffler un effet de réel à l’ouvrage qui renforce son efficacité pédagogique. La représentation du monde que l’on trouve dans ces textes dramatiques, ainsi que leur dimension métathéâtrale – il y a souvent une pièce à l’intérieur de la pièce qui met en évidence des modèles de comportement auxquels on est censé se conformer et souligne le regard que la société porte sur ses membres –, aident à faire passer la leçon que ces textes cherchent à transmettre. Les contraintes sociales, physiques et morales y sont d’autant plus importantes qu’il s’agit de jeunes filles et de jeunes femmes sur qui la loi et les traditions genrées du siècle pèsent avec une force particulière.
Préparer son intégration dans la vie sociale par le jeu
Comme nous l’avons déjà indiqué, Esther Dabillon est un nom de plume adopté par Adélaïde-Esther-Charlotte Dabillon de Savignac, autrice prolifique qui signe aussi certains de ses écrits Alida de Savignac. Pierre-Auguste-Marie Miger retrace l’histoire de la vie et l’œuvre de cette pédagogue, journaliste et femme de lettres dans la Biographie des femmes auteurs contemporaines françaises tout comme Pierre H. Audiffret le fait dans la Biographie universelle de Michaud3. En octobre 1833, Dabillon publie dans le Journal des demoiselles « Une charade en action » qui occupe six pages à double colonne4. Le titre de l’œuvre annonce non seulement le sujet de la pièce, mais aussi son genre. C’est la rédactrice en chef du journal, Jeanne-Justine Fouqueau de Pussy, qui fournira des années plus tard une définition de ce genre qui occupe une place importante parmi les divertissements dans des salons privés au xixe siècle5. « Une charade en action est une sorte de petite pièce jouée à l’improviste, et qui, au lieu de définir un mot par des phrases, le représente par des actions », écrira-t-elle6.
En l’absence d’une liste de personnages séparée, la pièce commence par une longue didascalie introductive qui décrit l’heure et les lieux de l’action (huit heures du soir ; à la campagne de Mme de Montrevel, le salon, avec sa cheminée, sa table de bouillotte, une causeuse et des chaises, puis la salle de billard qui lui est contiguë et une salle de charades) ainsi que la mention des gens qui s’y trouvent. Les premières répliques de la pièce annoncent que des enfants composent une charade pour amuser les adultes qui vaquent à leurs propres plaisirs (jeu de cartes pour les personnes « d’un âge mûr », conversation et travaux d’aiguille pour les femmes [p. 279]). Le bruit des enfants et leurs fréquentes incursions dans l’espace voué aux activités des adultes dévoilent leurs préparatifs en vue du divertissement à venir : on enlève la perruque de la tête du grand-père, les queues du billard, le châle de la mère, les casseroles de la cuisine, etc. Enfin le spectacle est prêt à être joué – on frappe trois coups du pied dans la chambre des charades, puis on ouvre les deux battants de la porte – et les enfants présentent deux courts « tableaux ». Dans le premier, un violoniste virtuose, accompagné d’un petit groupe de chanteurs, cherche à donner un concert qui finit dans le plus grand tumulte. Dans le second tableau, des chevaliers se battent dans un tournoi devant un couple royal et son entourage. On somme alors les adultes à deviner le mot de la charade. Un des adultes, excédé par tout le bruit fait par les enfants, crie : « Silence ! ». Comme par hasard, c’est le mot qu’il fallait trouver (silence et six lances).
Mais le but de la pièce ne se limite pas à la représentation de ces charades improvisées par des enfants. On y trouve également des commentaires sur Isaure Dumas, petite fille égoïste qui s’imagine « supérieure à » et plus méritante que les autres. Aussi y trouve-t-on des jugements désapprobateurs faits à son sujet par des adultes qui regardent le spectacle auquel elle est censée participer et dans des didascalies. « Pauvre madame Dumas ! elle a écrit un traité sur l’éducation, et sa fille ne sera qu’une sotte si elle continue » (p. 280), déclare une femme témoin des événements.
Rien ne présage plus sûrement une femme vaine, coquette, sans esprit, qu’on ne pourra distraire de la contemplation d’elle-même, que cet amour-propre de petite fille qui résiste à tout, même à l’entraînement du jeu (p. 281),
observe une autre.
Isaure est prétentieusement vêtue, on voit qu’elle s’est approprié tout ce qui avait quelque fraîcheur dans la garde-robe de la troupe, mais son ajustement n’a rien d’original ni de gracieux (p. 282)
est-il précisé dans une didascalie. Enfin, comme l’hôtesse de la soirée l’explique à sa petite-fille à la fin de la pièce,
il faut vous habituer de bonne heure à ne trouver votre plaisir que dans le plaisir d’autrui ; car c’est comme cela seulement que l’on est aimable (p. 284).
Ces observations faites par des femmes du monde résument la leçon de moralité et de comportement social indispensable que l’ouvrage cherche à transmettre aux lectrices du journal.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que cette petite œuvre métathéâtrale (la charade montée par les enfants est imbriquée dans la représentation d’une soirée à la maison de campagne de Mme de Montrevel) offre aussi le reflet d’occupations récréatives où l’utile se joint à l’agréable. Si les mots bonté et justesse prononcés dans les dernières répliques de la piécette soulignent les qualités requises dans le monde où les lectrices évoluent, le texte offre aussi le modèle d’activités ludiques à faire chez soi. Les répliques de tous les personnages sont généralement courtes et rapides et de nombreuses didascalies à l’intérieur de l’œuvre guident le jeu des acteurs (déplacements, gestes, ton de voix, attitudes, etc.) ou décrivent les moyens adoptés pour organiser la mise en scène de la charade (costumes, bruitage, etc.). L’action représentée ne dure pas longtemps et la mise en scène de la charade ne devrait pas non plus prendre beaucoup d’heures à préparer ou à jouer. Il serait donc légitime, croyons-nous, de voir dans ce texte un « patron » formatif et performatif que les lectrices du Journal des demoiselles peuvent non seulement lire mais aussi jouer chez elles. C’est en mettant l’accent sur la question de « performance » – représentation d’une pièce, mais aussi illustration du comportement à tenir dans la société – que nous comprenons ces mots présents dans notre sous-titre.
On ne badine pas avec la vanité des jeunes filles
Si la charade d’Esther Dabillon est, de toute évidence, destinée aux plus jeunes lectrices du Journal des demoiselles, L’Enfant gâté, un proverbe en vingt scènes d’Henri Burat de Gurgy, est vraisemblablement écrit à l’intention de celles qui sont ou seront bientôt en âge de se marier. On en sait peu sur la vie de l’auteur, journaliste qui contribue régulièrement au Journal des demoiselles et à d’autres périodiques dont la Gazette des enfants et des jeunes personnes7. Tout comme une charade en action, le proverbe est destiné à être joué par des acteurs amateurs dans le cadre privé d’un salon8. Le proverbe qui nourrit l’intrigue est révélé au dénouement pour souligner la leçon de la pièce. Aussi, à propos de la prégnance des proverbes, un auteur contemporain, Victor Cholet, dira-t-il, qu’ils
peuvent être lus ou joués sans prétention, en famille, et sans apprêts ; leur représentation servira à développer l’intelligence des enfants en formant leur cœur : c’est une manière neuve d’exercer leur esprit, de faciliter leur élocution, et propre surtout à leur donner la tenue et le langage de la conversation9.
L’Enfant gâté se présente comme un texte dramatique typique puisqu’il commence par une liste de personnages suivie d’une didascalie liminaire qui plante le décor en quelques mots. Les personnages ainsi annoncés appartiennent au beau monde provincial, ce qui va de pair avec le lieu de l’action : un château, à Vaux, près de Melun. Sont mentionnés aussi parmi les dramatis personæ un notaire, des invités à la noce et des paysans et paysannes. On est donc fixé d’avance sur le dénouement de la pièce : il doit y avoir un mariage, sujet de grande préoccupation chez les lectrices du Journal. Si l’on s’attarde encore un peu sur les éléments paratextuels de cette œuvre, on constate qu’il y a de nombreuses didascalies et que ces indications scéniques signalent les déplacements et gestes des personnages, leurs émotions ou ton de voix, leurs pensées intimes, les accessoires qu’ils manipulent, le bruitage, leurs costumes, etc. Selon toute apparence donc, c’est un texte susceptible d’être joué et pas seulement lu. La division de l’ouvrage en scènes marquant les entrées et sorties des personnages renforce cette impression.
Eugénie de Blainville est l’enfant gâté du titre. Fille unique et orpheline de mère, elle a reçu, dans un pensionnat, une « éducation distinguée » destinée à lui permettre de tenir sa place dans le monde10. C’est ce que révèle la conversation entre son père et son oncle qui attend l’arrivée de la future mariée et sa grand-mère, parties à Paris acheter certaines choses qui « manquent » à son trousseau (sc. i, p. 230-231)11. Son mariage avec son cousin Alfred, décidé depuis longtemps par leurs parents, va se faire sans que les futurs époux se connaissent. Or, Alfred voudrait parler avec Eugénie avant la signature du contrat pour s’assurer que leurs caractères sont compatibles et qu’elle accepte de vivre de ses revenus de jeune avocat qui n’a prêté serment que depuis un mois. La suite de l’histoire est assez prévisible. Alfred, n’ayant pas les moyens de satisfaire à toutes les demandes de luxe exprimées par Eugénie12, annonce son intention de rompre avec sa cousine alors que les invités sont sur le point d’arriver pour la noce. Eugénie, qui imaginait rendre ses camarades de pensionnat jalouses par un beau mariage, doit donc trouver un nouveau mari à l’instant. Alors qu’Alfred se retire dans la pièce à côté (d’où il peut tout entendre), la jeune fille se confie à un oncle qui lui promet tout ce qu’elle désire. Par dépit et par vanité, elle finit par déclarer son désir d’épouser cet oncle. Mise au fait de la situation, la marraine d’Eugénie, une jeune veuve raisonnable, prépare une ruse. Elle fera semblant d’épouser Alfred pour piquer la jalousie de sa filleule tandis que l’oncle fera croire à Eugénie qu’ils se marient selon son souhait. Un retard du notaire favorise ce projet et, déguisé pour la circonstance, un faux notaire fera signer deux faux contrats13. Pourtant, la satisfaction qu’éprouve Eugénie en se voyant mariée à un homme riche et complaisant ne dure pas. Quand le véritable notaire arrive, on apprend à Eugénie qu’elle n’est pas la femme de son oncle. Elle accepte alors, avec soulagement et joie, d’épouser son cousin. La pièce se termine sur l’annonce d’un proverbe de Louis-Philippe de Ségur, auteur d’une Galerie morale et politique, que l’on gardait pour la fin : « Une once de vanité gâte un quintal de mérite14 » (p. 244).
Malgré des éléments de l’intrigue qui font penser à On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset, L’Enfant gâté n’a pas cette poésie comico-tragique dans laquelle baigne le proverbe mussétien et le langage des personnages de Burat de Gurgy est bien moins subtil que celui que l’on trouve chez Musset. Il est alors facile d’imaginer que les jeunes lectrices du Journal des demoiselles seraient capables de jouer L’Enfant gâté chez elles. Mais en plus d’un divertissement agréable, elles y trouveront un message explicite sur les questions d’économie domestique et de vanité qui figurent régulièrement dans ce périodique. Si l’éducation d’Eugénie a développé ses talents artistiques – agréments certes utiles dans le monde –, on ne semble pas lui avoir appris à refréner son désir de rivaliser avec, voire d’éblouir, ses camarades de pensionnat. On ne lui a pas non plus fait comprendre que le rôle d’épouse et mère auquel elle est vouée demande qu’elle sache non seulement chanter, peindre, gouverner ses domestiques et éduquer ses enfants, mais aussi gouverner ses désirs et se montrer capable d’aider son mari à constituer un capital social et économique qui permettra à la famille de s’ancrer solidement dans le monde. Penser aux autres, sacrifier sa vanité et ses plaisirs à leur bien-être, laisse-t-on entendre ici, constitue le but d’une femme15.
Vogue la galère : en route vers le mariage par l’apprentissage des « malheurs »
Le Naufrage imaginaire, un proverbe en deux actes d’Alida de Savignac, est publié dans le Journal des demoiselles en janvier 183816. Les personnages de la pièce sont au nombre de cinq : un riche capitaine de vaisseau revenu à terre, sa fille Anaïs, et son ancien matelot, Gabard, puis la sœur du capitaine et la fille de celle-ci. La scène se passe dans un port. Au premier acte, tous les personnages se rencontrent dans un salon chez le capitaine. Anaïs trouve impensable l’idée d’apprécier la solitude comme le font depuis des mois sa tante et sa cousine. Elle rechigne aussi à l’idée d’effectuer des travaux physiques (défricher des bruyères, soulever des fardeaux) ou de se contenter de repas simples. Elle préférerait mourir, dit-elle, plutôt que de souffrir un tel sort et ne veut penser qu’au bal que son père offre le soir même dans sa nouvelle propriété : une île qui s’appelle Bois-près-Eaux. Le capitaine déplore la frivolité et le manque de ressources morales de sa fille. Personne n’est à l’abri du malheur, lui explique-t-il, et il faut savoir y faire face. Il prononce alors un proverbe tiré de « la Sagesse des nations » : « Ce qu’un homme a fait, un autre peut le faire », et met Anaïs au défi (p. 23). Elle a deux ans pour se montrer plus courageuse et moins égoïste si elle veut pouvoir se marier. La jeune femme lui répond que
si [elle] étai[t] forcée d’habiter une profonde solitude, d’y être pauvre et men[er] la triste vie de [sa tante et sa cousine], [elle] ne dirai[t] pas, comme le bûcheron de la fable [de La Fontaine] : « Mieux vaut souffrir que mourir ! » (p. 24).
Elle voudrait plutôt mourir.
L’acte deux nous transporte sur une grève « déserte » au bord de la mer. C’est, en réalité, une partie de l’île du capitaine que sa fille ne connaît pas. Le capitaine a convenu avec son matelot d’une ruse qu’il espère capable de modifier les idées d’Anaïs. Après lui avoir administré un narcotique anodin, on a transporté la jeune fille sur cette plage où on a disposé une barque brisée, des caisses enfoncées, etc. pour qu’elle s’imagine victime d’un naufrage. Gabard porte une épaisse barbe postiche et des vêtements en désordre pour faire croire qu’il y a longtemps qu’Anaïs et lui sont arrivés sur cette rive « voisine du Canada ». Le capitaine, caché derrière un buisson, observe le spectacle qu’il a ordonné. Si Anaïs ne veut pas mourir de faim, elle doit accepter de travailler pour se procurer les racines comestibles qui constituent la seule nourriture disponible dans l’île. Elle doit aussi aider Gabard à construire un abri. Quand Gabard lui fait croire que les « naturels » du pays arrivent pour les mettre tous deux à la broche, au lieu de s’abandonner à son sort, la jeune femme s’active pour se défendre. Mais ce sont plutôt les invités du bal et sa tante et sa cousine qui paraissent devant elle. Alors Anaïs remercie son père de lui avoir appris à faire face à toute éventualité avec énergie et courage plutôt que de se laisser mourir par vanité et faiblesse17. « [Q]uand on se croit incapable de supporter un malheur, ou de se tirer d’une position difficile, on devient vraiment le jouet du sort », lui dit le capitaine. Anaïs accepte alors cette vérité que « ce qu’un homme a fait, un autre peut le faire » (p. 26). C’est la preuve qu’elle a acquis une maturité et une vaillance qui la rendent apte au mariage aux yeux de son père.
Comme on le voit, cette petite pièce offre encore une fois un spectacle dans un spectacle, élément ludique et amusant qui favorise la transmission de sa leçon morale et sociale. On peut également voir l’emploi de cette mise en abyme dramatique comme une démonstration en miniature du rôle pédagogique que les auteurs des pièces dans le Journal des demoiselles attribuent à la pratique du théâtre. L’évocation du Robinson Crusoé de Defoe et son île déserte – texte traduit maintes fois en français et universellement connu – aide à renforcer le caractère didactique de cette petite pièce. De même que dans la charade d’Esther Dabillon et le proverbe de Burat de Gurgy examinés plus haut, le dialogue et la psychologie des personnages sont simples et leurs costumes à peine évoqués. Il serait donc facile de jouer ces rôles sur un théâtre de société, c’est-à-dire représenté chez des particuliers. Le décor du premier acte, un salon, est tout sauf précis. Aucune indication de ses dimensions, de son ameublement ou de sa décoration n’est donnée. L’époque de l’action n’est pas non plus signalée. On pourrait alors jouer cet acte chez soi sans difficulté. Le décor du deuxième acte demanderait un peu plus d’effort à recréer, mais comme les enfants qui ont figuré dans la charade d’Esther Dabillon, il n’est pas impossible de se servir de son imagination et de ce qu’on a sous la main pour improviser une « île déserte » a minima.
Le jeu de l’amour sans hasard : le triomphe de la sagesse familiale
Le Valet de trèfle, pièce de Narcisse Fournier en quinze scènes, est publié sans désignation générique dans le Journal des demoiselles de novembre 183818. Romancier, journaliste et auteur dramatique français prolifique, Fournier est sans doute le mieux connu des auteurs compris dans notre échantillon. On trouvera sa biographie dans le Dictionnaire de biographie contemporaine d’Adolphe Bitard et la Biographie nationale des contemporains d’Ernest Glaeser19. L’ouvrage de Fournier que nous examinons ici renferme la phrase proverbiale « Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera ». Elle est tirée de la comédie Les Plaideurs de Jean Racine (1668), modèle dont Fournier aurait vraisemblablement profité pour créer certains de ses personnages et quelques développements de son intrigue. La pièce commence, comme celles d’Henri Burat de Gurgy et d’Alida de Savignac déjà examinées, par la liste des personnages et une didascalie introductive. Les personnages n’ont pas de noms qui les marquent comme des aristocrates, mais il est clair que ce sont des gens appartenant aux classes aisées. La didascalie initiale précise le décor unique :
La scène est à Paris, dans le jardin de Mme Franval. À gauche, sa maison, devant laquelle est un petit berceau en treillage ; à droite, un pavillon dont les fenêtres sont à hauteur d’appui ; au fond, un mur percé d’une petite porte ; sur le devant, à droite, une table de jardin et quelques chaises. (p. 331)
Comme d’autres pièces de l’époque20, la pièce de Fournier fait comprendre à une jeune femme naïve les avantages d’un mariage de convenance résolu par sa famille, comparé à un mariage d’inclination. Mme Franval va se rendre brièvement chez son frère pour lui parler de leur nièce, Caroline, qui est en âge de se marier. Cette nièce est d’un caractère exalté, romanesque et Mme Franval voudrait lui donner un mari « raisonnable », convenable sous tous les rapports. Or, Isidore, un « mauvais sujet » récemment installé au pavillon en face de chez Mme Franval, est alléché par les rentes de la tante et la dot de la jeune fille et voudrait épouser Caroline pour son argent. À cette fin, il suborne Simplice, le jardinier de Mme Franval qui mérite bien son nom, et se sert de la marraine de Simplice, une diseuse de bonne aventure qui vient en l’absence de Mme Franval prédire son avenir à Caroline. La mère Folliquet lui annonce un prochain mariage avec un jeune homme brun (représenté par le valet de trèfle du titre). Enchantée de cette prophétie, Caroline déclare vouloir suivre sa « destinée » et refuse le parti choisi par sa tante et son oncle. Mme Franval découvre alors une carte de jeu tombée par terre et Simplice est obligé de lui avouer la venue de sa marraine et ses présages. Isidore, descendu de sa fenêtre pour mettre en œuvre son projet de séduction conforme en tout point aux présages de la mère Folliquet, se cache alors sous le berceau en treillage21. Au même moment, Dubreuil, le futur agréé par les parents de Caroline et sincèrement épris d’elle, arrive et exécute de point en point le même scénario dont Mme Franval, renseignée par Simplice, lui a fait part. Puis Dubreuil découvre la présence d’Isidore qui assiste depuis le berceau à la scène dont il espérait être le héros. Le projet déloyal du jeune étudiant est découvert et Caroline remercie Dubreuil de lui avoir donné une bonne leçon22. Elle consent alors à épouser l’homme choisi par sa famille. Simplice répète le début du proverbe « Tel qui rit vendredi » (sc. xv, p. 340) à l’intention d’Isidore, mais le dernier mot de la pièce est réservé à Mme Franval qui dit à sa nièce : « nos préjugés seuls encouragent le charlatanisme, et c’est toujours notre faiblesse qui fait la force des intrigants. » (ibid.) Les superstitions comme les mystifications intéressées sont ainsi balayées au profit des sages conseils de la famille.
À l’encontre des autres pièces examinées jusqu’ici, Le Valet de trèfle a été composé par un dramaturge dont les œuvres sont jouées aussi sur des scènes parisiennes. Ce ne sont pourtant pas les mêmes pièces que l’on trouve dans les pages du Journal23. La différence entre les pièces publiées dans le Journal et celles jouées dans les théâtres institutionnels se résume principalement à leur brièveté et leur désignation générique. Formellement et esthétiquement, la brièveté des proverbes entraîne certaines conséquences. Il y a moins de personnages dans les proverbes publiés dans le Journal, moins de subtilité stylistique et psychologique aussi. L’intrigue est moins bien développée dans ces petites pièces qui sont également caractérisées par moins d’extension dans l’espace et dans le temps par rapport aux œuvres faites pour la scène24. Les proverbes parus dans le Journal se limitent généralement à des situations se rapportant à la vie des jeunes filles de l’époque (existe dès lors un fort élément de réflexivité entre public et personnages) tandis que dans d’autres pièces de Fournier les sujets sont plus variés et les similarités entre les personnages et le public sont moins nettes ou inexistantes. Le but didactique des pièces qui figurent dans les pages du Journal les distingue aussi des œuvres que Fournier écrit pour des scènes publiques. Qui plus est, l’élément métathéâtral ne se rencontre pas souvent dans les pièces qu’il destine aux théâtres parisiens. Certes, toutes les pièces publiées dans le Journal des demoiselles ne renferment pas d’éléments métathéâtraux, mais la présence (sous diverses formes) d’un spectacle à l’intérieur du spectacle souligne la réflexivité qui nous semble une des caractéristiques importantes des pièces destinées aux lectrices de ce périodique25.
Cette comparaison entre les pièces de Fournier faites pour la scène et celles qu’il a écrites pour le Journal des demoiselles permet de souligner les caractéristiques esthétiques et didactiques des pièces publiées dans le Journal pendant les années 183026.
Conclusion
Les œuvres qui figurent dans les pages du Journal sont des compositions originales rédigées en vue du public auquel elles sont destinées. Conçues comme un miroir de la société à laquelle appartiennent les lectrices du Journal des demoiselles, les pièces que nous venons d’examiner ici se caractérisent par leur finalité pédago-sociale (montrer et corriger les défauts de celles qui sont destinées à devenir épouses et mères), par le « réalisme » de leurs décors27, par des personnages28, des intrigues et un langage qui reflètent le monde et les préoccupations des jeunes abonnées de ce périodique. Leur brièveté et le petit nombre de personnages qui figurent dans ces pièces, comme l’absence de tirades ou de langage poétique et la simplicité (voire l’unicité) des décors permettent aussi de voir dans les œuvres dramatiques publiées dans le Journal des demoiselles des « patrons » – patrons de comportement, de langage et d’élocution – que l’on doit adopter en même temps qu’ils permettent de se récréer (se divertir) chez soi. Formatifs et performatifs, à l’instar des modèles de couture, de tapisserie ou de broderie et des partitions de musique qui se trouvent dans les pages du Journal des demoiselles, ces courts textes dramatiques sont non seulement destinés à la lecture, mais pourraient faire partie du répertoire d’un théâtre de société. Il ne nous manque que le témoignage de la correspondance ou des journaux intimes des abonnées de ce périodique pour le confirmer. Ce qui est clair, c’est que les pièces du Journal constituent un des lieux où la jeune fille des années 1830 est étudiée et formée par les collaboratrices et collaborateurs du Journal des demoiselles.