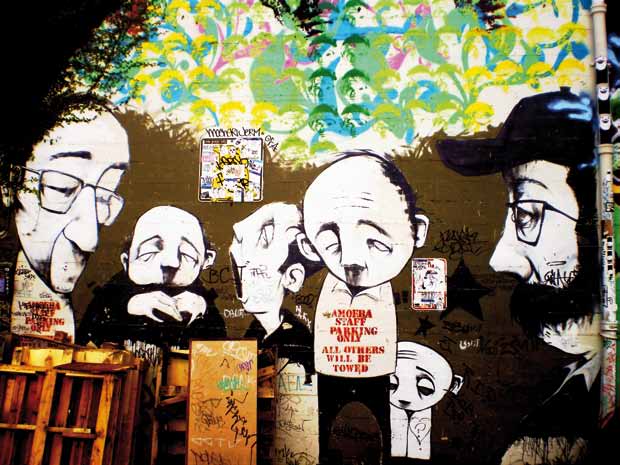La politique d’acquisition de documentation est, tout le monde le sait, en évolution très rapide, sous la pression des nouveaux modes de diffusion des connaissances et, aussi, en raison des pratiques commerciales de grands éditeurs multithématiques. En France, ces éditeurs ont pu pendant longtemps imposer relativement facilement leurs tarifs, en raison de la multiplicité des acteurs institutionnels et de leur manque de coordination, et une initiative intelligente, comme le consortium Couperin, n’a pas atteint tous ses objectifs.
Il faut aussi souligner qu’il manque, d’une part, une vision commune aux différentes disciplines scientifiques (si elle est possible) et, d’autre part, une vision commune aux scientifiques et aux responsables de documentation au niveau des établissements.
Les mathématiciens, par exemple, sont très nombreux à penser que les inconvénients de faire les choix d’acquisition ou d’abonnement sur la base de statistiques d’usage ou de facteurs d’impact l’emportent largement sur les avantages, et ce d’autant plus que certains éditeurs ont appris à tirer de ces chiffres des arguments fallacieux lors de négociations. Par exemple, ils font porter ces statistiques sur les accès à la collection en négociation depuis l’origine des accès alors que le chiffre pertinent porterait sur les documents publiés pendant la période couverte par le contrat précédent.
Dans ce contexte changeant, les éditeurs commerciaux bougent plus vite que les tutelles de la recherche et cela leur confère un grand avantage. Ils proposent actuellement de nouveaux modèles, comme l’« Open Access Gold » dont les utilisateurs ne mesurent que trop lentement les conséquences pernicieuses.
L’initiative Bibliothèque scientifique numérique (BSN) de la Mission de l’Information scientifique et technique et du Réseau documentaire (MISTRD) commence à remédier à ces défauts structurels et, en particulier, suscite la réflexion sur les licences nationales.
Restructurer les acquisitions documentaires
Bien utilisées, les licences nationales peuvent être un levier très utile pour aider à restructurer les acquisitions documentaires de telle manière qu’elles deviennent scientifiquement plus pertinentes et économiquement acceptables et durables. De plus, elles peuvent modérer l’impact négatif pour la recherche de choix documentaires parfois hâtifs d’universités ou d’institutions soumises en ce moment, et pour plusieurs années, à de fortes contraintes de toutes natures et en particulier financières.
La signature de telles licences est désirable pour les éditeurs et leur négociation peut et doit être conçue sur de nouvelles bases, en particulier en ce qui concerne l’évaluation par des scientifiques des offres ou l’exigence d’adhésion de ces offres à une charte d’édition durable comme celle qui est préparée par la BSN et qui contient en particulier l’obligation de dépôt des documents sur une archive ouverte après un certain temps d’embargo.
Quel modèle éditorial pour la recherche ?
Il est des domaines, comme les mathématiques ou les sciences humaines et sociales, où l’édition académique peut, au prix d’un effort relativement faible, concurrencer suffisamment l’édition commerciale pour amener celle-ci à abandonner des modèles insupportables. Des licences nationales pourraient encourager l’édition académique à se développer et donc l’aider à devenir une concurrente encore plus forte pour l’édition scientifique à but exagérément lucratif. D’autres disciplines, comme la biologie ou la chimie, se sont laissées prendre presque entièrement au piège de l’édition rapace (parfois représentée par des sociétés savantes !) et le payent aujourd’hui au prix fort, financièrement mais aussi scientifiquement. Certains de leurs chercheurs réagissent avec force mais souvent en proposant comme solution l’« Open Access Gold » ou l’auto-édition « gratuite » par les scientifiques. Or je ne crois pas que cette dernière puisse apporter une concurrence efficace aux mauvaises pratiques. Ceux qui la proposent négligent plusieurs facteurs importants, comme le fait que la partie du travail éditorial qui n’est pas faite par les scientifiques a un coût non négligeable, et aussi le devoir d’assurer la pérennité des accès sur le très long terme. Il ne faut pas confondre ArXiv1 ou HAL2 avec un éditeur. L’édition scientifique gratuite n’existe pas ; la meilleure approximation est précisément… l’édition académique qui, rappelons-le, a été créée pour cela ! J’appelle ici par extension « édition académique » celle qui respecte de bonnes pratiques en termes de qualité scientifique, de prix et d’autres critères qui doivent être bientôt précisés par la BSN dans une charte.
Bien sûr, cette édition académique n’est pas parfaite, ses usages sont parfois un peu anciens et nous devons travailler à l’améliorer et à la renforcer. Par exemple, un mode d’édition sans but lucratif comme la Public Library of Science3, à dépôt payant – mais pas trop cher – et adapté aux ressources des auteurs, offrant un accès gratuit et publiant tout ce qui est techniquement correct, représente peut-être une solution transitoire pour certaines disciplines. En tous cas, je pense que promouvoir l’auto-édition gratuite en ce moment ne fait qu’augmenter la confusion et finalement fait le jeu de certains éditeurs qui en ont cyniquement détourné le beau rêve en versions chères de l’« Open Access Gold », de niveau non garanti, tout en prétendant offrir aux chercheurs ce qu’ils demandent.
Il faut bien réfléchir au fait que les sommes consacrées par l’État à des licences nationales bien négociées serviront non seulement à permettre l’accès à la documentation mais aussi à garder un certain contrôle sur les modèles économiques utilisés et garantir la qualité scientifique ainsi que l’adaptation aux besoins réels des modes de diffusion des connaissances, ce que ne permettent pas du tout les sommes dépensées par le même État pour financer la publication en Open Access.
Les licences nationales ne sont évidemment pas la solution de tous les problèmes – et beaucoup d’offres documentaires ne s’y prêtent pas pour des raisons variées –, mais elles sont certainement un outil important dans une stratégie de réappropriation et de réorganisation par les chercheurs et les spécialistes de la documentation des circuits de diffusion de celle-ci.
Il reste à élaborer et mettre en œuvre cette stratégie, avec cette fois une forte participation des chercheurs, dont le concours est indispensable, en particulier pour bien gérer les conflits avec les éditeurs qui pourraient en découler. Le lieu naturel de cette élaboration est l’initiative BSN de la MISTRD, présentée dans le dernier numéro d’Arabesques4, et sa mise en œuvre est une question de volonté politique et de prise de conscience des chercheurs et spécialistes de la documentation. Deux pétitions récentes, initiées par des mathématiciens, manifestent (enfin !) une forte mobilisation de chercheurs contre des pratiques tarifaires rendues encore plus insoutenables par les diminutions de crédits et donnent de l’espoir à ce sujet.
Réfléchir, discuter, comparer, proposer : débats multiples autour des licences nationales.
Sur les murs de San Francisco
Photo : Gilles Klein sur Flickr (licence CC BY-SA 2.0)