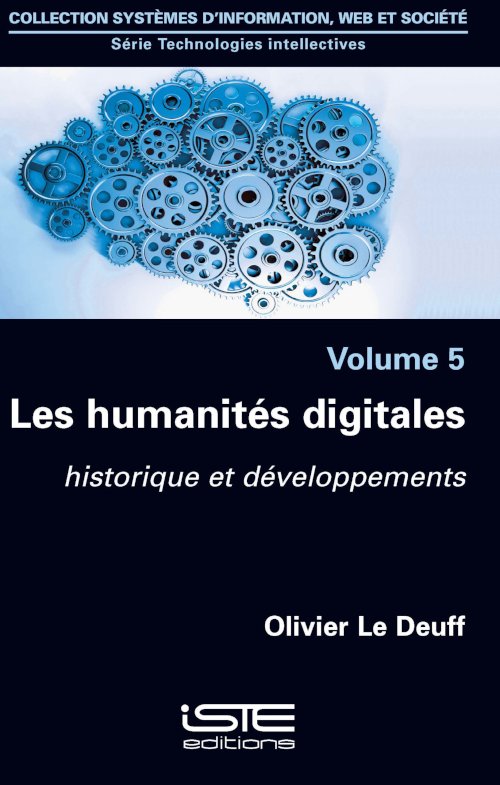Les humanités numériques articulent les nouvelles potentialités de traitement informatisé pour améliorer la constitution et l’exploitation de bases de données et renouveler les possibilités en matière de visualisation et d’analyse.
L’expression d’humanités numériques ou digitales s’est imposée depuis une quinzaine d’années et s’accompagne d’une série d’avancées et de réalisations qui permettent de mieux saisir dorénavant cette évolution des sciences humaines et sociales. L’histoire longue des humanités numériques nous resitue dans celle de l’organisation des connaissances et de ses outils. L’histoire courte la place dans des initiatives de rapprochement entre lettres, humanités et informatique. Si le mythe tend à placer le projet d’index thomisticum1 du prêtre Robert Busa en collaboration avec IBM comme précurseur, il est possible de citer parmi les pionniers bien d’autres projets universitaires, qu’ils soient sous l’appellation Informatica Umanistica ou bien celle d’Humanities Computing qui a longtemps précédé celle de Digital Humanities.
Concrètement, le mouvement articule les nouvelles potentialités de traitement informatisé pour améliorer la constitution de bases ou banques de données, leur interrogation, le partage des données et les possibilités renouvelées en matière de visualisation et d’analyse.
Les humanités numériques ou digitales sont donc des humanités augmentées autant dans leurs perspectives de recherche que d’enseignement. Elles requièrent des outils, des méthodes, des langages pour pouvoir bénéficier de nouvelles manières de voir et de nouvelles manières de faire. Les humanités numériques sont souvent mentionnées dans les logiques de projet de recherche notamment pour obtenir des financements conséquents et plus ambitieux.
Rationaliser les processus
Innovantes et parfois en marge notamment avec les manifestations de type THATCamp qui avaient pour but de renouveler les colloques et journées d’étude pour inciter à davantage de participation, formation, échanges et productions, les humanités numériques se sont peu à peu institutionnalisées avec des reconnaissances au niveau des profils d’enseignants-chercheurs et d’ingénieurs. Des diplômes ainsi que des laboratoires affichent désormais la mention « humanités numériques » dans leurs intitulés. Depuis le manifeste de Paris 20102, la reconnaissance s’est organisée aux niveaux universitaires, interuniversitaires et associatifs. Plusieurs associations existent comme ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations), EADH (European Association for Digital Humanities) et Humanistica, association francophone créée lors du THATCamp de Saint Malo en 2013 et qui organise désormais son colloque et bénéficie d’une revue dédiée (cf p. 19).
La période est désormais à une rationalisation des processus de façon à éviter que les projets même potentiellement innovants finissent par péricliter faute de nouveaux financements. Il s’agit dorénavant d’accompagner chaque projet d’un plan de gestion de données, à des fins de conservation, mais également d’interopérabilité. Les développements informatiques et logiciels réalisés s’inscrivent dans des démarches open source de façon à faire bénéficier des avancées réalisées à l’ensemble de la communauté. Les évolutions de certains logiciels, comme Omeka et Omeka-S, ou Zotero produits par le Roy Rosenzweig Center for History and New Media font partie de ces exemples réussis. D’autres exemples existent dans le champ des bonnes pratiques autour de la numérisation et de l’indexation des corpus notamment en XML TEI avec des communautés dédiées. On peut citer par exemple le travail réalisé par le consortium Cahier (Corpus d’Auteurs pour les Humanités : Informatisation, Édition, Recherche) ces dix dernières années.
:
Des outils dédiés intégrés dans les pratiques de recherche
L’infrastructure Huma-Num (cf p. 6-7) participe également de cet esprit et facilite le travail des chercheurs dans leur gestion de projet en leur offrant une série de services et d’outils pour héberger un site Web, gérer leurs données avec Nakala, bénéficier d’un drive avec Sharedoc ou bien encore utiliser certains logiciels dédiés en ligne comme Stylo ou Voyant.tools. L’infrastructure se développe à la fois à l’international, notamment au niveau européen avec Dariah (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), dans le cadre de partenariats avec le Québec, mais également au niveau local avec le développement de services disponibles au sein des Maisons des sciences de l’Homme.
Impossible de ne pas évoquer le rôle décisif d’Open Edition à plusieurs niveaux : celui de la valorisation et du rapprochement science-société avec les carnets de recherche Hypothèses, celui d’une proposition éditoriale riche au niveau des revues sous le logiciel Lodel et la mise à disposition d’ouvrages via Open Books. Les humanités numériques s’inscrivent désormais clairement dans le quotidien des chercheurs, ingénieurs et bibliothécaires avec des outils dédiés qui se sont peu à peu intégrés dans les pratiques. Malgré les quelques réticences au niveau des discours à l’égard des humanités numériques, force est de constater que la logique services et outils s’est montrée convaincante tout comme la volonté d’y puiser matière à innover et à renouveler des approches scientifiques et pédagogiques.
Imaginer des formes hybrides entre recherche et bibliothèques
Il reste encore à accomplir la dimension d’ingénierie technique et d’ingénierie organisationnelle en imaginant des formes hybrides entre recherche et bibliothèques, entre documentation et production3. Des pistes de « lab » ont été élaborées et mêlent différents types de profils pour parvenir à développer et maintenir des projets ambitieux. Ainsi, le Medialab de Sciences Po présente un modèle intéressant en matière de recherche et développement (les logiciels Geph et Hyphe y sont notamment développés) tandis que le récent BnF DataLab (cf p. 8-9) met l’accent sur la nécessité de prendre soin des données de la recherche, des plus récentes à celles issues de numérisation.
:
Mieux valoriser les compétences et savoirs associés aux humanités numériques
Quoi qu’il en soit, l’avenir des humanités numériques repose sur cette double perspective : celle de la pérennité des services et des données produites qui requièrent des processus mais aussi des recrutements dédiés ; celle de la recherche-développement et de l’innovation qui nécessitent des collaborations originales, des prises de risques, la capacité d’articuler concepts et logiciels et qui vont également avoir besoin de soutiens financiers pour le démarrage et d’assurance de pérennité en cas de succès.
Cela implique en tout cas de mieux valoriser les compétences et savoirs associés aux humanités numériques dans les profils d’enseignants-chercheurs, d’ingénieurs et au sein des services de documentation.
POUR EN SAVOIR PLUS
Burnard, Lou (2014) What is the Text Encoding Initiative ? : How to add intelligent markup to digital resources. OpenEdition Press. http://books.openedition.org/oep/426
Carlin, Marie, Laborderie, Arnaud (2021). « Le BnF DataLab, un service aux chercheurs en humanités numériques », Humanités numériques, 4, http://journals.openedition.org/revuehn/2684
Hockey, Susan (2008) « The histories of humanities computing », in S. Schreibman S., R. Siemens, J. Unsworth (Éd.), A Companion to Digital Humanities, Wiley-Blackwell
Idmhand, Fatiha (2021) Dix ans avec CAHIER. Bilan du consortium CAHIER (2011-2021) de la TGIR Huma-Num. [Rapport de recherche], Huma-Num ; CAHIER - Consortium CAHIER. 2021. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03419128
Le Deuff, Olivier (2014) « Bibliothèques et lieux de production de savoirs ». Dans Le Temps des humanités digitales. La Mutation des sciences humaines et sociales, sous la dir. d’Olivier Le Deuff. Limoges : FYP Éditions. https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01487073
Le Deuff, Olivier (2017) Les humanités digitales. Historique et développements. Iste éditions.
Mc Carty, Willard (2005) Humanities Computing. Palgrave Macmillan