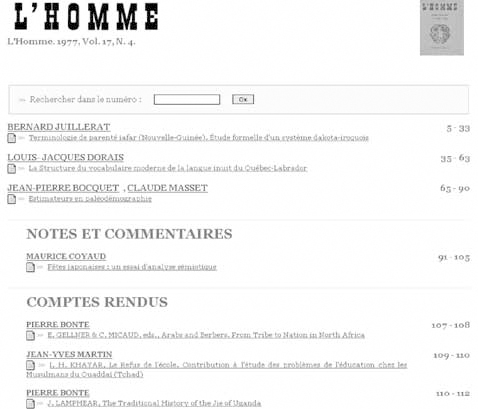« La numérisation est la conversion d’un objet réel en une suite de nombres permettant de représenter cet objet (…) » (in Wikipedia – article : numérisation)
Qu’il s’agisse de faire découvrir un fonds patrimonial (grâce à la numérisation de livres anciens ou de manuscrits) ou de mettre en valeur la production scientifique universitaire d’un domaine du savoir (par la numérisation de revues de référence), toute opération de numérisation a pour objectif d’offrir au public l’accès à des ressources documentaires rares, précieuses ou fragiles et, comme plus–value, la mutualisation de documents parfois oubliés dans les réserves des bibliothèques. Cependant, on s’accordera à dire que la richesse du fonds lui–même – vertu première et indiscutable – est un préalable mais se révèle insuffisant si l’on souhaite optimiser cette démarche de valorisation. En effet, il serait, ô combien dommageable, de voir ces fonds sortir d’un oubli pour tomber dans un autre…
Toute entreprise de numérisation représente un travail conséquent : outre les opérations de numérisation elles–mêmes, coûteuses en moyens humains et financiers, l’analyse des fonds pour une structuration adéquate, leur (ré)indexation, leur enrichissement par un apparat critique adéquat, le reformatage des données descriptives, la mise en œuvre de services de recherche adaptés sont autant d’étapes à investir pour faire exister ce fonds sur la toile. De plus, la souplesse offerte par le web, ses protocoles et ses formats standard, permet d’étendre et de multiplier les points d’accès aux fonds numérisés. À titre d’exemple, on évoquera l’interconnexion entre les fonds numérisés Medic@, Persée1 et PôLiB (présentés ci–dessous) et le portail Sudoc, rendant possible une interrogation simultanée de ces trois fonds. De fait, il s’agit de pouvoir adapter un fonds numérisé tant à un besoin spécialisé (comme, par exemple, le portail de mathématiques Linum2) qu’aux ambitions d’une bibliothèque numérique européenne.
Destiné à favoriser le rapprochement entre les différentes initiatives, l’inventaire des fonds numérisés de l’enseignement supérieur (NUMES), qui sera prochainement mis en œuvre par les équipes de l’ABES, permettra le repérage et la description des fonds numérisés ou en cours de numérisation dans les bibliothèques des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Présenté par Jean–Émile Tosello–Bancal les 26 et 27 janvier derniers, lors de la réunion des directeurs organisée annuellement par la SDBD, cet inventaire, conçu selon la même logique que le catalogue des fonds culturels numérisés s’inscrit dans la perspective du projet Michael (inventaire multilingue du patrimoine culturel européen). Lancé en juin 2004 pour une période de trois ans, le projet Michael vise à proposer un accès simple et rapide aux collections numérisées des services du patrimoine, des musées, des bibliothèques et des archives de différents pays européens. En tant que plateforme multilingue dotée d’un moteur de recherche, il sera possible d’obtenir les informations sur des collections dispersées dans des lieux et sur des serveurs différents, ce qui facilitera l’accès aux fonds numérisés en provenance des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche, peut–être plus confidentiels que les collections issues des bibliothèques à vocation patrimoniale. La sélection qui suit – que les lecteurs d’Arabesques découvriront, nous l’espérons, avec plaisir et intérêt – illustre la richesse de ces fonds et témoignent de la dynamique de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce domaine.
CEFAEL
Les collections de l’École française d’Athènes – CEFAEL3 – regroupent l’intégralité des ouvrages publiés par l’école depuis 1877. Premier portail de publications électroniques sur les études grecques, CEFAEL constitue un patrimoine scientifique considérable, produit par plus de 1 100 auteurs.
Le projet visait tout d’abord à la mise en ligne de la « Chronique des fouilles ». Rapidement élargi à la mise en ligne du « Bulletin de correspondance hellénique » puis de l’ensemble des monographies, CEFAEL offre à la consultation un ensemble de près de 500 volumes, soit près de 250 000 pages.
De façon très fluide, il est possible de parcourir les différents ouvrages numérisés en sélectionnant un feuilletage par auteur ou par série. Par ailleurs, trois modes de recherche sont proposés : la « recherche simplifiée », qui offre deux index déroulants (séries et noms de l’éditeur), la « recherche par page », qui permet d’accéder à une page dans son contexte, et « la recherche approfondie », qui permet la combinaison de huit clés de recherche.
CNUM
La mise en œuvre du projet de bibliothèque virtuelle, Conservatoire numérique des arts et métiers (CNUM4) est le fruit d’un partenariat entre trois institutions du Centre national des arts et métiers (CNAM) : la bibliothèque, le centre d’histoire des techniques (CDHT/EHESS) et le centre d’études et de recherche en informatique (CEDRIC) du CNAM.
Grâce à la numérisation des ouvrages rares, fragiles, précieux conservés dans les réserves de la bibliothèque du CNAM et de périodiques francophones traitant des sciences et des techniques, de l’économie et de la sociologie appliquées, le CNAM ouvre au public le fonds patrimonial de sa bibliothèque. Le conservatoire numérique s’adresse aux chercheurs et aux enseignants en histoire des sciences et des techniques, en épistémologie, en didactique, en offrant à la fois des textes et une documentation iconographique spécifiques.
Le CNUM fait aussi acte de vulgarisation scientifique en remplissant l’une des missions fondamentales du CNAM, la diffusion du savoir et la reconnaissance du patrimoine scientifique et technique francophone. Associée à un ensemble d’outils bibliographiques, la bibliothèque numérique offre la possibilité de multiplier les recherches à l’intérieur d’un corpus de textes, de rassembler et de confronter simultanément textes et images.
Liberfloridus
Fruit d’une collaboration entre les bibliothèques détentrices de fonds médiévaux, le CNRS (Institut de recherche et d’histoire des textes), le Centre informatique national de l’enseignement supérieur, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (SDBD), le fonds Liberfloridus5 a pour ambition de proposer la consultation de l’ensemble des enluminures des manuscrits médiévaux conservés dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur.
Le fonds Liberfloridus recense, pour l’heure, les manuscrits enluminés issus des collections des bibliothèques Mazarine et Sainte–Geneviève. Il représente près de 1 600 manuscrits et 31 000 images, toutes consultables par feuilletage.
Un travail d’indexation de ces enluminures est en cours de réalisation pour permettre d’effectuer des recherches iconographiques précises sur ce vaste corpus.
Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean–Pouilloux
La bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée6 a initié un projet de numérisation couvrant les thèmes de recherche de ses équipes. Pour l’instant, une cinquantaine d’ouvrages, datant pour la plupart du xixe et du début du xxe siècle, ont été sélectionnés et mis en ligne dans les domaines de l’égyptologie et de la civilisation gréco–latine, qu’il s’agisse d’histoire, d’archéologie ou de textes classiques.
Pour accéder aux documents, il est possible d’effectuer un feuilletage à partir d’une liste à trois entrées (auteur/titre/année), chaque critère offrant une possibilité de tri. Sont également proposées : la « recherche avancée » (combinaison de huit critères, dont deux critères « mot sujet »), et la recherche « parcours géographique », les documents qui traitent des zones géographiques concernées (Monde gréco–romain, Proche–Orient et Égypte) étant présélectionnés et classables également par titre, auteur, année.
Medic@
Réalisée par le service d’histoire de la médecine de la bibliothèque interuniversitaire de médecine (BIUM), la collection Medic@7 réédite, sous forme électronique accessible gratuitement en ligne, des documents anciens appartenant pour la plupart au fonds de la bibliothèque : monographies, thèses, articles, périodiques, manuscrits.
Pour faciliter la recherche au sein de ce vaste corpus, la collection Medic@ est structurée en différentes séries, elles–mêmes subdivisées en dossiers. Le « Corpus des médecins de l’Antiquité » rassemble les éditions majeures des auteurs anciens (Hippocrate, Galien, Oribase...) établies depuis la Renaissance jusqu’au xxe siècle et possédées par la BIUM.
La série « Spécialités, doctrines, domaines » rassemble les textes fondateurs des spécialités, des doctrines, des domaines ; la série « Médecins et savants » regroupe des dossiers monographiques consacrés aux œuvres de personnalités remarquables ; la série « Épidémies, maux et maladies » contient des dossiers consacrés à des pathologies ou des maux, la série « Histoire de la médecine et de ses institutions » est consacrée aux ouvrages d’histoire ou à des sources concernant les institutions.
Différents modes de recherche sont proposés (recherche par mot du titre, nom d’auteur, année ; accès à des dossiers puis rebonds sur des lots de notices ; recherche plein texte au sein des dictionnaires numérisés).
NORDNUM
Porté par le service commun de la documentation de Lille–III, l’objectif du projet Nordnum8 est la constitution d’une bibliothèque numérique d’histoire régionale réunissant un corpus d’ouvrages du xixe et du début du xxe siècle, libres de droit et accessibles en texte intégral sur Internet. La numérisation doit s’opérer sur une centaine de titres par an tout en assurant des opérations « à la carte » pour répondre à des besoins d’enseignement ou de recherche. Ces fonds, numérisés dans un double souci de valorisation et de conservation, offrent au public des textes rares et difficilement accessibles. Les ouvrages et périodiques du fonds de la « Société industrielle », par exemple, sont menacés de destruction étant donné la fragilité des papiers.
Ce projet concerne un public divers : étudiants (de nombreux mémoires de maîtrise sont soutenus en histoire régionale), enseignants–chercheurs, érudits et chercheurs locaux, chercheurs en histoire des techniques.
Grâce à une structuration des données et des documents s’appuyant sur le langage XML, différentes fonctionnalités de recherche sont offertes : recherche en mode texte sur les notices, les index et les tables des matières des documents numérisés. Outre l’affichage et le feuilletage, il est possible d’imprimer la ou les pages recherchées ainsi que de télécharger les ouvrages.
NUMDAM
Piloté par la cellule MathDoc pour le compte du CNRS, le programme NUMDAM9 propose la numérisation rétrospective de fonds mathématiques publiés en France.
La première phase de numérisation a concerné six revues françaises de mathématiques : les « Annales de l’Institut Fourier » – depuis 1949, les « Annales scientifiques de l’École normale supérieure » – depuis 1864, le « Bulletin de la Société mathématique de France » – depuis 1873, la revue « Journées Équations aux dérivées partielles » – depuis 1975, « Mémoires de la Société mathématiques de France » – depuis 1964, « Publications mathématiques de l’Institut des hautes études scientifiques » – depuis 1959.
Pour chaque revue concernée, la totalité des volumes publiés jusqu’en l’an 2000 a été convertie au format numérique. Les articles eux–mêmes sont disponibles pour la consultation en ligne. Actuellement, 253 000 pages ont ainsi été numérisées. Pour favoriser le libre accès aux données bibliographiques et au texte des articles qui y sont parus, il est possible de rechercher directement un article par nom d’auteur, mots du titre ou mots‑clés présents dans le texte. Il est également possible de feuilleter les sommaires de l’ensemble des volumes.
Persée
Lancé à l’initiative du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avec le soutien technologique du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES), et réalisé par un consortium d’établissements publics piloté par l’université Lyon‑II, le portail Persée10 a pour objectif d’accroître la visibilité de la recherche française en sciences humaines et sociales (SHS) et d’améliorer son intégration dans l’offre scientifique internationale.
La première démarche entreprise a été la numérisation de collections rétrospectives d’une dizaine de revues emblématiques de différentes disciplines en SHS parmi lesquelles les « Annales d’histoire économique et sociale », les « Archives de sciences sociales des religions », la revue « Bibliothèque de l’École des chartes », la revue « L’Homme », la « Revue française de sciences politiques », la revue « Vingtième siècle », la « Revue économique », la « Revue de l’art », « Matériaux pour l’histoire de notre temps », « Mélanges de l’École française de Rome ».
Table des matières d’un numéro de revue, L’HOMME, Éditions de l’EHESS
Le portail Persée associe à la diffusion en mode image et en mode texte de l’intégralité de ces collections, des services spécifiques de consultation et de recherche adaptés aux besoins de la communauté scientifique. Son accès est libre et gratuit, dans le respect des droits des auteurs – dont l’accord pour une diffusion électronique de leurs contributions est requis.11
PôLiB
Avec le fonds PôLiB12, le Pôle universitaire européen Lille‑Nord‑Pas‑de‑Calais a l’ambition de permettre la (re)constitution de fonds thématiques reflétant les principales disciplines universitaires et leur évolution dans l’histoire.
Par la numérisation directe et la mise en ligne de livres imprimés avant 1820, il s’agit de mettre en valeur un patrimoine fragile et difficilement communicable au public. Les ouvrages numérisés proviennent du fonds de la réserve ancienne commune aux universités Lille‑I, Lille‑II et Lille‑III, conservée dans le SCD de Lille‑III. Parmi les fonds associés, on trouve également ceux des bibliothèques municipales de Douai, de Lille ainsi que de la bibliothèque de l’Université catholique de Lille.
La plus‑value apportée au fonds PôLiB est offerte par l’accompagnement scientifique des ouvrages mis en ligne, inclus dans l’indexation des ouvrages. Il est ainsi possible d’aborder les documents sous leurs aspects les plus divers.