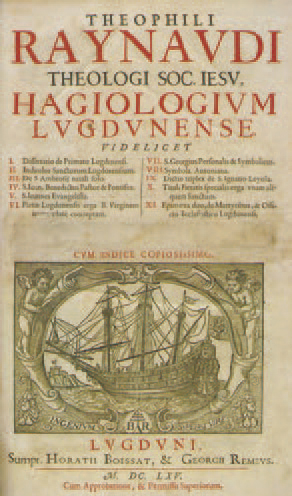L'Université Jean-Monnet est une université jeune, de 12 800 étudiants, qui regroupe toutes les disciplines à l’exception de la pharmacie. L’enseignement et la recherche en sciences humaines et sociales sont regroupés sur un même site au centre-ville, ce qui facilite la coopération documentaire.
À coté d’une bibliothèque universitaire regroupant les collections de droit, lettres, sciences humaines et sociales, se sont développés, entre 1970 et 1985, des centres de recherche qui ont constitué des collections réparties dans les différents locaux universitaires du centre-ville. S’il existait dès 1980, des accords portant sur la politique d’acquisitions avec deux de ces centres, le souci de mettre en place une politique documentaire cohérente s’est concrétisé, en 1985, par le regroupement de tous les centres de recherche en sciences humaines dans un bâtiment unique appelé Maison Rhône-Alpes des sciences de l’homme situé près de la bibliothèque de droit et lettres, et le catalogage de leurs collections par des moniteurs payés et encadrés par le SCD. À l’heure actuelle, après regroupement, le bâtiment abrite sept centres de recherches en littérature et sciences humaines1 dans lesquels travaillent 82 chercheurs et se préparent 97 DEA et thèses. Leurs bibliothèques sont ouvertes aux étudiants de maîtrise et de 3e cycle et à tous les chercheurs et enseignants des autres universités et organismes de recherche travaillant sur les domaines qu’elles couvrent, et aussi à toute personne ayant un motif sérieux de consulter un document. Elles participent au prêt entre bibliothèques pour les articles de périodiques et de façon ponctuelle pour les ouvrages impossibles à obtenir ailleurs. Les fonds représentent 17 100 ouvrages et 116 titres de périodiques, dont trois uniques en France, et plus de 6 000 tirés à part. Ces bibliothèques font partie des bibliothèques associées au SCD, car elles ont un budget propre alimenté par des crédits universitaires ou le CNRS, mais elles bénéficient de l’aide du SCD pour leur gestion assurée par un assistant ingénieur dépendant du SCD et la conservation de leurs collections patrimoniales financée sur crédits obtenus dans le cadre de la dotation contractuelle. S’il est très difficile de définir un plan de collection dans une université pluridisciplinaire de la taille de celle de Saint-Étienne, il existe néanmoins des critères de sélection des documents, la bibliothèque universitaire achetant en priorité les textes, les centres de recherche, les critiques et les documents patrimoniaux. D’autre part, l’existence d’une base bibliographique unique permet d’éviter tout doublon intempestif. Ces centres disposent de documents de référence sur cédéroms et DVD consultables en monoposte. Ils ont également accès au réseau de cédéroms du SCD et aux bases de données et périodiques en ligne. Si les étudiants en DEA et les thésards bénéficient d’une formation à ces nouveaux outils et commencent à les utiliser, il faut constater qu’à une ou deux exceptions près, les enseignants-chercheurs travaillant dans ces centres se sentent peu concernés par ces nouveaux supports, sont peu réactifs au sein de la commission sur la documentation numérique et réticents à l’idée de devoir cofinancer la documentation numérique. Il est certain qu’un effort d’information et de formation doit être réalisé à leur intention.
Théophile Raynaud. - Hagiologium lugdunense… - Lyon : H. Boissat et G. Remeus, 1665.
Centre européen de recherches sur les congrégations et ordres religieux.
Système universitaire de documentation
Les bibliothèques de recherche, jusqu’en 1985, ne disposaient que de catalogues embryonnaires ayant chacun leur propre logique. Le premier travail a été de cataloguer les collections et d’insérer un double de chaque fiche dans le « catalogue auteurs » de la bibliothèque. Par ailleurs, un recensement systématique de tous les périodiques reçus à l’université dans le cadre de l’élaboration d’un catalogue collectif des périodiques de la Loire a été entrepris. Les collections ainsi identifiées ont été ensuite reversées dans le CCNPS, devenu le Sudoc-PS (Système universitaire de documentation pour les publications en série). En 1990, lorsque la bibliothèque universitaire s’est informatisée, ces bibliothèques de recherche ont été naturellement prises en compte et leur fonds progressivement « rétroconvertis » dans la base locale, en utilisant le cédérom BN-Opale, pour les collections françaises à partir de 1970. Cette « rétroconversion » est presque achevée – 15 800 sur les 17 100 documents. Avant reversement dans le Sudoc, les notices ainsi créées ont été extraites du catalogue local pour que les localisations soient chargées dans la base BN-Opale. Lorsque la bibliothèque universitaire a basculé dans le Sudoc, en mai 2001, quatre de ces bibliothèques qui possédaient déjà un RBCCN ont choisi de participer à ce réseau et tout le catalogage de leurs documents très spécialisés passe maintenant par le Sudoc. Pour la responsable de ces bibliothèques, le recours au Sudoc constitue une avancée certaine : même si la plupart des documents ne figurent pas dans la base bibliographique, le recours aux réservoirs de notices est très apprécié mais représente un lourd travail de correction. Une cinquième bibliothèque, essentiellement patrimoniale, souhaite maintenant entrer dans ce réseau. Pour l’heure, les demandes de prêt entre bibliothèques, en sciences de l’homme, sont minimes et concernent essentiellement les périodiques.
Mais, pour les enseignants-chercheurs, le Sudoc représente un moyen commode d’identifier et de localiser des documents ; il leur est aussi utile pour élaborer des bibliographies.