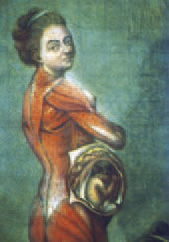Une lettrine dans l’ouvrage de Dioscoride
L'Académie nationale de médecine vient de fêter un centenaire : celui de son installation, le 25 novembre 1902, dans l’hôtel de la rue Bonaparte construit par Justin Rochet, architecte de l’hôpital de la Pitié1. L’activité de la bibliothèque est étroitement liée à celle de l’académie. Placée sous la tutelle du secrétaire perpétuel, elle dépend du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Bibliothèque patrimoniale, on trouve ici les racines des évolutions médicales modernes. Chargée de la documentation de l’académie dans le domaine des sciences biomédicales, ses pôles d’excellence sont l’histoire de la médecine, la santé publique et l’hygiène, le thermalisme, l’obstétrique et la gynécologie.
Dès la parution du Bulletin de l’Académie de médecine, en 1836, l’académie a organisé des échanges, dans le double souci de faire connaître ses travaux, en France et à l’étranger, et d’enrichir ses collections. Ces échanges ont largement contribué à la constitution du fonds de périodiques. Ils représentent la moitié des 500 titres en cours. Ces périodiques, source d’une grande richesse pour l’histoire de la médecine, constituent un des points forts de la bibliothèque ; ils sont pour la majeure partie répertoriés dans le Sudoc-PS – Système universitaire de documentation pour les publications en série. Depuis novembre 2002, la bibliothèque de l’académie a entrepris, faute de place, le désherbage de ses périodiques. Ce grand chantier devrait durer plusieurs années. Ses archives constituent des sources très importantes non seulement pour l’histoire de la médecine, mais également pour l’histoire sociale et l’histoire des mentalités. La bibliothèque s’est également vue confier par l’académie la garde de ses collections artistiques ; elle dispose d’une documentation iconographique très importante et très sollicitée. En 1943, le « Handbook of medical practice » plaçait la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine au septième rang des bibliothèques médicales du monde.
DIOSCORIDE. De medicinali materia libri sex, Joanne Ruellio Suessionensi interprete… Fran[coforti], apud Chr. Egenolphum, 1543. RUEL (Jean) Ed.
Informatisation de la bibliothèque
Riche aujourd’hui de 400 000 volumes, la bibliothèque a su s’adapter à l’évolution de l’information scientifique et technique2. Le catalogue ancien (1471-1960) est disponible, depuis 2002, sur le site internet. Il s’agit de 65 000 fiches de monographies et de tirés à part, qui ont été numérisées, indexées et sont interrogeables par noms d’auteurs ou par titres (pour les anonymes). Ces 65 000 fiches doivent faire l’objet d’une « rétroconversion » en 2003 et seront versées dans les catalogues collectifs. La bibliothèque est reliée au RAP – Réseau académique de Paris – depuis février 2002.
Le Sudoc et la bibliothèque de l’Académie de médecine
La bibliothèque de l’académie faisait partie du groupe 4 d’OCLC. Le basculement a eu lieu le 23 janvier 2002 ; 16 870 notices provenaient d’OCLC et 3 302 notices du CCNPS devenu le Sudoc-PS. Depuis cette date les documents sont signalés directement dans le Sudoc et les notices bibliographiques sont transférées toutes les semaines dans l’Opac. L’outil SUPEB, en juin 2002, a remplacé PEB2000. Plus de 27 300 notices de monographies sont dans le Sudoc.
Deux postes de la bibliothèque sont équipés du logiciel WinIBW. Une troisième licence a été demandée à l’ABES, afin de traiter les 8 000 ouvrages en attente de catalogage.
Projets
En 2003, nous prévoyons le catalogage rétrospectif de 8 000 ouvrages du xixe et début du xxe siècles par une société prestataire de services ; ces ouvrages seront traités directement dans le Sudoc.
GAUTIER D’AGOTY (Jacques F.). Anatomie des parties de la génération de l’homme et de la femme, Paris : J.‑B. Brunet et Demonville, 1773.
On peut dire que grâce à tous ces outils et principalement depuis la création du site internet de l’académie, la mise en ligne de nos catalogues et le basculement dans le Sudoc, la bibliothèque, peu connue du grand public et quelque peu marginalisée, a vu son public traditionnel – académiciens, historiens de la médecine, thésards, enseignants, chercheurs, journalistes etc. – s’élargir. La bibliothèque reçoit tous les jours, sur sa messagerie électronique, des demandes de recherches bibliographiques et biographiques de France et de l’étranger, demandes souvent suivies de consultations sur place. L’Académie, en 1998, a fait rénover la salle de lecture de sa bibliothèque. Cette rénovation a su garder, à la fois, l’esprit du lieu, en conservant le plus possible le décor originel, tout en le modernisant afin d’offrir aux lecteurs un confort leur permettant d’accéder aux nouvelles technologies et de découvrir la richesse des fonds patrimoniaux.


![DIOSCORIDE. De medicinali materia libri sex, Joanne Ruellio Suessionensi interprete… Fran[coforti], apud Chr. Egenolphum, 1543. RUEL (Jean) Ed.](docannexe/image/3800/img-2.jpg)