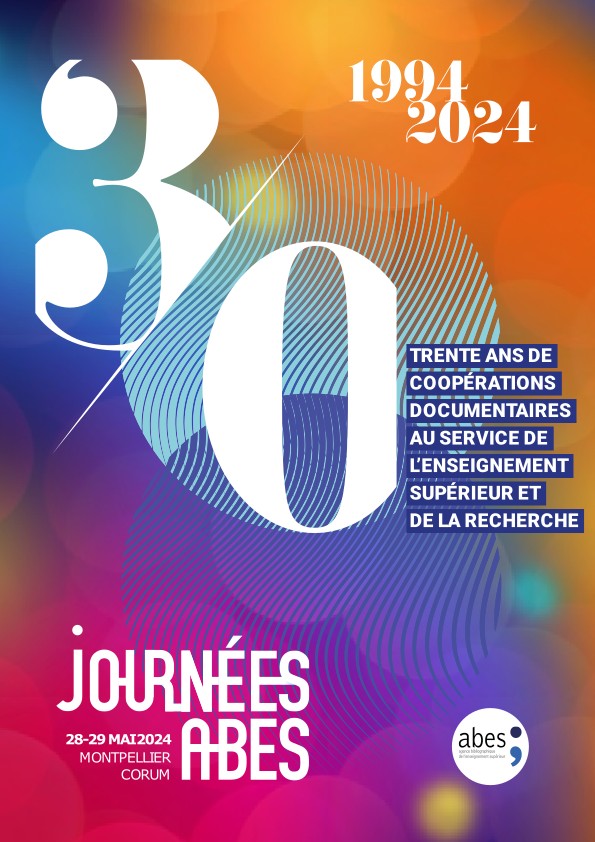Les bibliothécaires seront les premiers à reconnaître qu’avec l’augmentation des volumes de données il ne suffit plus d’identifier ses ressources : avoir une politique de gestion des données est devenu indispensable. La différence n’est pas uniquement sémantique : il s’agit non seulement de produire des notices de qualité, mais d’avoir également une vision globale de la cohérence du catalogue. Cette vérité du monde des bibliothèques est désormais devenue une vérité du monde des organisations en général, publiques et privées.
L’ouverture sur le web et la prééminence du numérique aujourd’hui dans tous les services, avec la circulation des données qu’elles induisent, rendent ce besoin encore plus prégnant : il nous faut des données fiables et dont la qualité soit garantie, des données documentées pour en faciliter l’usage, des données dont le cycle de vie est géré, et la collecte et l’accès sont sécurisés. En ce sens, les pratiques traditionnelles de notre profession s’étendent désormais aux données en général, et nous permettent de contribuer efficacement à résoudre ces besoins « étendus » des organisations.
L’enseignement supérieur et la recherche n’échappent pas à cette évolution de fond. Ses établissements ont désormais bien identifié, en particulier, que l’emploi conjugué d’identifiants internationaux et nationaux constitue la clé de voûte de la circulation des données, de leur meilleure consolidation, et de leur plus grande visibilité (toujours plus fondamentale dans le pilotage des organisations). Il est également largement admis aujourd’hui qu’un modèle conceptuel, un schéma et un cadre clair sur la gouvernance des données sont des briques indispensables à la construction d’une politique globale des données.
Nos pratiques documentaires sont en voie d’adoption, pas nécessairement notre vocabulaire : entreprises et organisations ne recrutent pas des bibliothécaires ou des catalogueurs, elles s’arrachent data scientists et « intendants des données ». C’est donc un « intendant des données », en cours de recrutement, qui pilotera la contribution de l’Abes au nouveau projet de constitution d’un référentiel des structures de l’enseignement supérieur et de la recherche (organisations et laboratoires de recherche en particulier), dont le MESR assure la maîtrise d’ouvrage. L’objectif est de contribuer ainsi à la lisibilité et à la visibilité nationale et internationale du paysage de la recherche en France et de faciliter les échanges en matière de données de référence entre les laboratoires, les établissements, les financeurs, les infrastructures de recherche…
Le projet d’établissement 2024-2028 de l’Abes le notait : nous devons « prendre en compte les besoins de communautés qui, en dehors du secteur documentaire et en lien avec celui-ci, pourraient bénéficier des métadonnées que nous produisons collectivement. C’est en particulier le cas pour les données utiles au pilotage des établissements de l’enseignement supérieur, qui ne sont pas aujourd’hui couramment diffusées dans les systèmes d’information de l’enseignement supérieur et de la recherche ».
Ce projet de référentiel des structures de l’ESR s’inscrit dans la droite lignée des travaux similaires entrepris de longue date sur les personnes avec IdRef et Orcid. Il contribue ce faisant au mouvement plus global du milieu documentaire, qui sort de ses murs pour mettre à disposition ses données (et ses compétences) au service de la recherche.
Nul doute que nos missions historiques, dont on renouvelle le vocabulaire et le cadre, ne trouvent là matière à de nouvelles explorations et de nouveaux axes de collaboration.