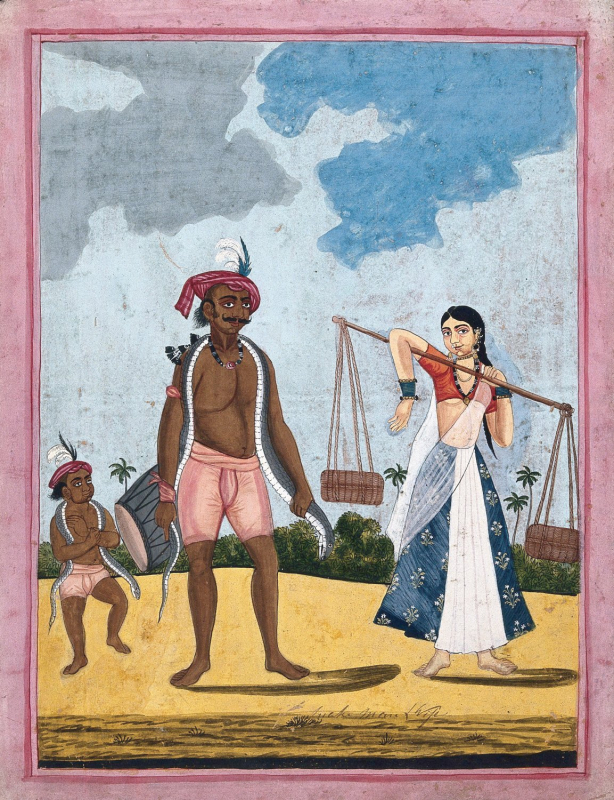La publication récente, pour les deux principaux versants de la fonction publique, d’un Référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales (ministère de la Culture, SLL, 2022)1 et d’un Dictionnaire des compétences et connaissances des bibliothèques de l’ESR (ADBU, 2024)2 rappelle utilement l’effet transformant des mutations ou transitions technologiques, sociales et sociétales, sur les représentations du métier. L’inventaire des journées professionnelles, webinaires, tables rondes, enquêtes, études et rapports consacrés à cette question est désormais difficile tant ils sont nombreux. L’écart se creuse entre la nature des profils d’emploi occupés ou recherchés au sein des établissements et l’image d’un métier qui continue d’être défini autour du socle de la collection, du signalement, de l’indexation et de la mise à disposition de la collection au public, et de leurs différentes déclinaisons contemporaines. Il se creuse aussi spécifiquement pour les conservateurs, écartelés entre les besoins d’expertises nouvelles suscités par les actions du terrain et une identité professionnelle de plus en plus centrée sur sa condition managériale sous l’effet des réformes de l’action de l’État.
Ces compétences émergentes ou recherchées opposent à une représentation figée le dynamisme d’identités professionnelles qui ne cessent de se recomposer pour répondre à de nouveaux impératifs ou s’adapter aux évolutions des publics, des contextes et des techniques. Des référentiels actualisés permettent de relier une chaîne complexe d’acteurs au sein d’un métier de la fonction publique : présidences et directoires des concours nationaux, opérateurs de formation initiale et continue, et employeurs. Ils sont par ailleurs utiles aux professionnels dans la description de leur parcours et pour l’explicitation de leurs acquis d’expérience. Le plan national pour la science ouverte est aujourd’hui un parfait exemple de ces cycles d’actualisation du métier. Des profils nouveaux, comme les intendantes ou intendants de données, font ainsi leur apparition dans les offres d’emplois des bibliothèques.
Charmeur de serpents, gouache attribuée à un artiste de Tanjore (Thanjavur) - Inde, ca. 1840
Crédit illustrations Wellcome collection
Quadriller le terrain
Les démarches du service du livre et de la lecture (SLL) et de l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques et de la documentation (ADBU) ont en commun de prendre appui sur les retours d’expérience de professionnels pour assurer ces rédactions. Idéalement, ce type de veille est confié à des observatoires du métier et des compétences. Leur rôle consiste à éclairer les organisations (collectivités, établissements, services) sur les grandes tendances d’évolution d’un secteur d’activité, des métiers et qualifications nécessaires. Leurs travaux permettent d’inscrire la formation initiale et continue du secteur dans une logique prospective et adaptative, de répondre plus rapidement aux enjeux de transformation du métier, et enfin de valoriser le métier. Le CNFPT dispose ainsi d’un observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences territoriales lequel produit et met à disposition des agents, élus et collectivités une large documentation produite (guides pratiques et méthodologiques, études) qui permet une analyse dynamique des métiers territoriaux.3 Il n’existe rien de tel dans l’immédiat pour les métiers de la fonction publique d’État, mais il faut reconnaître les limites des travaux conduits par ces observatoires qui peinent à fournir la granularité nécessaire à certains métiers, confrontés à des transformations profondes et permanentes de leur activité, et c’est le cas pour les métiers des bibliothèques. Multiplier à l’infini ces structures n’est guère envisageable. Elles réclament des moyens spécifiques et agissent selon des processus complexes qui mobilisent en eux-mêmes des compétences diverses. Mais des alternatives existent, à l’intérêt certain. Pour les bibliothèques, les opérateurs de formation et les associations professionnelles se sont emparés de cette question et ont mis en place des structures ad hoc : l’initiative du dictionnaire des compétences a été prise en charge par la commission permanente métiers et compétences de l’ADBU. Le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales a été élaboré en concertation et coconstruction, notamment avec les associations professionnelles (ABF, ABD, ADBGV…).
Une collaboration plus étroite et systématique entre les opérateurs de formation et les associations serait sans doute à encourager car elle permet une meilleure diffusion et une appropriation immédiate des travaux conduits. Les associations professionnelles ont l’avantage d’être à la croisée des employeurs et des agents, les opérateurs de formation l’intérêt d’asseoir leurs programmes pédagogiques et leur cadre d’évaluation sur une approche par compétence.
Une approche par enquête à généraliser ?
« Aucun emploi type ne correspond […] à la réalité ni à la diversité des activités réalisées par les personnels des bibliothèques d’aujourd’hui »4
En matière d’approche locale, je voudrais enfin évoquer un travail remarquable publié par Médiat Rhône-Alpes en 2022, qui pointe l’incomplétude de la description des emplois types des catégories B et C de la filière, et par conséquent des profils de poste au sein des services. La méthode utilisée, un travail d’enquête adressée directement aux agents affectés dans les établissements du territoire Rhône-Alpin (pour les catégories C) et national (pour les catégories B), a permis de mettre en lumière le poids naissant du pilotage et de tâches managériales implicites dans le quotidien de ces agents. Il témoigne d’une évolution en cours à rebours de l’image « conservatrice » que l’on pouvait avoir des fonctions exercées par les personnels de ces catégories : l’émergence d’activités d’encadrement intermédiaire, à côté des fonctions plus traditionnelles d’exécution. La reconduction de cette enquête, amorcée en 2018, permettrait sans doute de vérifier le caractère durable et permanent des évolutions constatées, et une démarche similaire portant sur l’évolution de la catégorie A offrirait une vue complète de l’impact des facteurs externes et internes (fusions, projets de service) sur les profils de poste occupés. L’émergence de portraits professionnels réalistes pour tous les corps permet à la fois de doter l’ensemble des agents d’une capacité de positionnement et de projection professionnelle, et d’inciter tous les acteurs à adapter leur approche en matière de recrutement et d’accompagnement.
Gérer, c’est prévoir
On ne souligne pas assez souvent les propriétés utiles de cette cartographie des compétences pour les établissements et leurs bibliothèques. Elle facilite la rédaction des profils de poste et des offres d’emploi. Elle sert à la définition des besoins de formation des agents et des services. Elle sécurise les recrutements. Et elle constitue avant tout une base commune à tous les acteurs, facilitant la mise en place d’une gestion dynamique et planifiée de leurs besoins en compétences et des parcours professionnels des agents. On sait aujourd’hui ce que la mise en place du mode projet pour les organisations a apporté en souplesse et en efficacité dans leurs actions. Aborder sa gestion RH sous l’angle du mode GEPP5 permet de concevoir la gestion des ressources humaines comme un projet transformateur, où les campagnes de promotion, la surveillance des pyramides des âges et les changements d’organigrammes concourent à une meilleure prise en compte du capital humain dans les ressources qui conditionnent la réussite des projets d’établissement.
Le format éditorial adopté par l’ADBU pour son dictionnaire des compétences dit la nécessité de doter ces outils de garanties d’actualisation des informations, et on aurait d’ailleurs souhaité que son appellation soit affirmée comme telle : « le dictionnaire permanent des compétences et connaissances en bibliothèques de l’ESR ». L’alimentation continue de cette base de connaissance conditionne en effet sa capacité à anticiper les évolutions actuelles et futures du métier. Il est à espérer qu’elle permettra aux tutelles de bâtir une exigence globale, cohérente, de l’entrée dans le métier au pilotage des parcours.
Le défi de l’injonction paradoxale
L’intégration de l’Enssib au tronc commun de formation des cadres supérieurs du service public coordonné par l’INSP et la nécessité de réfléchir à l’ajout de nouvelles expertises dans les programmes de formation initiale des corps de la catégorie A de la filière dessinent un futur professionnel aujourd’hui incertain et ambigu. L’intégration du corps des conservateurs à la réforme de la haute fonction publique appelle une formation managériale plus stratégique et généraliste, quand la science ouverte rappelle quant à elle le besoin de disposer encore au sein de ce corps de compétences et de connaissances spécialisées afin de préserver pour ce métier un positionnement efficace à l’interface des communautés de recherche et des métiers du développement informatique. Et ce n’est qu’un exemple.
Les conseils de perfectionnement adossés aux diplômes ou aux dispositifs de FTLV constituent certes des appuis précieux pour mesurer l’adaptation des diplômes et programmes de formation aux besoins du terrain, mais ils ne permettront pas seuls de résoudre ou dépasser cette contradiction dans les attentes. La solution réside sans doute dans une diversité d’ajustements à réaliser :
- Articuler fortement, pour la catégorie A, formation initiale et formation continue, car une partie de la solution réside dans un prolongement de la durée de formation sur le temps de l’exercice professionnel, dans la logique des parcours certifiants déjà mis en œuvre.
- Renforcer l’offre de formation continue à destination des catégories B et C pour que l’effort de transformation puisse être plus aisément réparti au sein de l’ensemble des services.
- Ouvrir les bibliothèques à d’autres métiers (archivistes, scientifiques et ingénieurs des données, ingénieurs pédagogiques, etc.), ce qui aura inévitablement un impact sur les approches managériales.
- Reconsidérer la nature et les modalités des épreuves des concours nationaux, à l’exemple de ce qui est en réflexion pour la catégorie B dans le cadre de la transition bibliographique.
Pour les concours de conservateurs d’État des bibliothèques, l’exercice sera délicat : il faudrait parvenir à rapprocher ses épreuves de celles des concours des écoles de service public intégrées au tronc commun INSP sans sacrifier au maintien d’une exigence en matière de connaissances scientifiques, qui conditionne toujours largement l’adaptation immédiate des conservateurs à la réalité du terrain. Cet équilibre est nécessaire pour préserver la capacité du métier à conserver son étonnante plasticité face aux évolutions de contexte.