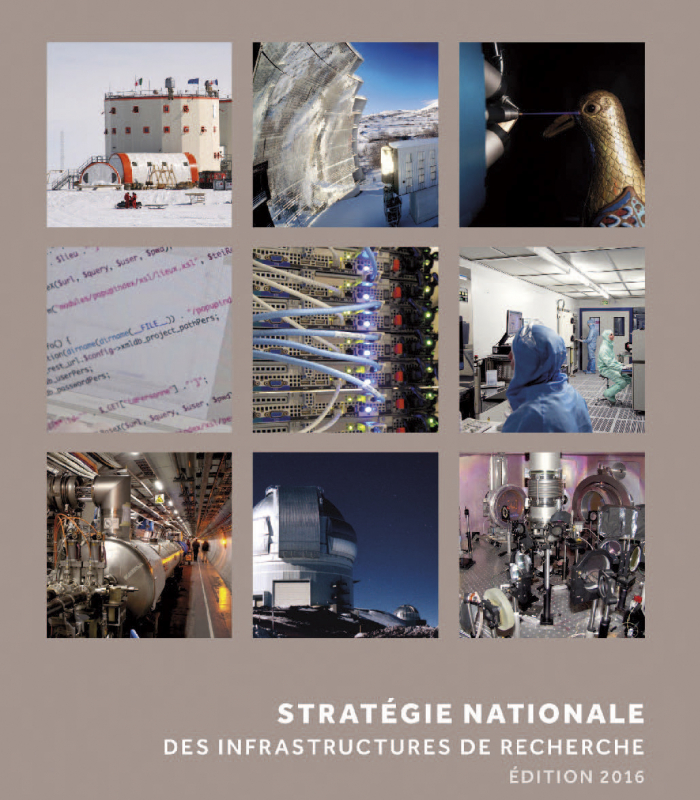En cohérence avec la volonté européenne de faciliter l’open access, la France se dote d’outils stratégiques : une feuille de route où sont inscrites les infrastructures de recherche d’envergure nationale, un comité de pilotage numérique et une loi, la bien nommée loi pour une République numérique. Une évolution très attendue par la communauté scientifique.
La politique nationale de l’information scientifique et technique est fondée sur la volonté d’ouvrir l’accès aux résultats de la recherche. Mais favoriser l’accès ouvert amène à traiter un sujet à multiples facettes, ce qui demande des compétences variées et spécialisées et une organisation articulée autour de structures fédératrices, représentatives d’enjeux de trois ordres, économique, juridique et technique.
Les premiers sont une préoccupation constante des établissements : le poids des budgets de la documentation numérique est tel que, pour maintenir un niveau d’offre ambitieux, l’accélération du libre accès devient incontournable.
Les enjeux juridiques imposent le respect du droit de la propriété intellectuelle et les modifications législatives nécessaires pour aller vers l’accès ouvert.
Les enjeux techniques sont quant à eux fondamentaux pour promouvoir une large diffusion de l’IST et répondre aux besoins de la recherche.
La stratégie nationale de l’IST s’incarne dans des instances et des organisations qui fédèrent largement les acteurs de cette politique d’accès ouvert. Ainsi, les infrastructures de recherche suivent une feuille de route nationale et travaillent en lien étroit avec l’Europe. Chacune en déduit des programmes et des objectifs, évalués et remis à jour de façon régulière. Afin de piloter au bon niveau la transformation numérique de l’enseignement supérieur, le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) a créé un comité d’orientation du numérique, dont une des composantes est la Bibliothèque scientifique numérique (BSN). Enfin, la promulgation de la loi pour une République numérique fait diminuer la durée des barrières mobiles de la diffusion des textes scientifiques et facilite la fouille de données.
Un « tableau de bord » qui fournit à l’État une base solide pour des plans d’action pluriannuels
TGIR, IR, projets… sur la feuille de route
Rédigée dans le but de fournir au MENESR des outils nécessaires au pilotage des grands instruments de la recherche, la première feuille de route française des infrastructures de recherche a été publiée en 2008, puis mise à jour en 2012 et en 2016. Elle s’adresse aux Alliances et organismes ou établissements sous tutelle du ministère et les décline en quatre modèles : organisations internationales, très grandes infrastructures de recherche (TGIR), infrastructures de recherche (IR) et projets. La majorité des États membres de l’Union européenne se livrent au même exercice stratégique et contribuent à la feuille de route stratégique européenne.
Les infrastructures de recherche relèvent des choix des différents opérateurs de recherche et sont mises en œuvre par eux, qu’il s’agisse des Alliances ou de leurs membres, ou d’établissements publics en raison de leurs missions particulières. Quatre-vingt-quinze d’entre elles ont été retenues dans le cadre de la feuille de route ESFRI 2016 (European Strategic Forum for Research Infrastructures Roadmap 2016). Parmi elles, quatre grandes infrastructures – CollEx-Persée, HAL, Numédif et OpenEdition – forment le chapitre « Information scientifique et technique ».
Les TGIR relèvent également d’une stratégie gouvernementale. Elles sont nationales ou font l’objet de partenariats européens ou internationaux, notamment par leur engagement dans la feuille de route du Forum stratégique européen. Instruments majeurs dans les réseaux de collaboration industrielle et d’innovation, elles se placent sous la responsabilité scientifique des opérateurs de recherche. Dans le domaine des sciences humaines et sociales, Huma-Num s’inscrit dans les TGIR. Elle vise à faciliter le tournant numérique de la recherche en sciences humaines et sociales, et est soutenue par l’Alliance Athena.
La feuille de route 2016 des infrastructures de recherche présente clairement les enjeux de la thématique « Information scientifique et technique » : « La production, le stockage et la mise à disposition de données sont des paramètres essentiels de la recherche d’aujourd’hui ; c’est particulièrement vrai pour les infrastructures de recherche. Certaines sont focalisées sur le numérique, en tant qu’objet des recherches elles-mêmes ou pour en développer les outils de calcul intensif, de transmission ou de stockage des données. D’autres ont pour but de mettre à disposition des bases de données, qu’elles soient brutes ou enrichies. Dans tous les cas, elles tendent à devenir découvrables, utilisables et interopérables par une communauté toujours plus large. Dans certains domaines, cette mise à disposition est immédiate et entièrement publique, suivant une directive européenne. Dans d’autres, une période d’embargo est la pratique courante avant dissémination. »
Les quatre piliers du schéma numérique
Le Codornum (Comité d’orientation numérique) est l’organe décisionnel, mis en place en 2014 par le MENESR afin de prendre des décisions d’orientation à un haut niveau stratégique et politique sur les sujets en relation avec la transformation numérique de l’ESR. Il s’assure, par un suivi régulier, que l’ensemble des dispositifs nationaux du numérique de l’ESR prenne les mesures adéquates en réponse aux orientations décidées.
Quatre comités de pilotage participent à cette instance : InfraNum, en charge de définir les orientations en matière d’infrastructures techniques nationales (calcul haute performance, datacenter, etc.) ; SIESR, le service interacadémique qui coordonne les évolutions et l’interopérabilité des systèmes d’information de l’enseignement supérieur et de la recherche ; le comité Formation, chargé en particulier de la coordination des portails ESUP et Fun-Mooc ; et enfin le comité BSN, chargé de la documentation et information scientifique et technique.
La BSN, créée en 2009 à l’initiative du MENESR, a pour mission de fédérer les acteurs des universités et organismes de recherche afin de permettre à l’ensemble des partenaires d’accéder, sous forme numérique, à une offre de ressources scientifiques abondante et à des outils de qualité. Elle met en réseau un certain nombre d’initiatives, avec une volonté de structuration destinée à dépasser les traditionnels obstacles liés à l’organisation française, très éclatée, de l’information scientifique et technique. Elle pilote des programmes de mutualisation des ressources électroniques organisés en segments, tel le programme Istex, qui concerne l’achat de ressources dans le cadre de licences nationales et la réalisation d’une plateforme autonome accessible à la communauté de la recherche. La BSN soutient les plateformes de libre accès comme HAL, Persée ou OpenEdition et des projets autour de la bibliométrie et de la mesure des usages des ressources numériques.
L’ouverture inscrite dans la loi
La loi pour une République numérique vise à favoriser l’ouverture et la circulation des données et du savoir, à garantir un environnement numérique ouvert et respectueux de la vie privée des internautes et à faciliter l’accès des citoyens au numérique. Promulguée le 7 octobre 2016 par le président de la République, elle paraît au Journal officiel du 8 octobre 2016.
Elle comprend des avancées significatives autour du TDM (text and data mining, ou fouille de données) et ouvre de nouveaux droits et de nouvelles facilités dans les accès à l’information issue de la recherche scientifique. Son article 30 entérine ainsi un arbitrage favorable à la recherche sur l’accès ouvert, permettant un droit de valorisation secondaire, sans remise en cause du droit d’auteur, ouvrant aux chercheurs la possibilité de mettre à disposition gratuitement la version de l’auteur « acceptée pour publication » (mais non travaillée par l’éditeur) d’un écrit scientifique, au terme d’un délai de six mois pour les STM et de douze mois pour les SHS.
En outre, l’article 38 introduit une nouvelle exception TDM, inscrite dans le code de la propriété intellectuelle et encadrée juridiquement par trois limitations : le TDM ne peut s’effectuer qu’à partir de corpus dont les contenus ont été acquis de façon licite ; il ne peut être pratiqué que pour « les besoins de la recherche publique » ; en est exclue « toute finalité commerciale ». Associés à la loi, deux décrets relatifs au TDM sont prévus. Leur objectif est de sécuriser juridiquement, techniquement et commercialement l’utilisation du TDM dans un équilibre respectant les intérêts et les besoins respectifs des chercheurs (larges extractions des ressources) et des éditeurs (contrôle des copies). La promulgation de cette loi est concomitante avec le travail sur la révision de la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique européen. En effet, le projet de directive présenté par la Commission européenne – et applicable à tous les États membres – conforte les formulations retenues par le législateur français en prévoyant une exception obligatoire au droit d’auteur, favorable au TDM.
La politique nationale de l’open access prend corps dans de nombreuses structures et projets – a priori foisonnants, mais qui répondent à la volonté de faciliter la diffusion de la culture scientifique dans tous ses aspects. Une stratégie nationale de développement s’impose, qui s’efforce de tenir compte des nouveaux apports technologiques et de l’évolution des pratiques scientifiques. Elle doit s’articuler à une recherche devenue mondiale et se traduire par une participation active aux réseaux européens et internationaux. Elle nécessite une organisation qui permette l’émergence de collaborations et d’un réseau de partage de la connaissance.
Pour en savoir plus
Consulter la feuille de route :
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Infrastructures_de_recherche/74/5/feuille_route_infrastructures_recherche_2016_555745.pdf.
La section consacrée à l’IST commence en page 147.