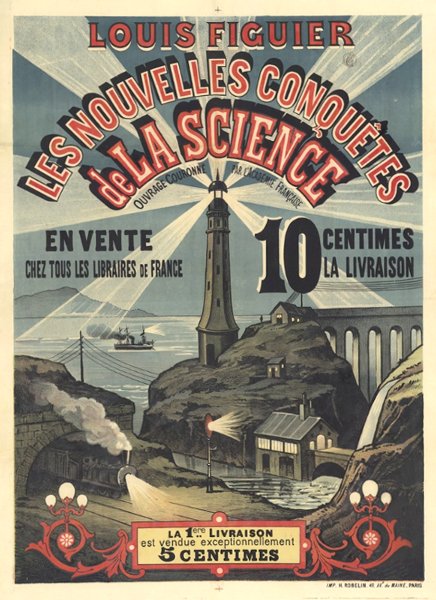L’Open Access suscite un grand intérêt de la part de la communauté de l’ESR. Une vingtaine de déclarations en sa faveur ont été publiées depuis le début du XXIe siècle.
Pour les futurs épistémologues du mouvement de l’Open Access et de la science ouverte, au-delà de l’analyse des données chiffrées qui viendront mesurer la plus ou moins résistible ascension du mouvement, et de la gnose sur les avancées réglementaires et législatives qui viennent en sanctionner l’avènement, il sera passionnant d’étudier les différents manifestes, déclarations, appels, etc. qui, depuis le début du XXIe siècle, marquent la progression du mouvement.
La plus ancienne de ces déclarations semble être la lettre ouverte de la Public Library of Science, en 20011. Elle affirme son soutien à une bibliothèque publique internationale en ligne de médecine et de biologie, librement accessible et permettant une recherche dans l’intégralité de ses contenus. Tout en reconnaissant le droit des éditeurs à vivre de leur activité, elle refuse de voir l’archivage pérenne des publications de la science dépendre d’intérêts économiques – un texte, à tous égards, prophétique.
Louis Figuier, les Nouvelles conquêtes de la science 1880-1885
Source gallica.bnf.fr – BnF
Cependant, c’est l’Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert (2002) que l’histoire a retenu comme le démarrage du mouvement de l’OA. Ce texte définit les deux voies d’accès à l’OA, l’auto-archivage, qu’on appellera rapidement la voie verte, et la création de revues ou la transformation de revues existantes en OA, qui deviendra la voie dorée. On notera que les revues en OA, telles que définies dans l’initiative de Budapest, prévoient plusieurs modalités de financement et non les seules APC, comme l’opinion l’a finalement retenu. On notera aussi que le mouvement ainsi initié n’a pas pour but de substituer au marché de l’édition scientifique un marché délivré de contraintes commerciales, mais avant tout d’accélérer la diffusion des résultats de la recherche.
Quinze déclarations suivront entre 2003 et 2006. La plus célèbre est la Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance en sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines et sociales. Cette dernière reprend les principes de l’Initiative de Budapest, en insistant sur la nécessité de publier le texte et toutes ses annexes dans un format ouvert et pérenne. Les autres sont essentiellement des déclarations d’adhésion à la déclaration fondatrice de Budapest et d’adaptation locale ou sectorielle.
Après quatre années de pause, la Déclaration de l’Alhambra sur le Libre Accès en 2010 a pour caractéristique d’émaner de pays du Sud de l’Europe (Espagne, Portugal, France, Italie, Grèce et Turquie) et de comprendre un plan d’action pour le développement de l’OA dans ces pays. La reprise des déclarations, à partir de 2010, peut laisser penser que les précédentes ont peu été suivies d’effets. D’autre déclarations de pays encore plus au sud suivront en 2016, avec la Déclaration de Dakar, qui concerne principalement l’Afrique, et celles de Dehli, Mexico et Thessalonique en 2018.
En 2012, la Commission européenne publie une longue communication en faveur de l’OA, intitulée Pour un meilleur accès aux informations scientifiques : dynamiser les avantages des investissements publics dans le domaine de la recherche. Elle insiste sur la nécessité de l’interopérabilité à l’échelle de l’Union européenne, et annonce l’obligation de publication en OA pour les projets soutenus par le programme H20202.
Enfin, en 2017, l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité est la première déclaration d’un genre nouveau. Le discours passe de l’OA à la Science ouverte, tout en étant néanmoins focalisé sur les acteurs de la publication scientifique. Il affirme la nécessité de sortir de la domination de l’oligopole éditorial actuel, en encourageant l’émergence d’acteurs nombreux, aux modèles économiques diversifiés, mais qui ne doivent être financés ni par le lecteur, ni par l’auteur. L’appel de Jussieu met également en lumière la nécessité de changer les critères d’évaluation des chercheurs, qui sont en grande partie responsables de la position dominante des éditeurs installés. Enfin, l’appel est à l’origine du mot bibliodiversité, créé sur le modèle de biodiversité, qui connaît depuis un franc succès.