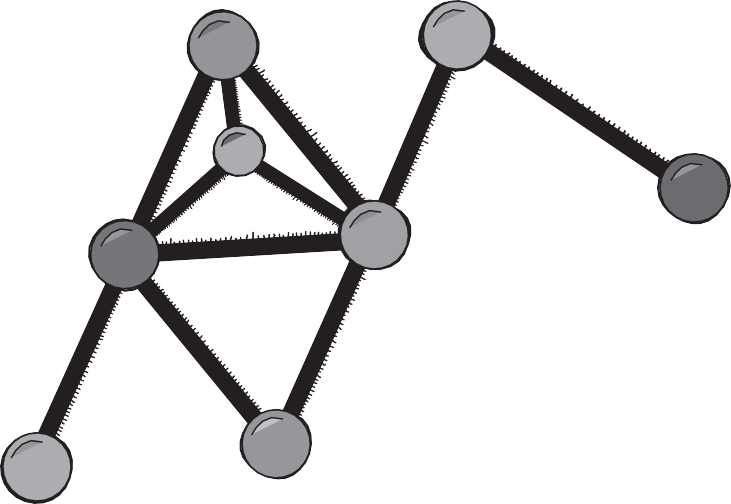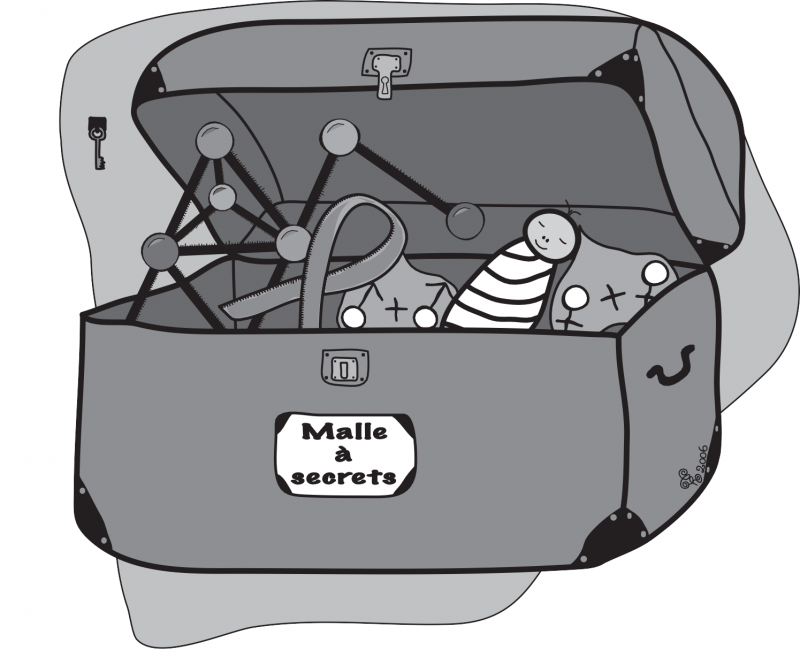Canal Psy : Mme Modolo, pouvez-vous nous présenter le service dans lequel vous travaillez ?
Isabelle Modolo : Je travaille dans le service d’immunologie clinique dirigé par le Professeur J.-L. Touraine, et plus spécifiquement dans le service de sidologie. C’est au cours du milieu des années 80 que le Professeur J.-L. Touraine a pris en charge les premiers patients atteints par le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine).
Ce service est aujourd’hui composé de trois lieux de prise en charge pour les patients séropositifs : le service de consultation, l’hôpital de jour et le service d’hospitalisation. En tant que psychologues, nous prenons en charge les patients à court ou long terme. Monique Domenget et moi-même assurons deux permanences hebdomadaires qui permettent une prise de contact avec les patients lorsqu’ils se rendent à leur consultation médicale. Lorsque ces rencontres ouvrent sur une prise en charge psychologique, les entretiens ont alors lieu dans un bureau hors du service médical. La pathologie chronique permet que des suivis longs puissent être proposés dans ce cadre.
De plus, le service est doté d’un Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG) qui a une double mission, à savoir, de dépistage du sida et des hépatites, et de prévention de ces pathologies. Le CIDAG nous adresse des patients qui ont des pratiques à risque. Présenter ce service m’amène au préalable à devoir faire un détour par l’histoire de la rencontre de cette pathologie, le sida avec des équipes médicales et soignantes singulières.
En effet, à l’origine ce service ne prenait pas spécifiquement en charge des patients atteints du virus du sida, mais des patients présentant une pathologie rénale ou bien en post-greffe rein et/ou pancréas. Pour les uns il était alors nécessaire d’abaisser artificiellement leur système immunitaire pour permettre à l’organisme de recevoir un greffon, et pour les autres, leur système immunitaire était « accidentellement » perturbé par le virus HIV. Mais la raison médicale objective qui a fait que ces deux pathologies ont été regroupées sous un même service ne rend pas compte des effets fantasmatiques que l’arrivée de cette pathologie a alors produits. Le sida était non seulement en effet une pathologie contaminante, mais qui concernait majoritairement une population homosexuelle.
Dès lors, les fantasmes de contamination présents dans l’équipe ont été infiltrés de fantasmatiques sexuelles, et focalisés sur les risques encourus par les patients greffés hospitalisés, interrogeant par là-même la responsabilité potentielle de l’institution. Pour rendre compte du travail psychique institutionnel, on pourrait dire que le système immunitaire du service, au sens de système de défense institutionnel, a dû, comme dans le cas de la greffe, être abaissé ou à tout le moins remanié afin que le greffon – ici représenté par les patients HIV – puisse être investi. En effet, les équipes vont devoir investir tout à la fois ceux qui sont rejetés « ailleurs », mais aussi la part d’eux-mêmes que les patients ne parviennent pas à investir. Cette par-là s’appelle, se métaphorise, se condense, sous le nom de sida, car s’il s’agit d’une réalité biologique, d’une pathologie médicale, c’est aussi d’une réalité psychique dont nous allons tracer les grandes lignes.
Laurence Chassard
À l’occasion des soins, les patients sont écoutés précisément au cœur de ce qui leur fait honte. Les équipes, composées essentiellement de femmes, écoutent ces hommes1 au cœur de leur contamination en quelque sorte. Ces hommes, qui dépeignent leur vie érotique souvent crûment (scènes de dragues, back-room…), vont induire des comportements que l’on peut lire comme autant de tentatives de contention de ce qui est ressenti comme un « trop » d’excitation. Les uns se changent en effet, non plus dans les vestiaires, mais dans les box de consultation ; les autres s’y lavent les cheveux ; des ventes de sous-vêtements sont autant d’occasions de mettre en scène et en acte l’excitation ressentie dans les relations auprès des patients. D’autres soignants, encore, invitent des patients au self, partagent des soirées à l’extérieur, et la salle de soins devient le dernier salon où l’on cause. On peut y voir là l’interpénétration des espaces professionnels et intimes, infiltrés des fantasmatiques sexuelles. Le fait qu’il n’y ait, jusqu’en 1996, aucune molécule efficace pour le traitement du sida, rend la fonction soignante d’autant plus vulnérable, et le soignant démuni de ses outils habituels de travail peut se percevoir comme « à main nue » dans la relation aux patients.
Les équipes se colletaient alors à des éprouvés bruts et emprunts d’une forme de violence archaïque, où se mêlaient tout à la fois la maladie, la mort et la sexualité, mais sexualité dans laquelle nous n’entendions pas la question du désir d’enfant.
Canal Psy : Comment cette question est-elle apparue dans le service ?
Isabelle Modolo : Si nous ne l’avons pas rencontrée dans le service au début de l’épidémie, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’ait pas existé. Nombre d’hommes homosexuels avaient des enfants issus d’une union antérieure avec une femme, pan de leur vie qui était souvent passé sous silence, du côté des patients comme des soignants, comme si en certains lieux cette conjugaison était impensable. D’autre part, concernant les femmes séropositives, on pourrait dire qu’avant que le désir d’enfant ne s’exprime verbalement, la problématique de l’enfant s’est d’abord exprimée sous forme « d’accident ». Il s’agissait de femmes contaminées par voie intraveineuse souvent non sevrées, et qui avaient connaissance de leur séropositivité.
Le corps médical, en l’absence de traitement efficace, et étant donné les risques de contamination par voie materno-fœtale, conseillait alors fermement le recours à l’IVG. Nombre d’entre elles ont été à nouveau enceinte quelques mois après, et ont fait cette fois-ci le choix de mener leur grossesse à terme. Les femmes africaines, quant à elles, ont toutes refusé l’avortement pour des motifs culturels et religieux. Nombreuses sont celles qui apprenaient leur séropositivité au décours du suivi prénatal.
C’est à partir de ce temps-là que les équipes se sont confrontées à de nouvelles problématiques. Ce qui hier les rassemblait autour de la prise en charge des patients produisait désormais des divisions. En effet, le désir d’enfant, dans ce contexte de séropositivité, était jugé par les uns comme égoïste, ou bien perçu par les autres comme l’expression d’un élan vital de bon augure qu’il convenait de ne pas entraver. Risque que nous ne pouvions pas écarter, mais nous n’avions que peu de possibilités de mettre en travail ce désir qui relevait de l’intimité et de la liberté fondamentale des patients. En effet, les patients s’informaient auprès des équipes médicales des risques médicaux, mais n’étaient en aucune manière demandeurs de prise en charge psychologique, et ce d’autant plus que l’enfant pouvait s’offrir pour eux comme un évitement de la souffrance. Ce qui marquait alors les réflexions des équipes était une constante oscillation entre ce que les uns nommaient l’idée insupportable du « droit à l’enfant », et ce qui relevait d’un autre côté de la part d’insondable que revêt le désir d’enfant, offrant une résistance à toute forme de rationalisation pour chacun, qu’il soit séropositif ou non.
L’année 1996 va marquer un tournant important dans la prise en charge médicale du sida. Il s’agit de l’arrivée des multi-thérapies qui font alors passer le sida au rang des pathologies dites chroniques. La menace du sida s’éloignant, des désirs qui n’avaient osé se faire jour commencent alors à s’exprimer.
De plus, une nouvelle technique de PMA qui consiste à réaliser « un lavage de sperme » permet à des couples séro-différents (couples où la femme est séronégative et l’homme séropositif) de pouvoir procréer sans risque de contamination. Dans le cas où c’est la femme qui est porteuse du virus, le CECOS envisage la possibilité de réaliser une IAD selon le protocole médical de référence. Désormais, le désir d’enfant va s’adresser au corps médical. Le fait que des protocoles aient été réalisés évite désormais au corps médical de se sentir trop impliqué personnellement dans le devenir des parents et des enfants, et va permettre qu’un écart professionnel soit ainsi restauré.
Toutefois, nous avons pu observer que ce désir d’enfant et sa réalisation réveillent fréquemment au sein des couples, et ce malgré les précautions biologiques prises, des angoisses de contaminations qui bousculent le lien. La fantasmatique œdipienne entre alors en collusion avec la réalité de l’épée de Damoclès que représente l’atteinte virale. Le pacte dénégatif autour de la maladie et la mort, sur lequel le couple vivait jusque-là, vole en éclat et nécessite des remaniements au sein du couple que le désir d’enfant peut ouvrir.
Canal Psy : Vous paraissez décrire des prises en charge psychologiques orientées vers des difficultés rencontrées autour de la parentalité. Repérez-vous une problématique récurrente ?
Isabelle Modolo : La problématique qui traverse l’ensemble des situations au regard de la parentalité est celle du secret, thème qui a fait l’objet de nombreux travaux dans diverses cliniques. « Le secret est une tentative de se protéger et de protéger les autres de “quelque chose” qui produit, pour lui, de la souffrance. » (Serge Tisseron, seconde journée d’échanges « Parentalité et VIH », Lyon, 2004).
Les parents, en effet, souhaitent légitimement protéger leur enfant en ne leur demandant pas d’assumer la charge d’angoisse qui est associée à toute maladie à pronostic défavorable. De plus, la contamination par le sida peut générer également culpabilité et honte chez le parent ; la connotation qui lui est associée reste péjorative. Si le sida est une maladie contaminante, les effets psychologiques qui lui sont liés sont également contagieux. L’entourage de celui qui est atteint peut en effet lui aussi être porteur de cette honte, ou risquer d’être exclu de tel ou tel groupe social du fait de son lien affectif avec le malade. Sans oublier que pour le patient, la souffrance porte aussi sur l’histoire de cette contamination, et donc sur le lien rattachant à un ou une autre, présent ou absent de sa vie actuelle. Ce parcours peut renvoyer à des temps de dépression, d’errance psychique, de deuil. En ce sens, la contamination représente le constant rappel d’une histoire de soi qui parvient difficilement à se conjuguer au passé. Lorsque le malade peut se reconnaître lui-même dans cette histoire et ce désir passé, alors il peut accepter, ou tolérer la séropositivité comme un accident de vie. En ce cas, on peut penser que l’enfant sera en mesure de pouvoir lui aussi l’intégrer dans son histoire en lien avec celle de ses parents.
Laurence Chassard
Mais il est des situations plus complexes ; particulièrement celles où le sujet se vit comme ayant été soumis à des pulsions, qui se sont exprimées dans certaines relations, ou formes de conduites. Ces pulsions viendraient alors dévoiler une part non tolérable de lui-même, irrecevable au regard de son idéal du moi et/ou de son surmoi, qu’il souhaiterait reléguer aux frontières de lui-même. Ces formes d’exigence pulsionnelle, que le sujet/parent ne peut intégrer à son identité, sont autant de « morceaux identitaires » que l’enfant recevra comme autant de béances transmises dans le lien de filiation. Dans ces situations, les parents tentent de garantir fermement le secret portant sur leur contamination. Mais, le secret au quotidien peut difficilement ne pas sécréter.
Une vignette clinique peut en rendre compte :
La mère d’une adolescente me rapporte, en consultation, que sa fille a développé le symptôme suivant : elle s’est mise à piller toutes les boîtes aux lettres de son immeuble et à dispatcher les courriers de manière aléatoire dans les boîtes des voisins. De temps à autre, elle ouvrait les courriers avant de les redistribuer, mais pas systématiquement. Lorsqu’il fut découvert qu’elle était responsable de ces « échanges », sa mère se retrouva confrontée au comportement énigmatique de sa fille, comportement qui revêtait un caractère tout aussi énigmatique pour l’adolescente elle-même. Nous pouvons supposer que l’adolescente agissait ici ce qui s’échangeait au sein des relations familiales. Ce que dit en acte le comportement de la jeune adolescente, peut évoquer ce qu’elle pouvait ressentir des paroles dont elle pouvait être l’objet ; paroles qui s’adressaient manifestement à elle mais dont une part du contenu, qu’elle n’était pas en mesure d’identifier clairement, s’adressait à l’un ou à l’autre des parents. Son père, qui avait trouvé refuge dans la religion musulmane après sa contamination, fustigeait les femmes, déplaçant ainsi sur sa fille, dès le début de son adolescence, les ressentiments qu’il nourrissait contre « d’autre(s) femme(s) » – celles qui l’avaient contaminé. On peut relever, de l’autre côté, l’ambivalence de la mère de l’adolescente, qui s’associait parfois aux rodomontades du père contre sa fille, dont une part de celles-ci ne la concernait pas. Adolescente « boîte aux lettres » des parents qui s’adressaient des messages cachetés au travers d’elle.
On entend dans cette vignette clinique ce qui peut se transmettre de la part du père, cette part intolérable pour lui, restée en souffrance.
Certains parents repèrent pourtant ce qui s’échappe, ce qui se présente comme un comportement « cachant et exhibant » tout à la fois leur secret, dans des actes tels que :
- la prise de médicaments qui, s’ils sont extraits de leur boîte d’origine, sont pris néanmoins devant les enfants au moment des repas,
- les précautions excessives en matière de prévention, comme le fait d’interdire à l’enfant de boire après eux, de laver leur linge à part…
- l’évitement systématique des discussions sur le sida, le fait d’éviter toutes les émissions télévisées portant sur ce thème.
Tous ces comportements sont repérés par les enfants parce que ceux-ci sont récurrents. Et ce sont les réponses que les parents apportent à leurs questions qui portent ce caractère énigmatique. Ils perçoivent en effet cette part de vérité qui peut être : « je prends un traitement pour ne pas tomber malade » ; mais le fait que le traitement ne s’interrompe jamais ne rentre pas dans une situation qu’ils parviennent à identifier. Ainsi, c’est sur la base de ce reste-là, irreprésenté, que le caractère énigmatique se fonde.
Une mère s’interrogeant à ce sujet, me racontait la façon dont son enfant insistait pour enfin pouvoir boire, comme elle, le jus de fruit qu’elle conservait au frigo et qu’il n’avait pas le droit de toucher. Il s’agissait d’une brique de lait hyperprotéiné, destiné à éviter la fonte musculaire, qu’elle devait prendre.
Aussi les formes de communication infraverbales comme le sont les attitudes corporelles, les variations de micro-gestuelles, sont autant de signes auxquels les enfants sont extrêmement sensibles. Un regard qui, une fraction de seconde, trahira un éprouvé d’angoisse chez son père, une légère inflexion de la voix chez sa mère qui dit, à son insu, son embarras, viennent signifier le décalage entre ce qui est énoncé et ce qui est ressenti. Avant de comprendre les mots, le premier langage de l’enfant était affaire de rythmes, d’intonations, de regards… Ces signes, émis par les parents répétitivement, deviennent au fil du temps intelligibles pour l’enfant d’un savoir qui le concerne et qui lui est maintenu secret. Alors bien sûr, ces signes ne révèlent pas le contenu du secret, mais révèlent à l’enfant qu’il y a là quelque chose qui embarrasse, inquiète, quelque chose qui affecte ses parents et qui lui est caché. Il ne faudrait pas pour autant conclure que la solution soit de dire à tout prix, en pensant que le fait de savoir est suffisant. Une fois dit, le travail psychique reste à accompagner, en tenant compte de ce que ce savoir ainsi transmis va provoquer comme effet. Ainsi, un adolescent à qui ses parents avaient dit leur contamination a, lors d’un camp de vacances, laissé entendre à ses camarades et moniteurs qu’il était contaminé et homosexuel. On peut penser qu’il tentait par-là de leur faire vivre ce qu’il avait lui-même vécu lorsqu’il a appris la contamination de ses parents. Peut-être cherchait-il à ressentir ce qu’il imaginait que son père avait lui-même pu vivre ? Et ce, alors même que cette contamination n’était vraisemblablement pas d’origine homosexuelle.
Laurence Chassard
On entend bien là combien l’homosexualité résonne dans la séropositivité, ainsi que la filiation père/fils, et qu’« être fils de » c’est aussi pouvoir s’identifier et identifier ce qu’est le désir paternel jusqu’à être assuré de le ressentir.
Si j’ai tenté de brosser les grandes lignes de l’irruption du sida au sein d’un service et les effets qu’il a générés, c’est parce qu’il me semblait entrer en résonance avec l’irruption de l’inclinaison du désir homosexuel, ou d’autres formes de relations inattendues, ou de liens soumis à trahison, et laissant une trace non cicatrisée au-dedans de soi. Ces formes irruptives, si elles restent ainsi terre étrangère en soi, risquent alors de se cristalliser sous l’effet du VIH, qui peut alors aller jusqu’à affecter les liens de filiation. Retenons que si cette contamination est lourde d’implications, elle n’en est pas pour autant « le tout » du sujet. Le dispositif psychologique que nous proposons aux patients dans le service peut ainsi représenter un espace de transformation psychique possible.