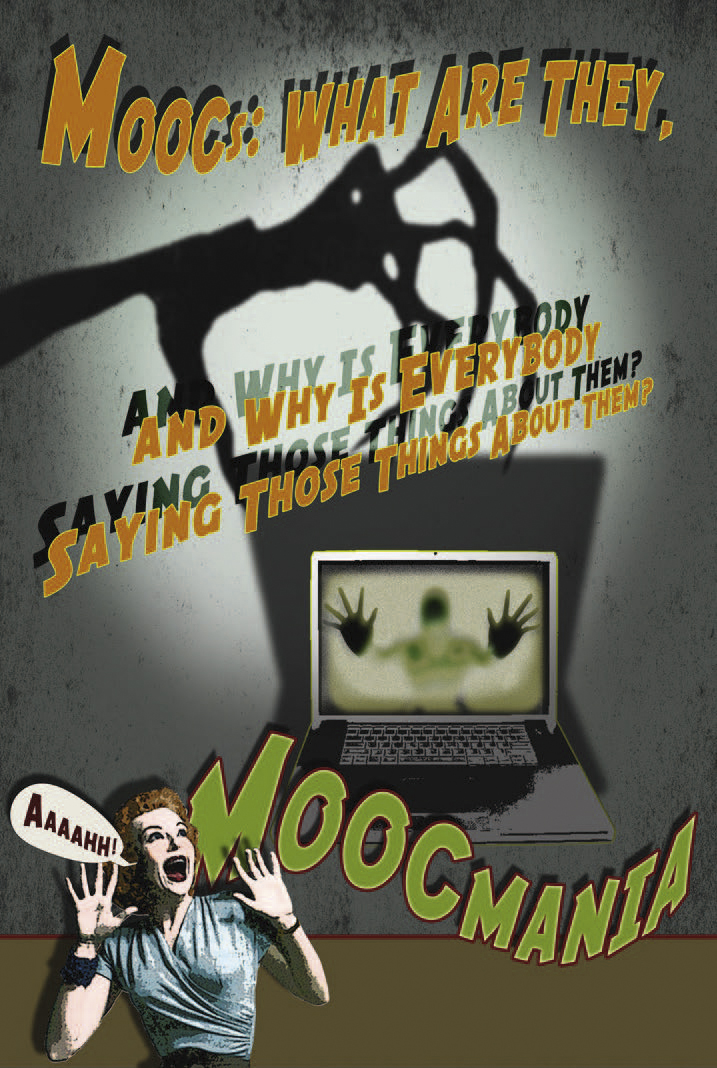L’objectif de masse revendiqué par les concepteurs de Moocs se construirait-il au détriment de réelles avancées pédagogiques ou techniques ? Ne risque-t-il pas d’accroître un peu plus un certain désordre documentaire ? Décryptage.
La question de la désorientation n’est pas née avec l’Internet puisque les bibliothèques, la notion d’auteur, le dépôt légal, la critique, les revues académiques peuvent être considérés comme des dispositifs d’orientation dans l’offre « imprimée ». Les savoirs prolifèrent, mais leur abondance génère des effets contre-productifs s’il n’existe aucune médiation pour les sélectionner, les évaluer, les hiérarchiser. Ces dispositifs dépendent largement des supports techniques qui permettent la circulation des contenus. Le système d’orientation dans les savoirs propre à l’imprimé (hors des écrits de fiction) s’est développé avec la révolution scientifique, mais a pris son élan avec le développement de la formation universitaire. À chaque nouvelle génération médiatique, il est remis en cause.
Ainsi, l’ère des mass média (radio/télévision) a déplacé les modes de validation des savoirs et d’orientation de l’attention des publics en introduisant des effets de notoriété propres à l’opinion constituée par ces médias. Cela n’a pas manqué de créer des tiraillements dans les formes d’orientation classiques, puisque des scientifiques ont vu leur renom croître sans commune mesure avec la qualité scientifique reconnue par la communauté des pairs et cela a commencé à affecter jusqu’à l’enseignement. Les tentatives de télé-enseignement via la télévision dès les années 60 se sont d’ailleurs appuyées sur ces « vedettes » scientifiques de l’époque. Les enjeux de réputation ne sont jamais éloignés de toute politique d’orientation dans les savoirs. Cependant, lnternet a changé radicalement l’échelle de la mise à disposition de ces savoirs, mais aussi les principes de cette orientation. La puissance des moteurs de recherche (et de l’un d’eux en particulier, Google) dans l’organisation de notre attention est directement proportionnée à la prolifération des savoirs disponibles. Le phénomène est d’autant plus accentué que, avec le web 2.0, les dispositifs de publication se sont ouverts à tous. Les contributions sans nombre sont devenues ingérables par les médiateurs qui les hiérarchisaient ou les classaient auparavant. Mieux, les internautes ordinaires deviennent eux-mêmes ces médiateurs et multiplient les recommandations, à travers des réseaux sociaux ou des sites commerciaux qui les y encouragent.
Les Moocs : un phénomène de marque ?
Ce tableau du désordre documentaire n’est qu’un constat et non une lamentation sur un paradis perdu, car les gains obtenus dans cette prolifération des émetteurs et des messages sont précieux. Mais l’état cognitif collectif de demande d’orientation a ainsi changé, d’autant plus qu’il coïncide avec l’affaiblissement de toutes les autorités, dans tous les domaines. C’est dans ce contexte que l’on doit comprendre l’émergence des Moocs (Massive Online Open Courses). En effet, le caractère innovant de ces dispositifs, sur le plan pédagogique comme sur le plan technique, n’est pas ce qui frappe le plus dans des plateformes comme Coursera ou Udacity. Nous attendons encore, par exemple, des principes de pédagogie active originaux sur ces plateformes qui sont avant tout destinées à la diffusion de masse, ce qui relève quasiment d’un « effet diligence » remarquable (la voiture a reproduit toutes les caractéristiques des diligences, et les Moocs reproduisent toutes les propriétés des mass media et de l’enseignement magistral). Les Moocs mettent en place avant tout un système de marques (au sens de réputation, « brands ») qui doivent se substituer à tous les autres dispositifs d’orientation dans les savoirs et dans la demande de formation. En cela, ces offres dupliquent les modèles des plateformes comme iTunes ou Amazon. Elles agrègent tous les contenus dans un même espace, fournissent un dispositif d’orientation et de vente standardisé et fluidifié à l’extrême et deviennent ainsi un point de passage obligé. Cet effet « grande surface qui écrase les prix » et qui finit par dicter sa loi aux producteurs des biens qui sont vendus est bien connu en France puisqu’il a été inventé en grande partie ici. Mais c’est aux États-Unis qu’il a été réalisé en ligne.
Ce qui se passe pour les Moocs est exactement de cet ordre, ni plus ni moins. Les universités adhérentes à un Mooc acceptent de mettre leur réputation au service d’un intermédiaire (Coursera, Udacity, pour les Moocs commerciaux ou edX pour les « non‑profits ») : c’est la plateforme qui deviendra l’attracteur principal et qui captera l’audience générée par ces réputations. En contrepartie, les universités gagnent un accès à un public supposé vaste, et espèrent aussi des retombées de réputation, voire de revenus.
Dans tout cela, la captation de la réputation est le mécanisme décisif. Car l’attention des étudiants potentiels a été déjà formatée par une hiérarchie des universités qui ne peut qu’influencer leur choix, dès lors que les autres coûts sont réduits voire nuls (si l’accès technique est disponible).
Non seulement les universités sont-elles prises dans ce piège de la réputation, mais les enseignants-chercheurs eux-mêmes ont appris depuis plus de dix ans à ne s’orienter qu’en fonction de cela (publish or perish) au grand bénéfice des plateformes d’édition scientifique en ligne qui ont capté toute cette rente.
Ce principe des marques a pénétré tous les esprits et permet tous les classements qui, malgré les critiques massives qui leur sont adressées, sont des dispositifs d’orientation de l’attention très puissants. La réputation des enseignants, associée à celle de leurs universités, devient dès lors un bien immatériel sur lequel des investisseurs ont décidé de parier pour capter l’attention d’un public anxieux de son avenir et désorienté par l’abondance de l’offre de savoirs.
Les Moocs sont les grandes surfaces et les marques qui doivent permettre de réintégrer toute la dynamique non marchande de transmission et de production de savoirs dans des mécanismes de rentabilité financière. En captant ces réputations, les investisseurs cherchent à constituer un oligopole, en disqualifiant tous les médiateurs installés que sont les enseignants et les universités dans les établissements des pays qu’on attaque comme marché, y compris les médiateurs d’orientation documentaire, et en formatant, de façon simple et reproductible en masse, la diffusion des savoirs. Il est donc non pertinent de penser entrer dans cette logique sans avoir de marques déjà établies à faire valoir (enseignants ou universités), en voulant développer un Mooc local ou spécialisé alors que le marché est mondial a priori, ou une plateforme technique performante alors que les modèles de marques puissantes existent déjà et que l’innovation technique n’est pas du tout le principe des Moocs.
Visuel de la conférence annuelle de printemps de l’Association of American University Press (AAUP) consacrée aux Moocs, le 17 mai 2013
Un marché à double versant
Les Moocs commerciaux constituent une offensive financière de prédation sur les dispositifs de formation, mais tous les autres dispositifs « non-profits » contribuent, par suivisme, à étendre des principes d’accès et d’orientation dans les savoirs fondés sur la réputation et la standardisation. En effet, ces modèles ne peuvent favoriser la diversité des approches, des langues, des médiateurs, des modèles pédagogiques sous peine de perdre les avantages du « massive ». Cette tendance est-elle fatalement liée au numérique ? En aucune façon. D’autres systèmes distribués et coopératifs se sont développés dans tous les domaines hors de l’emprise des plateformes. Le modèle le plus fameux est celui du développement logiciel Open Source, qui repose sur une distribution des compétences et sur leur mise en réseau non appropriable. On comprend mieux ainsi que les plateformes (et les grands groupes d’éditeurs académiques) sont celles qui, à l’inverse, vont défendre le droit d’auteur et tous les dispositifs de clôture des biens immatériels pour en faire des biens exclusifs.
Alors même qu’ils sont présentés comme « Open », les Moocs commerciaux adoptent une stratégie dite de « marché à double versant » où la gratuité qui permet d’attirer le public est compensée par des revenus reposant sur la vente de cette notoriété à d’autres clients solvables (placement publicitaire, données personnelles ou autres), avant de passer au paiement des clients ordinaires à travers des services à valeur ajoutée qui deviendront indispensables.
La captation d’une clientèle désorientée dans la prolifération des savoirs, et profondément anxieuse pour son avenir, repose sur un dispositif de réputation qui hiérarchise de façon très puissante les savoirs, en dehors des traditions académiques et des médiateurs existants. S’il est impossible de revenir à une politique des savoirs fondée sur les autorités et sur la rareté, il est indispensable d’inventer les mécanismes d’orientation distribués et coopératifs qui empêcheront le basculement de tout notre système de savoirs dans une course permanente au buzz et à la réputation.