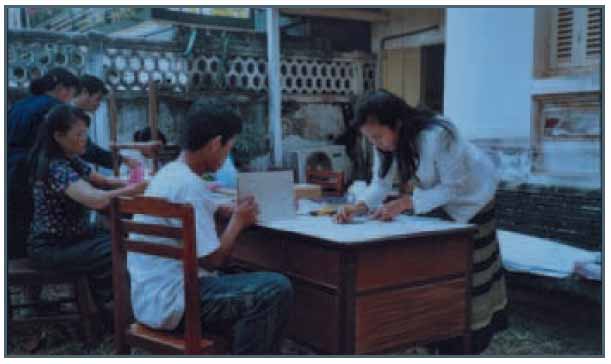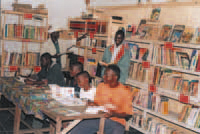Propos recueillis par Laurent Piquemal
Une mobilisation locale…
Comment présenteriez-vous le COBIAC à nos lecteurs, en quelques mots ?
Le COBIAC est une association loi 1901 qui a créé en 2000 la Banque régionale du Livre, outil désormais incontournable de la coopération internationale autour du livre dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
C’est une structure située à Aix-en-Provence (bureaux) et à Charleval (local de stockage) dans les Bouches-du-Rhône, qui recueille les livres issus du désherbage des bibliothèques, librairies et éditeurs pour aider à constituer ou compléter les fonds de bibliothèques dans d’autres pays (Algérie, Maroc, Égypte, Liban, Palestine, Laos, Congo/Brazzaville). À ces envois de livres français sont parfois ajoutés des livres neufs bilingues ou dans la langue du pays. La formation, l’accueil de stagiaires, les échanges professionnels constituent le deuxième axe de ces projets.
Enfin, la Banque régionale du Livre est un pôle ressource pour l’expertise des bibliothèques et pour l’ingénierie de projet à l’international. Elle emploie trois personnes à ce jour et fonctionne aussi grâce à la participation de nombreux bénévoles qui s’investissent au travers de commissions (thématiques ou liées à des projets pays). Elle est ouverte aux bénévoles le premier dimanche de chaque mois et accueille volontiers les professionnels et associations de la région curieux de connaître la dimension internationale du livre et de la lecture.
Quelles étaient les raisons d’un tel engagement ?
La Banque régionale du Livre a été créée en réponse à un double constat : les bibliothécaires, éditeurs et libraires mettent chaque année au pilon des fonds d’ouvrages qui pourraient souvent avoir une seconde vie. De nombreuses bibliothèques à l’étranger souhaitent obtenir des livres français pour développer la lecture mais n’en ont pas les moyens.
Les bénévoles qui s’engagent au sein du COBIAC sont ravis de faire bénéficier d’une offre de lecture solidaire des populations de pays qui manquent cruellement de livres. Ils retrouvent auprès des divers partenaires l’esprit « militant » du livre qui a animé le métier au début de la mise en place de la lecture publique en France. De plus, les échanges professionnels qui se créent au travers des missions de formation ou d’expertise sont d’une grande richesse réciproque. C’est aussi une manière de prendre du recul sur ses propres pratiques.
Toute association basée sur le bénévolat doit sans cesse motiver ses adhérents. Comment lutter contre une possible démobilisation ?
Les bénévoles adhérents à l’association sont associés à nos actions. D’une part, au travers des journées de tri et de préparation des envois (le premier dimanche de chaque mois) qui sont largement ouvertes à tous. D’autre part, les bénévoles participent aussi aux commissions thématiques de leur choix (par projet, pays) ou plus transversales (sur la formation, le désherbage…) pour suivre de plus près un projet. Certains d’entre eux sont sollicités pour assurer des formations à l’étranger ou pour représenter la structure à l’occasion de salons du livre, colloques…
L’association a également réussi à mettre en place une bonne collaboration entre l’équipe salariée et bénévole pour le suivi des projets et leur accompagnement technique, ce qui donne une ambiance conviviale à notre travail.
Comment arrivez-vous à convaincre les plus indifférents de vous rejoindre ?
Les bibliothèques conventionnées avec le COBIAC sont en premier lieu sensibilisées au travers de leurs pratiques de désherbage ; la Banque régionale du Livre leur propose une convention de partenariat, sur les bases d’un engagement commun et du respect de la Charte du don de livres.
La convention est accompagnée d’une adhésion collective à notre association, ce qui permet à la bibliothèque partenaire de s’investir plus largement dans l’association si elle le souhaite.
Nous leur apportons une assistance technique au désherbage pour le don, nous accueillons aussi des bibliothécaires de la fonction publique en stage pratique dans nos locaux pour les sensibiliser au don et à la coopération internationale. Nous proposons quelquefois à ces bibliothèques de recevoir des bibliothécaires étrangers pour des stages pratiques.
Ce type d’échanges et de participations permet de stimuler des liens professionnels au niveau régional et international. La Banque régionale du Livre donne une ouverture à l’international à ses partenaires.
De quels soutiens financiers bénéficiez-vous ?
Le premier soutien financier provient de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ensuite, la Banque régionale du Livre est appuyée par le conseil général des Bouches‑du‑Rhône, la direction régionale des affaires culturelle, les autres conseils généraux de la région et plusieurs communes. En 2006, deux fondations nous ont soutenus : les Fondation AVIVA et René-Seydoux. Deux projets ont reçu le soutien de l’Europe.
L’association fait des prestations en répondant à des appels d’offres de formation ayant un lien direct avec la coopération internationale dans le domaine des bibliothèques (réponses aux appels d’offres du ministère des affaires étrangères pour les médiathèques françaises à l’étranger ou à des projets de formation des fonds de solidarité prioritaire mis en place entre la France et d’autres pays de la zone Sud).
La diffusion d’expositions et des souscriptions entrent aussi en compte dans nos fonds propres.
Ces organismes ont-ils été difficiles à convaincre ?
Les principaux financeurs publics sont très réceptifs à notre démarche ; ils nous sollicitent parfois sur leurs propres zones de coopération décentralisée. Toutefois, leurs subventions tendent à être à budget constant et l’équilibre financier d’une association comme la nôtre peut parfois être fragile. Il nous est donc nécessaire d’être créatifs et novateurs afin de les sensibiliser et les convaincre de la justesse de nos projets, de travailler sur notre image et notre offre de compétences. C’est ainsi que nous développons nos domaines d’expertise (missions d’évaluations, formations, ingénierie de projet) et que nous avons élargi nos partenariats en adhérant à des réseaux tels que la Fondation Anna Lindh1 ou Medcoop2.
Que signifie pour vous « être engagé » ?
L’engagement consiste en premier lieu pour nous à proposer des actions structurantes autour des bibliothèques dans les pays partenaires en appuyant de façon durable et dans le temps leur développement jusqu’à leur pérennisation.
En second lieu, notre engagement consiste à travailler dans le respect des réalités et de la culture de nos partenaires, à porter notre vigilance sur l’écoute des besoins exprimés, à respecter la chaîne du livre du pays concerné – édition, librairies...
De même, nous accordons beaucoup d’attention à la qualité des livres que nous envoyons, tant sur leur aspect physique que sur le contenu. Mais la solidarité est aussi au cœur de nos préoccupations. Nous intervenons à la demande en cas de catastrophe naturelle ou anthropique comme à la bibliothèque universitaire de Boumerdès (Algérie) après le séisme de mai 2003 ou pour le réseau de lecture publique du Liban pendant la guerre de juillet 2006.
À la BU du Laos Formation à la reliure animée par Michel Schmutz
…pour un engagement international
Le premier axe de votre engagement international est le recensement des besoins : de quels moyens disposez-vous pour un tel recensement ?
Nous effectuons en général des missions sur place et rencontrons les responsables des bibliothèques qui nous font part de leurs besoins. Nos priorités sont avant tout de favoriser la lecture publique (bibliothèque ouverte à tous, regroupant tous les domaines de la connaissance, gérée par du personnel formé aux fondamentaux du métier de bibliothécaire, partenaires sérieux ayant à cœur de pérenniser leur projet…).
Y a-t-il des pays prioritaires ?
Notre axe prioritaire est la rive sud et est de la Méditerranée : Maghreb (Algérie, Maroc), Proche et Moyen Orient (Liban, Egypte, Palestine). Nous avons aussi des actions au Laos et au Congo/Brazzaville.
Le deuxième axe est l’envoi de documents et l’acquisition de livres neufs : d’où proviennent les dons ?
Les dons proviennent essentiellement du désherbage des bibliothèques de la région qui sont conventionnées avec nous, mais aussi d’éditeurs, libraires, centres de documentation et d’information, de particuliers.
Nous faisons en sorte d’effectuer nos achats de livres neufs auprès des éditeurs ou libraires des pays partenaires, pour soutenir la chaîne du livre.
De quels types de documents manque-t-on le plus dans les bibliothèques dont vous vous occupez ?
Le manque touche tous les domaines, car même lorsqu’il y a des livres, ceux-ci souvent sont anciens ; les ouvrages de référence (encyclopédies, dictionnaires, usuels, documentaires incontournables dans les grands domaines de la connaissance …) font souvent défaut et nous n’en recevons pas autant que nous en envoyons. Les demandes portent bien souvent sur des fonds jeunesse, qui constituent 60 % de nos envois.
Au Congo-Brazzaville La bibliothèque d’un de nos partenaires après notre donation qui a fait des heureux !
L'Encred s'occupe d'enfants des rues à Brazzaville
Photo : Bernard Nzaba
Avez-vous aussi les moyens d’intervenir auprès des autorités de ces pays, pour que les dons n’aient plus de raisons d’être ?
Nous travaillons de plus en plus avec les autorités des pays, nationales (Ministère de la Culture du Liban) ou locales (Wilaya d’Alger, Gouvernorat de Bethléem). Nous essayons de les engager dans un véritable partenariat, dans lequel ils puissent s’engager sur une politique d’acquisition, la mise à disposition de personnel, l’aménagement de locaux…
Il s’agit là d’une sensibilisation, nous « semons des graines », toutefois une politique de lecture publique dépend des décisions de chaque État.
Le troisième axe est la formation de bibliothécaires in situ et l’accueil en France de stagiaires. Dans quels pays le métier de bibliothécaire est-il le plus en péril ?
C’est un métier émergeant, le plus grand danger pour cette profession c’est que le pays soit en proie à la guerre ou au fanatisme idéologique.
En quoi consiste la formation dans ces pays ?
La formation consiste à donner aux personnels des outils de base en bibliothéconomie, ou des spécialisations : littérature jeunesse, animation, aménagement d’une bibliothèque, reliure…
C’est surtout donner une autonomie au personnel pour que le projet vive à long terme, en validant les pratiques déjà en place et en ouvrant sur de nouveaux aspects du métier.
Devenir bibliothécaire dans un pays où il y a peu de livres … Quelle est la motivation des professionnels que vous formez ?
Les personnes formées sont quelquefois des bénévoles souhaitant se professionnaliser et accéder à un emploi plus qualifié, ou bien ils sont déjà en poste mais ont une volonté profonde de mieux répondre à la demande des lecteurs. Tous considèrent que la lecture est un des enjeux essentiels du développement de leur société.
Comment les stagiaires étrangers voient-ils les bibliothèques françaises ? Que font-ils pendant leur stage ?
Pour les stagiaires, les bibliothèques françaises, grâce à leurs moyens financiers et humains, à leur organisation, constituent pour eux un cadre de référence. Mais en tenant compte de leur réalité de terrain, nous cherchons toujours à leur faire effectuer leurs stages dans des bibliothèques correspondant à leur propre contexte : bibliothèque en milieu rural si le stagiaire vient d’un village, bibliothèque spécialisée dans des domaines équivalents, etc. Et puis nous avons axé les accueils de stagiaires sur l’échange des savoir-faire et pratiques professionnelles ce qui donne à leurs séjours une dimension humaine très fructueuse. En résumé, nous définissons ensemble les objectifs du stage ainsi que les tâches à effectuer, dans le but de répondre au mieux à leurs besoins et attentes.
Les suivez-vous, une fois qu’ils sont rentrés dans leur pays ? Quels retours avez-vous ?
Les stagiaires nous font un rapport de stage. Les retours sont variables selon les pays, des missions d’évaluation complètent notre suivi. Souvent nous pouvons constater au fil du temps les aménagements des bibliothèques et les changements de pratiques lors de nos missions.
Que retirez-vous de ces rencontres avec des professionnels étrangers ?
C’est un enrichissement mutuel, qui nous relie au sens premier de notre métier.