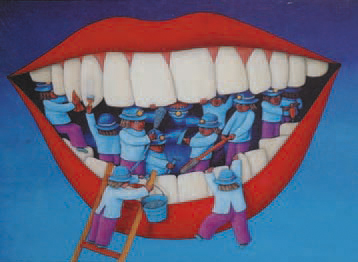Île-de-France
AUROC – Association […] OCLC
Paris 5, 6, 7, 9, 11
Cergy-Pontoise
Marne-la-Vallée
Bibliothèque Cujas
Bibliothèque d’art et d’archéologie
Bibliothèque des langues orientales
Bibliothèque interuniversitaire scientifique Jussieu
Académie nationale de médecine
Institut de France
MNHN – bibliothèque centrale et Musée de l’Homme
École française d’Extrême-Orient
Observatoire de Paris-Meudon
École supérieure des sciences économiques et commerciales.
En Île-de-France, sept SCD d’université et une dizaine de bibliothèques universitaires ou interuniversitaires font partie du réseau AUROC – Association […] OCLC. « Du Ohio College Library Center à Online Computer Library Center » p. 6 dans le n° 7 d’Arabesques juil. – août - sept. 1997.
Les deux services de la documentation de Paris V et Marne‑la‑Vallée se présentent ci‑après.
La bibliothèque hors les murs
Avec la généralisation de la documentation en ligne, à l’Université de Paris‑5 comme ailleurs, la bibliothèque offre un nombre croissant de services hors de ses murs. Chercheurs et enseignants consultent la documentation depuis leur bureau – du moins quand ils en ont. Car à Paris plus qu’ailleurs, le manque d’espace en général et de bureaux en particulier fait que le chercheur travaille parfois hors des limites territoriales de l’université.
La bibliothèque se doit de satisfaire la demande des utilisateurs d’accès distant, que ce soit depuis une structure à laquelle ils appartiennent, depuis leur domicile ou de tout autre point. Autre exigence, l’accès doit pouvoir être possible indépendamment du réseau utilisé, (Renater, fournisseurs d’accès Internet privé, par câble ou RTC, réseaux institutionnels tels que celui de l’assistance publique, etc.). Ces modalités d’accès doivent être compatibles avec les accords et contrats d’utilisation passés avec les fournisseurs. Si nous nous donnons les moyens de garantir au fournisseur une utilisation légitime et vérifiable des services souscrits, nous pourrons passer de la logique géographique qu’impose le contrôle par adresse IP à une logique de communauté à desservir indépendamment du lieu de consultation.
Une clé personnelle unique
Certains fournisseurs, tel Elsevier, offrent cette possibilité par l’attribution d’une identification personnelle. Cette solution ne peut qu’être ponctuelle. La généralisation de ce dispositif nous conduirait à devoir fournir à chaque utilisateur (plus de 30 000 pour Paris 5) autant de clés que de services distincts (soit 30 000 x N ! !). Pour atteindre cet objectif nous sommes à la recherche de solutions techniques qui nous permettent d’offrir à nos utilisateurs un accès distant à nos services à travers une clé unique. Sans rentrer dans les détails, une telle solution exige la possibilité d’identifier les utilisateurs (d’où la nécessité de disposer d’un annuaire complet et régulièrement mis à jour), de définir les droits de chaque type d’utilisateur et de mettre en place des mécanismes de translation (translation d’IP ou d’identifiant), de sorte que les fournisseurs autorisent l’accès à nos utilisateurs. Le service commun de la documentation ne peut se lancer seul dans ces opérations. Nous avons bon espoir de voir aboutir une démarche commune à l’ensemble des services de l’université.
Décloisonnement des services
Qui n’a pas entendu des discours sur l’inutilité des bibliothèques le jour où tout sera numérisé, annonçant leur future disparition. Il n’y a pas lieu de relancer ce débat. Actuellement, pour une lecture continue, aucun support de lecture aussi ergonomique, performant et économique que le livre n’a été trouvé.
Les supports s’additionnent, on assiste à des déplacements, rarement à des disparitions : l’art pariétal ne s’est jamais aussi bien porté que de nos jours. Mais la question d’un nouveau modèle de bibliothèque tenant compte des évolutions récentes se pose. La généralisation du support numérique conduit à une convergence d’intérêts et de pratiques entre services jusque‑là distincts. Quelle différence y a t’il entre l’ordinateur d’une salle d’informatique et un ordinateur en libre accès en bibliothèque ? Peu ou pas, si ce n’est que la salle informatique mobilise un appariteur pour quelques machines alors que si elles étaient situées dans un même lieu, exigeant de passer par un même point d’accueil, d’orientation et de contrôle, le service s’en trouverait amélioré et ce à charge de personnel égale. De ce constat, a émergé l’idée d’une plate‑forme de services à valeur ajoutée, où se trouvent réunis l’outil informatique, l’accès à la documentation sur tout type de support, les services d’assistance et d’orientation.
Convergence d’objectifs avec la pédagogie
Cette recherche de rationalisation des moyens converge avec les objectifs de la pédagogie ; en particulier avec les projets en cours de deux composantes de notre université parmi les moins bien loties en termes de locaux de bibliothèque.
L’unité de formation et de recherche d’odontologie – l’UFR d’Odontologie. – a mis en chantier une révision de ses stratégies de formation dont l’objectif est de rendre l’étudiant plus autonome dans l’acquisition des connaissances. Pour cela, elle a exprimé le besoin de disposer d’un vaste espace regroupant toutes les ressources documentaires, sur tous supports, des locaux permettant le travail en groupe (2 à 8 places). Ces « alvéoles » devant être situés de façon à permettre la consultation de documents papier et l’accès aux données numériques en ligne ou implantées sur un serveur local. Cette plate‑forme doit aussi permettre de conduire des actions de formation à l’informatique et au traitement de l’information pour tous les partenaires de l’UFR – étudiants, enseignants, chercheurs, personnels IATOS, consultants extérieurs… Le projet intégrant même la possibilité d’accéder à des outils d’autoformation, tutorée ou non, doit permettre à l’étudiant d’acquérir et vérifier ses acquis selon ses disponibilités, aussi bien pour certains modules que pour les langues. Autre caractéristique commune avec le second projet : l’importance accordée à l’analyse et au traitement de l’image statique ou en mouvement. De ce fait, pédagogie, recherche, service audiovisuel, service informatique et bibliothèque sont conduits à travailler étroitement ensemble, organiser leur travail en étroite coordination, faire partie de la même équipe. Cette modification dans l’organisation se matérialise dans le fait de partager très concrètement les mêmes espaces. L’intégration devient visible, palpable, inscrivant dans les murs de nouvelles modalités de fonctionnement. L’organisation de l’espace les renforce et contribuera certainement à les pérenniser.
Espaces partagés
L’UFR des sciences du sport – STAPS – confrontée à des problèmes documentaires importants (absence de bibliothèque pendant quelques années, dégâts des eaux), a été conduite, au moment de l’intégration de la bibliothèque au service commun de la documentation, à des interrogations et une démarche semblable. La réflexion sur ce que pourrait être un Centre technique documentaire a pris un tour très concret du fait d’une réorganisation des locaux rendue indispensable pour la mise en conformité de ce bâtiment vétuste et dégradé. L’équipe enseignante met du baume au cœur des bibliothécaires quand elle exprime le souhait que « la documentation soit considérée comme un outil pédagogique et partie des capacités de la composante » et que la « collaboration bibliothécaires/enseignants doit se retrouver à chaque étape charnière de la pédagogie et doit se vivre comme un relais des uns vers les autres dans les 2 sens ». L’appropriation de l’outil documentaire est totale, du moins dans son expression, quand il est souligné que la politique documentaire ne peut exister sans la participation du corps enseignant.
Un assemblage de cellules
Comme cela arrive souvent, le premier parti n’est pas le premier arrivé. Pour l’odontologie, le projet est lié à une nouvelle implantation au sein de notre université, qui devrait voir le jour prochainement. Le projet STAPS commence à prendre forme. Les architectes en sont à la définition de l’APS, l’avant projet sommaire. Ainsi les CTD, le centre des techniques documentaires doit occuper l’ensemble d’un « plateau ». C’est-à-dire, compte tenu de la configuration du bâtiment, l’espace continu disponible le plus ample. L’aménagement privilégie les petites salles de travail en groupe pouvant accueillir de deux à cinq personnes ; des espaces de lecture traditionnels sont tous également câblés de façon à pouvoir évoluer si besoin. Deux salles informatiques de 20 et 40 places sont apposées à cet ensemble. Elles sont accessibles à partir des circulations générales du bâtiment quand elles sont utilisées pour un cours et le reste du temps en passant par l’accueil général. Les bureaux et ateliers techniques (traitement des documents, informatique et audiovisuel/multimédia) sont rassemblés de façon à créer un esprit d’équipe entre personnels de statut (enseignants, bibliothécaires, IATOS) et rattachement administratif (SCD, UFR, services généraux) distincts.
L’accueil est conçu comme un point particulièrement sensible du dispositif car il doit remplir des fonctions de communication de tous types de documents (papier, vidéo, numérique) mais également de matériel (portables, caméras, vidéoprojecteurs, etc.), ainsi que de réception et d’orientation pour tous les types d’utilisateurs de cet espace. Cette complémentarité de services est conçue de manière à optimiser les ressources humaines pour faire coïncider, autant que possible, les heures d’ouverture du centre avec celles du bâtiment.
Illustration tirée du Dentiste à la carte de Yvette et Yvon Israel. Le dessin est de Slobodan.
Section Odontologie du SCD de Paris 5
Un renforcement des missions
Dans cette nouvelle configuration spatiale où un même espace est utilisé pour la recherche documentaire, le travail en groupe ou individuel accompagné pédagogiquement, la réalisation d’exercices en auto‑formation ou d’entraînement, la réalisation de documents écrits ou multimédia, où un même lieu est salle de cours ou bibliothèque selon les heures, les limites spatiales et administratives de la bibliothèque deviennent floues. Sortie des murs, décloisonnée administrativement, mais fragmentée intérieurement, où les grandes salles de la bibliothèque‑cathédrale sont remplacées par des alvéoles, la bibliothèque perdra‑t‑elle son âme ? Rien n’est moins sûr : les missions essentielles du bibliothécaire – mutualisation, organisation et mise à disposition de la documentation sur tous supports – s’en trouvent renforcées.
Nous attendons, dès novembre, du système universitaire de documentation, qu’il nous aide aussi, à sa façon, à remplir ces missions.