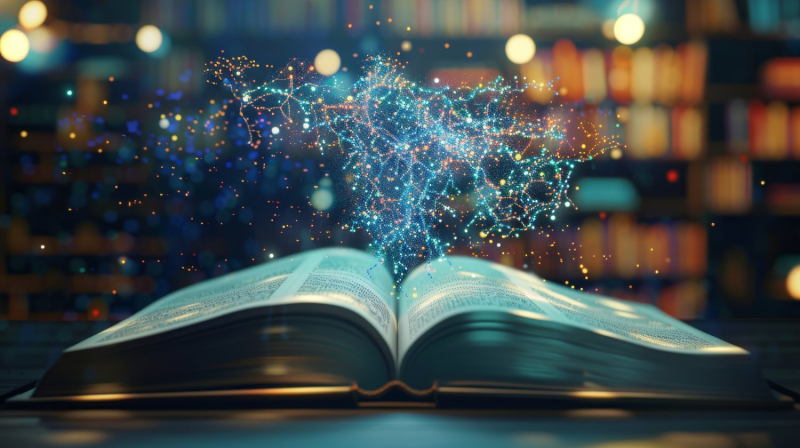Le décret n° 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur lui fixe comme première mission de « recenser et localiser les fonds documentaires des bibliothèques de l'enseignement supérieur dans le but de faciliter l'accès aux catalogues bibliographiques, aux bases de données ainsi qu'aux documents » (article 2).
L'Abes est donc née pour réaliser le catalogue collectif Sudoc. Ainsi chaque année depuis sa création (sauf en 2020), ont été « déployés » dans le Sudoc des fonds issus de nouveaux établissements. Mais cette pratique vaut d'être interrogée aujourd’hui : comment cette mission centrale a-t-elle été historiquement interprétée et que signifie-t-elle au regard du nouveau Projet d’Etablissement ? A l'heure où on parle d'adapter le décret de l'Abes, et en particulier l'article 2 qui décrit nos missions, comment cet objectif initial peut-il être renouvelé plus de 30 ans après ?
La naissance du Sudoc
Il faut d'abord noter que ni l'Abes ni le Sudoc ne sont créés ex nihilo : la « création » du Sudoc consiste en la fusion de 3 catalogues communs préexistants et complétée du catalogue d'un réseau spécifique aux périodiques, qui réunissaient les bibliothèques quel qu’en soit le ministère de tutelle.
Le premier d’entre eux, SIBIL-France, est à la fois un logiciel et un réseau, mis en œuvre à Montpellier en 1982 sur la base d'un logiciel développé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, et exploité sur les machines du Centre national et universitaire sud de calcul (le CNUSC, à Montpellier), ancêtre du CINES. Dès le départ, l'objectif est bien de constituer un réseau des BU françaises dans une logique de catalogage partagé.
Le réseau Auroc, appuyé sur OCLC, son catalogue international et ses logiciels, se développe dans les années 1990, mais plutôt dans une logique de catalogage dérivé, étant donné la taille du réservoir proposé par OCLC.
Enfin, un certain nombre de bibliothèques de l'enseignement supérieur participent quant à elles au réseau BN Opale, géré par la Bibliothèque nationale.
Le catalogue Sudoc jusqu'au début de 2002, c'est donc d’abord, largement, la reprise de ces réseaux, qui intègrent d'ores et déjà des fonds de bibliothèques qui ne sont pas, au sens du décret de création de l'Abes, des « bibliothèques de l'enseignement supérieur ». SIBIL-France, pour ne prendre que cet exemple, comprenait les fonds de la bibliothèque de l'Institut Occitan de Cultura (CIRDOC) à Béziers, ceux de la bibliothèque des archives départementales de l'Hérault, ou de la bibliothèque municipale de Lunel. D’ailleurs, toutes n’y restent pas. Dès le départ, l'interprétation de la notion de « bibliothèque de l'enseignement supérieur » est donc assez souple et pragmatique.
Crédit photo Adobe Stock – VK Studio , généré à l’aide de l’IA
La spécificité du réseau Sudoc des publications en série, ou Sudoc PS
Par ailleurs, les périodiques représentent dès le départ un sujet spécifique, qui fait l'objet d'une organisation et d'un traitement à part : le réseau Sudoc PS (Système universitaire de documentation pour les publications en série) s'inscrit en effet dans la continuité du CCN-PS (Catalogue collectif national des publications en série), dont les données historiques sont intégrées au Sudoc et dont la production courante obéit à des règles particulières. Existant depuis la fin des années 1980, son périmètre est bien plus étendu que celui des bibliothèques de l’enseignement supérieur dites « déployées » puisqu’à celles-ci s’ajoutent des bibliothèques des collectivités territoriales ainsi que des centres de documentation du secteur privé ou associatif.
L’obligation de dépôt légal des thèses de doctorat sous format électronique, confiée à l’Abes par l’arrêté d’août 2006, représente une autre évolution du périmètre. L'Abes intègre ainsi dans son catalogue des institutions habilitées à délivrer le doctorat, quel que soit leur lien administratif avec le ministère de l'enseignement supérieur. C’est le cas, par exemple, de l’Ecole polytechnique, sous tutelle du ministère des Armées.
Au fil des années, les critères d'entrées dans le Sudoc se transforment donc imperceptiblement, et l’acceptation du déploiement repose de plus en plus essentiellement et uniquement sur la pertinence et l’intérêt des collections proposées dans le contexte de l’enseignement supérieur. Ainsi, la réponse est évidemment positive pour l'INSEE, dernière grande bibliothèque entrée en 2019, qui dépend du ministère de l’Économie et des Finances. L’INSEE n'a pas charge d'enseignement et ne délivre pas de diplômes, mais ses collections sont considérées indispensables pour les chercheurs.
Pragmatique quant au principe de l'entrée, la démarche est aussi pragmatique quant aux pré-requis techniques imposés. Il est un principe resté constant depuis l’ouverture du catalogue collectif : en théorie, une bibliothèque entre dans le Sudoc pour y signaler, non pas un fonds spécifique, mais l’ensemble de ses collections. En pratique néanmoins, les choses ne sont pas si simples : après les intégrations initiales des réseaux fondateurs, un déploiement ne signifie pas nécessairement le versement de l'intégralité du catalogue rétrospectif dans le Sudoc. Participer au catalogue collectif, c'est d'abord et avant tout contribuer au titre de ses collections courantes. Il peut ainsi se passer des années avant que le catalogue local ne soit intégralement repris et localisé.
Des déploiements par capillarité
Enfin, le réseau bouge naturellement au fil du temps : les bibliothèques fusionnent, divorcent plus rarement, s'intègrent parfois à des réseaux techniques partageant un même logiciel de gestion de leur catalogue, etc. Ce dernier point est crucial : toute l'organisation du réseau Sudoc est aujourd’hui liée à l'organisation technique de sa base de données, CBS, qui avait des contraintes techniques au moment de son implémentation initiale, et qui a aussi été adaptée pour prendre en compte ce réseau initial.
« Entrer dans le Sudoc » c'est, formellement, déposer un dossier qui est examiné et validé par le Conseil d'Administration dans les conditions évoquées ci-dessus. Techniquement, cela se traduit très simplement par la création d'un numéro de gestion propre à chaque établissement réuni sous un même SGB, l’ILN (pour Internal Library Number) qui permet d’identifier les collections de cet établissement.
Mais que se passe-t-il si un membre existant du réseau « absorbe » une nouvelle bibliothèque, institutionnellement ou simplement du fait d'un partenariat informatique autour d'un logiciel commun ? Côté Sudoc, cette intégration se résumera en une simple démarche technique qui associera le numéro de gestion de l’établissement membre aux collections de l’établissement « absorbe », par simple extension. Cette démarche ne fait l'objet d'aucune procédure particulière et c'est ainsi par « capillarité » qu'un certain nombre de nouvelles bibliothèques sont entrées dans le Sudoc. Au-delà de la question de principe : est-ce un problème ?
Pas nécessairement : il est normal que le Sudoc reflète les évolutions de son réseau. Mais, la compréhension et la maîtrise de la nature du réseau et de ses participants en sont de facto limitées : le réseau évolue de façon presque autonome, sans faire l'objet d'une analyse politique ou de choix collectifs.
Les déploiements demain
Dans le contexte d'un renouvellement à venir des outils logiciels utilisés pour le Sudoc, programmé dans le Projet d'établissement 2024-2028, ces questions vont connaître une nouvelle actualité. L'architecture technique du Sudoc et l'architecture politique du réseau doivent-elles restées étroitement liées comme elles le sont actuellement ? Si nos outils s'appuient demain sur de vastes bases de connaissance, qui agrègent des données et servent des besoins qui vont au-delà du simple catalogue de la bibliothèque, peut-on encore structurer nos relations en fonction du catalogage partagé de documents ? Que signifie « rentrer dans le Sudoc », ou plus largement « être membre des réseaux Abes » dans ce contexte ?
Et si l'intérêt des collections pour l'enseignement supérieur et la recherche est de facto le seul critère pris en compte pour décider de l'inclusion d'une bibliothèque donnée, indépendamment du statut administratif, sur quelles bases l'Abes, opérateur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, doit-elle gérer ce réseau institutionnellement hétérogène ? Doit-il y avoir un lien entre la production des données et leur exploitation ? Ce lien était historiquement naturel et implicite, associé à notre architecture technique et à la constitution initiale des réseaux. C’est moins évident aujourd’hui, où nos données sont sous licence Etalab et plus facilement récupérables par Z3950 ou par web services. Qu’en sera-t-il demain ?
L’Abes gère aujourd’hui des réseaux variés, autour des thèses, des autorités et identifiants, des publications en série, des archives et manuscrits… Demain, dans le cadre de la réinformatisation, il sera nécessaire de réfléchir à ce que signifie maintenir et gérer le « Système universitaire de documentation » pour l’enseignement supérieur et la recherche. Cette question, soulevée lors de la création du Sudoc, n’a jamais été véritablement réexaminée. Le passage à un nouveau système informatique nous offre l’opportunité de repenser collectivement les contours que nous souhaitons donner au Sudoc. Que ce soit en termes de services offerts, de modes de production ou de modalités d’adhésion, le réseau Sudoc est appelé à se réinventer dans les années à venir.