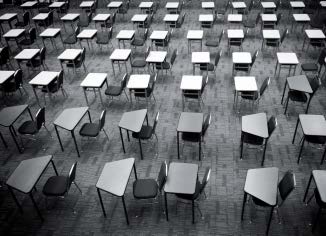Quelles sont les réponses apportées par les différents organismes de formation pour les métiers des bibliothèques aujourd’hui ? Bilan contrasté par Yves Alix, directeur de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib).
Les bibliothécaires constituent, dans leur environnement institutionnel, de micro-populations : dans la fonction publique territoriale, 36 000 professionnels soit 2 % des personnels ; à l’État, une filière comptant à peine plus de 6 000 agents et divisée en cinq corps statutaires. Même en agrégeant les agents d’autres filières ou d’autres métiers (informaticiens, documentalistes ou chargés d’études documentaires, ingénieurs de recherche, etc.) et les bénévoles formés par les bibliothèques départementales, l’ensemble reste numériquement faible et, ce qui est plus problématique, extrêmement morcelé.
Ajoutons à ce premier constat le fait que, avec l’irruption du numérique, les bibliothèques telles que nous les connaissons sont remises en question et leur utilité souvent contestée : le professionnalisme des bibliothécaires, dans ce mouvement, est souvent mis en doute (ou volontairement ignoré, pour éviter qu’ils n’interviennent dans le discours de dénégation et ne le fragilisent). Cette mise en cause est mal vécue par une profession qui a dû mener un long combat collectif pour se faire reconnaître et souffre de voir cette conquête, qui paraissait acquise pour longtemps, menacée de tous côtés : l’augmentation continue du nombre de bibliothèques confiées à des non professionnels en est le signe le plus manifeste.
Dans ce paysage, les organismes de formation doivent relever un double défi, en partie paradoxal mais inévitable : renforcement de l’expertise et de la technicité des métiers d’une part, ouverture aux autres métiers et mutualisation des compétences, d’autre part.
Paysage des formations initiales
Avant concours
De nombreuses universités proposent des formations professionnelles au niveau licence : diplômes universitaires de technologie (DUT) métiers du livre et du patrimoine proposés par les Instituts universitaires de technologie (IUT), diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques (Deust), licences professionnelles. On peut y ajouter les diplômes d’établissement. Mentionnons également les offres de masters, dont le positionnement est toutefois plus problématique comme formation avant concours, ainsi que le soulignait très justement, en 2013, Christophe Pavlidès1. La formation de base proposée par l’Association des bibliothécaires de France et les formations proposées par l’École des bibliothécaires documentalistes complètent le tableau.
Pour la très grande majorité des étudiants, ces formations débouchent sur des préparations aux concours, passage encore obligé du recrutement dans les deux fonctions publiques d’État et territoriale. Les Centres régionaux de formation (CRFCB) préparent les personnels d’État, les centres interrégionaux de concours du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les territoriaux. Même si des externes y sont admis, selon des modalités variables, ces formations s’adressent d’abord aux personnels en poste. Le centre national d’enseignement à distance peut être un recours pour les vrais externes soucieux d’augmenter leurs chances de succès à ces concours. L’enjeu est d’abord technique pour les concours de catégorie B et C, plus large pour les A, en raison du caractère généraliste des concours de conservateur et de bibliothécaire.
Le système des concours, que le monde entier nous envie ( !) est sans conteste le plus mauvais de tous… à l’exception de tous les autres. Tel qu’il fonctionne aujourd’hui, il a le mérite d’assurer un renouvellement homogène de la filière, dans toutes les catégories. Mais le prix est élevé. Le recrutement se fait toujours, pour l’essentiel, dans les mêmes disciplines (sciences humaines et sociales, littérature, histoire…) et la garantie d’équité offerte par le dispositif du concours n’empêche ni les injustices ni le maintien d’un volant d’au moins 20 % de personnels précaires, contractuels et vacataires.
Après concours
Deux schémas coexistent aujourd’hui, ce dont personne ne peut vraiment se satisfaire :
- Formation initiale (avec ou sans préparation à concours), concours, affectation. Logique, il suppose que la formation précédant le concours soit, du point de vue strictement professionnel, immédiatement opératoire. C’est une illusion. Et un danger de déprofessionnalisation manifeste, que s’obstinent par exemple à ne pas voir les employeurs territoriaux.
- Concours, formation, affectation (pour l’État) ou liste d’aptitude (pour les territoriaux). Conservateurs, bibliothécaires d’État et bibliothécaires assistants spécialisés reçoivent une formation initiale d’application post-concours. Les lauréats territoriaux, à l’exception des conservateurs, reçoivent seulement une formation d’intégration de cinq jours, toute autre formation relevant désormais, sous le vocable de professionnalisation, des parcours personnels de formation continue2.
Les acteurs, dans ce dispositif, assurent des missions différentes, au périmètre circonscrit, gage d’une complémentarité indispensable. Les CRFCB interviennent en amont : préparation aux concours pour toutes les catégories, formation post-recrutement des B d’État. L’École nationale des Chartes, qui recrute sur concours et délivre le diplôme d’archiviste paléographe, offre une formation initiale de haut niveau, profitant aux bibliothèques via le concours réservé de conservateur, voie cependant étroite, réduite à une dizaine de postes par an. L’Institut national d’études territoriales (Inet), service du CNFPT, a repris depuis janvier 2015 la formation post-concours des conservateurs territoriaux des bibliothèques3. L’Enssib assure celle des conservateurs et des bibliothécaires d’État. Mentionnons enfin le réseau des Unités régionales de formation à l’information scientifique et technique (Urfist), qui assure pour les personnels en poste dans l’enseignement supérieur et la recherche des formations à la maîtrise de l’information scientifique et technique.
Formation tout au long de la vie
Qu’on l’appelle ainsi ou, comme naguère, formation continue ou permanente, c’est certainement l’enjeu majeur de l’adaptation et du renouvellement des compétences pour tous les professionnels des bibliothèques. Cependant, si les acteurs sont en grande partie les mêmes, leur positionnement diffère, moins en raison d’une concurrence supposée sur un marché émergent (encore que…) que de l’absence d’une politique nationale en mesure de donner à l’offre sa cohérence et d’en augmenter l’efficacité. Au vrai, les textes qui ont réformé les dispositifs de formation continue ont été nombreux depuis la décentralisation, souvent contradictoires, et les lois les plus récentes, celles de 2004, 2007 et 2014, sont d’une grande complexité d’application4. Comment donner de la cohérence, et donc de l’attractivité – indispensable dès lors que la démarche de formation des agents repose sur le double volontarisme des employeurs et des agents eux-mêmes – à une offre aujourd’hui foisonnante, mais souvent dépourvue d’axe et ne parvenant que difficilement à anticiper les besoins et les demandes ? On peut envisager deux voies. La première, à laquelle doivent concourir en priorité les établissements, passe par la définition de « parcours-types » de formation, répartis en trois axes principaux : professionnalisation (s’adapter à son contexte et en comprendre les enjeux), spécialisation (personnaliser un parcours d’excellence et consolider une expertise), mise à niveau des compétences (actualiser ses connaissances, maîtriser les nouvelles techniques, suivre les adaptations de ses métiers). Chacun des trois axes vaut, à un moment ou un autre d’une carrière, pour tous les professionnels, sans préjudice de leur grade, de leur périmètre d’activité ou de leur tutelle.
La deuxième voie, qui découle de la précédente, est entre les mains des acteurs de la formation. Elle consisterait à dresser, à partir de l’analyse des besoins des publics, de la position et des missions assignées à chacun, ainsi que des moyens disponibles, une cartographie raisonnée de l’offre de formation. Ce pourrait être un projet fédérateur pour les prochaines années. Pour dresser cette cartographie, de nombreux outils sont déjà disponibles : les plans de formation des établissements, par exemple, déjà exploités mais pouvant sans doute l’être encore plus. Les plus utiles cependant, pourraient être les référentiels de formation, à condition de se lancer dans un travail long et difficile, mais certainement profitable, de synthèse et de fusion. Dans la tradition inégalée de notre beau pays, on s’ingénie à multiplier les référentiels au lieu de les rapprocher. Pour les seuls métiers des bibliothèques et de la documentation, on doit aujourd’hui approcher la vingtaine de référentiels, soit plus de cinquante définitions de métiers différents…
« Examination », Thomas Galvez
Flickr (CC BY 2.0)
Il est temps de faire la révolution
La révolution de la formation, académique ou professionnelle, initiale ou continue, opère aujourd’hui un renversement de perspective général : l’apprenant devient acteur de sa formation, la pédagogie s’inverse, on forme à apprendre, on forme à distance. Dans nos métiers, ces bouleversements rejaillissent à la fois sur les contenus des formations et sur les modalités d’apprentissage. Ils nous confrontent aussi à nos présupposés professionnels : niveau de technicité de nos métiers (évidemment relevé par le numérique et ses complexités), polyvalence réelle ou supposée, porosité entre métiers, élargissement ou, au contraire, resserrement des compétences, enjeux paradoxaux de la formation des cadres. De tels enjeux appellent des réponses plurielles, certes, mais construites en commun.