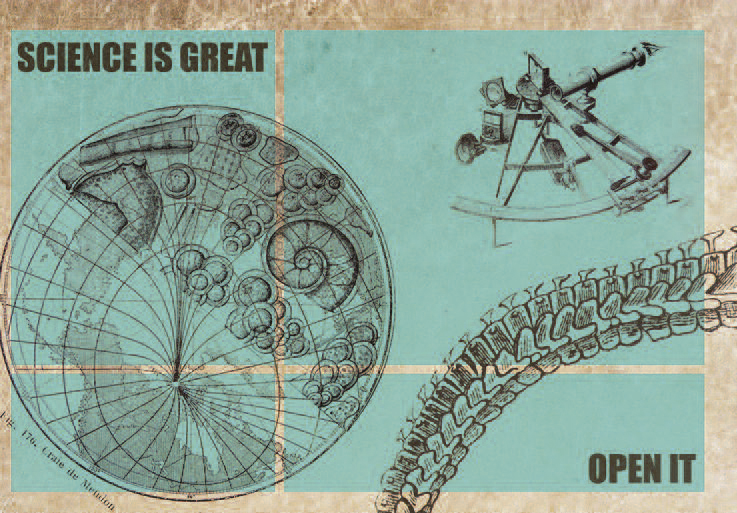Les évolutions de l’
open access soulèvent de nombreuses questions éthiques et politiques. Point de vue engagé de Jean-Claude Guédon, un des précurseurs du libre accès aux publications scientifiques, sur son histoire et ses enjeux.
Le libre accès aux publications de recherche a été motivé par deux facteurs indépendants l’un de l’autre : d’une part, le numérique naissant se prêtait à l’expérimentation de revues en ligne, dont les premières remontent à environ 1989 ; de l’autre côté, la crise liée à la croissance très rapide du coût des périodiques scientifiques a rendu aux bibliothèques l’espoir de revues moins chères, au fonctionnement plus souple et efficace. Elle les a aussi conduites à réexaminer leur rôle dans ce nouveau contexte, et l’exemple de collections d’articles en libre accès, comme ArXiv de Paul Ginsparg, en physique des hautes énergies, permettait d’imaginer le développement de tels dispositifs dans chaque bibliothèque.
Un peu d’histoire
Le mouvement en faveur du libre accès est relié, bien évidemment, au développement d’initiatives visant à promouvoir cette approche, mais il en diffère aussi en prenant une forme à la fois plus institutionnelle et politique. Déjà en 1995, l’Association of Research Libraries (ARL) aux États-Unis avait publié une brochure qui comprenait l’intervention de plusieurs chefs de file du libre accès, en particulier Paul Ginsparg, Stevan Harnad et Andrew Odlyzko. Diverses idées se mirent alors à circuler grâce à plusieurs listes de discussion disponibles sur Bitnet ou Internet.
Le choc décisif eut lieu en 2001. L’année d’avant, le prix Nobel Harold E. Varmus, un temps directeur des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis, et des chercheurs tels Michael Eisen (UC Berkeley) et Patrick O. Brown (Stanford), avaient lancé une pétition – la Public Library of Science (PLoS) – pour exiger des maisons d’édition qu’elles mettent les articles de recherche en accès libre, au plus tard six mois après leur publication ; sinon, les signataires de la pétition s’engageaient à ne plus soumettre leurs manuscrits à ces revues. Des dizaines de milliers de chercheurs signèrent, mais les pratiques de soumission, fortement affectées par des méthodes d’évaluation fondées sur le facteur d’impact, ne furent guère touchées par ce mouvement de protestation. En août 2001, PLoS se transformait en maison d’édition et, en décembre 2002, la Gordon and Betty Moore Foundation octroyait 9 millions de dollars à PLoS. Partiellement en réaction à l’échec de la pétition de PLoS, le Open Society Institute (OSI), maintenant connu sous le nom de Open Society Foundations (OSF), organisa une réunion à Budapest au début de décembre 2001. Cette réunion de 13 personnes comprenait Michael Eisen de PLoS et Stevan Harnad, ainsi que l’auteur de ces lignes. Peter Suber, également présent, a joué un rôle fondamental dans la rédaction d’un manifeste connu sous le nom de Budapest Open Access Initiative (BOAI) qui parut le 14 février 2002.
À Budapest, Stevan Harnad fut à peu près le seul à soutenir l’idée de l’auto-archivage des publications par les auteurs ; l’opinion dominante penchait fortement en faveur de la création de revues ou de la conversion de revues électroniques existantes en libre accès. Seule sa ténacité permit de maintenir cette option dans le manifeste et c’est fort heureux car sans la stratégie de l’auto-archivage, connue depuis sous le nom de « voie verte », il n’est pas sûr que le mouvement du libre accès aurait survécu ; inversement, sans revues en libre accès, il n’est pas sûr non plus que celui-ci aurait obtenu le degré de visibilité qui a assuré sa survie. Le démarrage en trombe des premières revues de PLoS démontrait que le libre accès permettait de lancer une nouvelle revue en deux ou trois ans au lieu des sept à dix ans requis pour une revue traditionnelle. La leçon ne fut pas perdue pour les grandes maisons d’édition, et ce d’autant plus que Jan Velterop, un des 13 premiers signataires du BOAI, dirigeait alors Biomed Central et allait bientôt (2005) travailler chez Springer pendant trois ans.
Une façon de voir l’évolution du « gold » : du Big Deal aux APC
La carrière de Jan Velterop peut utilement constituer un fil d’Ariane pour suivre l’accueil du libre accès par les maisons d’édition, en particulier les multinationales de l’édition scientifique. Fin affairiste, Velterop a souvent agi en pionnier au sein de diverses maisons d’édition, tout en maintenant un contact étroit avec le mouvement du libre accès. Son objectif général peut être déchiffré ainsi : convertir les maisons d’édition au libre accès tout en préservant leur position centrale ou dominante dans le système de la communication scientifique, ce que certains en France appellent un peu pudiquement, ou par litote, le rôle de « médiation » des maisons d’édition. Velterop révèle ainsi les étapes et moments qui ont accompagné l’évolution des maisons d’édition : après avoir collaboré à la mise au point des bouquets de revues (Big Deal), il a expérimenté le premier grand plan d’affaires de la publication en libre accès chez Biomed Central avec les « Article Processing Charges » (APC), qui demeure central jusqu’à nos jours. La réaction générale des maisons d’édition était alors de faire la sourde oreille à ce message, ou d’en rire. L’exemple de Biomed Central a été déterminant pour la mise au point de la stratégie financière de PLoS One environ deux ans plus tard.
L’arrivée de Velterop chez Springer coïncide avec la nouvelle stratégie de cette maison d’édition : le « open choice » grâce auquel elle offrait à tout auteur la possibilité de « libérer » son article en payant une somme, souvent assez coquette, se justifiant comme correspondant à l’APC des revues en libre accès. Cet ajout au plan d’affaires des revues avec abonnements a constitué la base des « revues hybrides » ; or, celles-ci sont souvent critiquées par le fait que les articles libérés réduisent d’autant le nombre d’articles offerts par la revue par abonnement, sans que cette réduction diminue le coût des abonnements. Springer n’a fait qu’inventer une nouvelle source de revenus à ses revenus traditionnels.
• Des stratégies fondées sur des modèles commerciaux…
La trajectoire de Jan Velterop illustre une façon d’explorer les possibilités du libre accès dans la perspective d’un avantage pour les maisons d’édition, dans le but de préserver leur rôle et leur capacité de contrôle dans la chaîne allant des auteurs aux lecteurs. Velterop a toujours su tenir un double discours : avec le Big Deal, il avait permis aux maisons d’édition de défendre cette pratique en invoquant la réduction du coût par titre des abonnements. Bien entendu, le fait que les bibliothèques ne pouvaient plus gérer de collections était passé sous silence. Avec les « APC », le double discours se déploie tout aussi aisément : ce modèle économique offre effectivement des revues en libre accès, ce qui peut avantager l’ensemble des chercheurs s’ils ont une connexion Internet adéquate ; en revanche, les frais de publication retombent sur les chercheurs, les laboratoires, ou, le cas échéant, épuisent des fonds destinés à ce genre d’opération par les universités, les bibliothèques, ou même les organismes subventionnaires. La Grande-Bretagne s’est engagée à grande échelle dans cette opération. Mais les APC exigés se situent à des niveaux élevés et, de ce fait, constituent une barrière économique d’un nouveau genre pour les pays ou les institutions pauvres et les recherches non subventionnées. Enfin, le modèle économique fondé sur des APC touche massivement les sciences humaines, moins financées que les sciences de la nature, l’ingénierie ou les sciences médicales. Bref, la voie dorée avec APC se révèle profitable pour les maisons d’édition, mais elle soulève de nouvelles difficultés pour les communautés scientifiques, en particulier en renforçant les inégalités qui existent entre pays, domaines ou institutions.
Avec les revues hybrides, parfois présentées comme un mécanisme permettant graduellement aux maisons d’édition de passer en douceur au « gold avec APC », on découvre l’invention rusée d’une nouvelle manière de récupérer des fonds d’organismes subventionnaires et d’institutions de recherche (ou de leurs bibliothèques). De plus, la création des revues hybrides permet d’envisager l’existence immobile d’un ensemble mixte de publications qui s’appuie sur les revues existantes et qui peut durer indéfiniment. Malheureusement pour cette perspective, plusieurs organismes subventionnaires ont maintenant refusé de payer pour des revues hybrides, ou ont imposé de strictes conditions, par exemple en plafonnant les sommes consacrées à ce type de « libération ».
Martin Clavey / Flickr (CC BY-SA 2.0)
Après une phase de refus du libre accès, les maisons d’édition, en particulier les multinationales, ont vite compris qu’il leur était bien plus avantageux d’influencer l’évolution du libre accès en offrant des solutions où ces avantages sont habilement dosés au sein d’un ensemble de stratégies qui préservent et même accroissent leur pouvoir. Une partie de ce pouvoir s’exprime désormais par la possibilité de développer des revenus supplémentaires et d’augmenter les profits, comme il sied à toute compagnie qui doit rendre des comptes à ses actionnaires ou investisseurs.
• … aux plateformes internationales contrôlées par les chercheurs
Pour autant, il existe aussi toute une large frange de revues en libre accès qui sont libres pour les lecteurs (par exemple dotées de licences CC-BY) et gratuites pour les auteurs. Des plateformes internationales se sont constituées autour de tels projets, les deux plus importantes venant d’Amérique latine avec Scielo et Redalyc. Ils offrent des solutions où des subventions publiques sont compatibles avec la liberté éditoriale et la qualité des revues publiées, par exemple en s’appuyant résolument sur une structure multinationale. Ils rappellent aussi que le coût de la communication scientifique est très bas comparé aux coûts de la recherche hors publication, environ 2 % du total. Personne ne demande à la recherche scientifique de développer des plans de financement fondés sur des modèles commerciaux : le numérique permet d’imaginer un système de communication entre scientifiques intégré à la chaîne de travail propre à la recherche et contrôlé par les communautés de recherche. C’est précisément l’enjeu du libre accès, lorsqu’il place les chercheurs au centre de ses objectifs. Les communautés de recherche peuvent s’organiser autour de plateformes puissantes ou commencer à repenser la communication scientifique sous la forme de méga-revues, à la manière de PLoS One. Et si les APC disparaissent, la question des revues « prédatrices » disparaît aussi : un mode de financement sans risque – l’auteur paye tout, y compris les profits – engendre des comportements inacceptables.
La voie « verte » : des dépôts institutionnels à encourager
Perçu au début comme une stratégie problématique, en particulier à cause des contraintes imposées par le droit d’auteur et la façon dont les droits sont transférés aux maisons d’édition, l’auto-archivage a été rapidement repris par les bibliothèques. Les dépôts institutionnels se sont multipliés et leur ont permis d’offrir une vitrine institutionnelle qui pouvait soutenir leur volonté de se projeter dans le monde du savoir, mais, ce faisant, les besoins spécifiques des chercheurs n’ont pas toujours été au cœur de ceux qui concevaient ces nouveaux dispositifs de recherche. Rapidement, il est apparu que, laissés à eux-mêmes, les dépôts institutionnels n’attiraient qu’une petite fraction des documents publiés, de l’ordre de 15 à 20 %, et, par conséquent, ne pouvaient guère répondre aux besoins généraux des chercheurs.
En réaction à cette situation, de nombreuses institutions ont tenté d’instaurer une politique obligatoire de dépôt. Mais les chercheurs, presque par instinct, résistent à tout ce qui est obligatoire, même si on leur démontre que c’est à leur avantage. Pour réussir à obtenir un consensus sur ce sujet, il faut énormément de discussions, d’éducation, et des exemples probants. Tout ceci existe, mais les résultats restent mitigés.
• Des constats encore modérés
Tandis que OpenDOAR recense 2 874 dépôts institutionnels au 1er mai 2015, une autre base de données, le Registry of Open Access Repositories (ROAR), situé à l’université de Southampton, dénombre 4 009 dépôts institutionnels. Mais au niveau des politiques institutionnelles, les chiffres sont beaucoup plus modestes. Roarmap, par exemple, indique 482 politiques d’institutions de recherche, ce qui ne représente qu’environ 12 % de ces institutions ; de plus, nombre de ces politiques ne font qu’encourager le dépôt, sans réellement l’exiger. La politique de l’université de Liège mérite d’être soulignée : un certain nombre de procédures pour les promotions et les attributions de fonds s’appuie exclusivement sur les documents présents dans Orbi, le dépôt institutionnel de l’université, ce qui encourage très fortement les chercheurs à y déposer leurs publications. Mais dans un pays comme la France où l’évaluation des chercheurs s’effectue au niveau national, et non au niveau de l’institution, ce genre de pratique n’est pas facilement applicable, sauf à ériger Hal dans ce rôle national.
Les politiques adoptées par divers organismes subventionnaires de la recherche ont eu un très grand impact sur l’évolution des dépôts institutionnels. Les exigences de dépôt qu’ils formulent sont souvent les premières que rencontre une bonne proportion de chercheurs, ce qui, évidemment, facilite la compréhension du libre accès.
Dans le domaine de la santé, ces exigences sont apparues assez vite puisque, aux États-Unis, les National Institutes of Health ont lancé ce mouvement et une loi dans ce sens a été votée au Congrès des États-Unis à la fin de 2008. Plus rapide encore, le Wellcome Trust (Royaume Uni) avait une politique de dépôt obligatoire dès 2006. En 2014, la Commission européenne, dans le cadre du programme de financement Horizon 2020, a également établi une politique de dépôt obligatoire pour les publications émanant de son financement et une infrastructure – OpenAIRE – a été mise en place pour les accueillir.
L’Open Access Week, lancée en 2007, est un événement international annuel du monde scientifique marqué par l’organisation de multiples conférences, séminaires ou annonces sur le thème du libre accès.
Open Access Week 2013 (CC BY)
• Des modalités de dépôts à faciliter et encourager
Les dépôts institutionnels ont joué un rôle essentiel pour le développement du libre accès, mais leur progrès – des millions d’articles sont maintenant disponibles pour toutes et tous – demeure un peu décevant : ils ne sont guère perçus comme indispensables par les chercheurs et les obligations de dépôt sont plutôt considérées comme des agacements par beaucoup d’entre eux. Les règles de dépôt que les maisons d’édition s’ingénient à multiplier et, à l’occasion, à varier sans préavis, constituent autant d’obstacles supplémentaires pour des laboratoires qui ont bien d’autres choses à faire que d’étudier des contrats complexes à la lumière de ce que permet la loi locale de droits d’auteurs. Par ailleurs, la fouille de documents et de données par ordinateurs n’est pas toujours possible quand les maisons d’édition elles-mêmes insistent pour conserver le document de référence et veulent contrôler la fouille électronique de ces archives. Enfin, les bibliothèques, soumises à de fortes contraintes budgétaires, ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour aider les chercheurs à déposer la bonne version de leurs articles dans le bon format. Bref, dans leur configuration actuelle, les dépôts institutionnels ne remplissent qu’une petite partie des besoins réels des chercheurs, surtout lorsque ceux-ci fonctionnent de manière isolée, ce qui explique partiellement pourquoi l’obligation de déposer est importante. De plus, il leur manque deux éléments essentiels : d’une part, il leur faut apprendre à fonctionner en réseau pour offrir des ressources documentaires importantes ; d’autre part, il leur faut apprendre à créer de la valeur symbolique pour que les chercheurs, en déposant, aient le sentiment qu’ils sont en train d’accomplir quelque chose de positif pour leur carrière, leur visibilité et leur prestige. Bref, les dépôts institutionnels doivent évoluer en offrant des services qui ressemblent à ceux offerts par les revues, ou les complètent.
Conclusion
Posons un petit problème : comment se fait-il que le virus Ebola, découvert dans les années 70, et dont la létalité extrême a vite été repérée, n’ait pas fait l’objet de plus d’études, de plus de recherches ?
Serait-ce parce que les ressources financières des Africains sont faibles et que la recherche se porte sur des sujets soit plus lucratifs, soit plus directement d’intérêt pour les pays où se loge une majorité des chercheurs ? Comment oriente-t-on la recherche sur certains sujets et pas sur d’autres ? La réponse dépend en partie de l’économie politique des revues, de leurs modes de concurrence, et des décisions éditoriales qui se déploient dans un climat de compétition intense organisé autour du facteur d’impact. Or, la science fonctionne surtout au niveau des articles, au niveau des théories et des concepts, au niveau des idées et des données, et non au niveau des revues. Gérer tout ceci par une compétition entre revues, compétition en fin de compte fondée sur le profit, ne paraît pas la manière la plus assurée ou évidente de produire de la recherche de qualité.
Les luttes autour du libre accès s’organisent autour de ces enjeux d’orientation et de qualité de la recherche. Selon que l’on place au centre soit les chercheurs et la recherche, soit les maisons d’édition et leurs revues, on obtient des résultats très différents. Actuellement, le front est très élastique et le risque de voir le libre accès repris en main par les grandes maisons d’édition à leur avantage a augmenté ces dernières années, comme le montre le cas de la Grande-Bretagne. Mais si les communautés scientifiques et le monde des bibliothèques et des organismes subventionnaires se montrent soucieux de nourrir la « grande conversation scientifique » de manière rationnelle, alors le libre accès bien conçu apparaîtra naturellement comme le levier le plus puissant pour atteindre cet objectif.