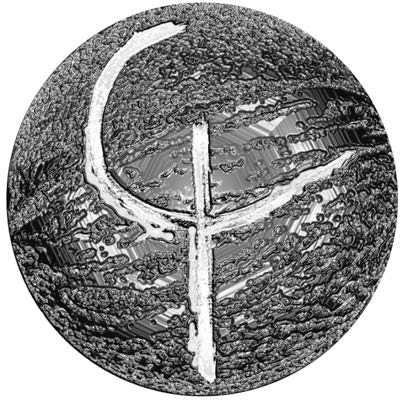Canal psy : À partir de quels terrains avez-vous élaboré votre réflexion sur la transmission ?
A. Ciccone : Trois types de clinique ont soutenu mes réflexions sur la transmission. Le premier concerne le champ de la psychopathologie précoce. Depuis plusieurs années je m’intéresse au dépistage des troubles psychiques précoces. J’observe, comme d’autres, la manière dont l’environnement transmet, à travers les interactions précoces – comportementales, affectives –, des contenus, des fantasmes dont le bébé va progressivement se saisir et qui vont organiser, ou désorganiser, sa subjectivité ou ses processus de subjectivation. Mais j’observe aussi la manière dont l’enfant lui-même stimule, ou pas, les potentialités parentales, la manière dont le bébé participe à organiser ou désorganiser la parentalité. Car la parentalité, en effet, n’est pas donnée en soi ; elle se construit dans la rencontre avec le bébé. Et la parentalité est particulièrement désorganisée lorsque, par exemple, le bébé est porteur d’une anomalie. Ainsi, le deuxième type de clinique à partir de laquelle j’ai modélisé les processus de transmission psychique est représenté par la clinique du handicap. Les effets traumatiques de la rencontre avec le handicap touchent particulièrement la transmission car le handicap désorganise la filiation, la généalogie. Enfin, le troisième type de clinique concerne les situations de répétition, et notamment de répétition d’échecs de la parentalité. Mon expérience concerne en particulier des patients qui font une demande de psychothérapie ou de psychanalyse parce qu’ils souffrent d’avoir été insuffisamment investis, reconnus, aimés par leurs parents, dont ils dénoncent et condamnent les conduites éducatives, tout en s’apercevant avec douleur qu’ils les répètent.
Canal Psy : Comment situez-vous votre approche relativement aux conceptions actuelles de la transmission psychique inconsciente ?
A. Ciccone : Il y a quelques années, Jean Guyotat, dont vous connaissez l’intérêt pour la question de la transmission, disait que je décrivais du dedans les processus qu’il avait essayé de décrire du dehors. Outre qu’elle m’honore sans doute trop, je trouve cette réflexion toujours pertinente. Mes travaux complètent les travaux actuels, ou les conceptions actuellement disponibles et utilisées par les cliniciens et les chercheurs qui travaillent la question de la transmission. J’ai essayé d’éclairer certains points laissés en suspens, ou omis. Les principales avancées que je propose concernent d’une part les modalités de transmission inconsciente que je modélise à partir des processus d’identification projective, et d’autre part les modalités d’intériorisation de la transmission, c’est-à-dire les manières dont le sujet se représente les transmissions qu’il a subies, autrement dit les manières dont il construit des fantasmes de transmission.
Canal Psy : Quelle modélisation proposez-vous de l’identification projective que vous considérez comme la voie royale de la transmission ?
A. Ciccone : L’identification projective est une notion complexe. Il faut en fait la considérer comme une notion plurielle et parler non pas de l’identification projective mais des identifications projectives. Cette notion regroupe un ensemble de processus qui articulent, par définition, un pôle projectif et un pôle identificatoire. Mélanie Klein, qui a décrit ce processus, mais qui n’en a pas exploré toute la richesse et toutes les conséquences, avait une conception profondément intersubjective du développement et du fonctionnement psychiques. Les différentes versions ou les différentes déclinaisons de l’identification projective représentent les processus qui permettent au sujet d’explorer l’espace mental de l’autre, d’y déposer des contenus pour s’en débarrasser ou pour les lui faire prendre en charge dans une relation de maîtrise, ou bien de s’approprier certains contenus, certains objets psychiques de l’autre, ou bien encore d’exercer une action sur l’autre, une influence engageant et transformant la subjectivité de l’autre. L’identification projective est ainsi le moyen par lequel se réalisent toute une série de transactions inter- ou transsubjectives. Ce processus est le principal vecteur des transmissions psychiques. C’est en tout cas ce que je propose, et j’ai développé l’idée selon laquelle toutes les modalités identificatoires contiennent, dans leur montage même, des éléments projectifs identificatoires par lesquels se réalisent les transmissions.
Canal Psy : En quoi consistent les fantasmes de transmission et quelles sont leurs fonctions ?
A. Ciccone : L’étude des fantasmes de transmission est tout à fait nécessaire, parallèlement à l’étude des modalités de transmission intersubjective ou transsubjective. Les fantasmes de transmissions sont des scénarios qui mettent en scène, qui dramatisent la manière dont le sujet se représente les transmissions qu’il subit ou dont il est victime. Ces fantasmes regroupent également les reconstructions dans lesquelles le sujet fait appel à la transmission pour rendre intelligible ou représentable une réalité énigmatique, traumatique. J’ai, en effet, décrit les fantasmes de transmission dans les contextes de transmission traumatique. De tels fantasmes ont essentiellement trois fonctions : la première est une fonction d’innocentation (« je n’y suis pour rien, tout vient d’un ancêtre ») ; la seconde est une fonction d’inscription dans la généalogie, notamment lorsque celle-ci est mise à l’épreuve, menacée, fracturée (si tout vient d’un ancêtre, le sujet porteur d’une altérité traumatique est donc bien inscrit dans une lignée généalogique, générationnelle) ; la troisième fonction, enfin, est une fonction d’appropriation, de subjectivation, le sujet devenant sujet d’une histoire étrangère qui s’impose à lui, dans le même mouvement qui le conduit à s’en dessaisir, ou à s’y soustraire. Les fantasmes de transmission réorganisent les transmissions traumatiques.
Canal Psy : Si on ne projette jamais rien en l’air, si on ne transfère jamais au hasard, qu’est-ce que cela implique quant à la compréhension et à l’utilisation du contre-transfert ?
A. Ciccone : Vous savez qu’il existe grossièrement deux conceptions du contre-transfert : l’une qui considère le contre-transfert comme un obstacle à l’analyse, et qui énonce que le contre-transfert doit être analysé pour être neutralisé ; l’autre qui considère le contre-transfert comme un outil d’analyse, et qui justifie l’analyse du contre-transfert par le fait que celui-ci renseigne sur les éléments non symbolisés de la situation clinique. Il est probable que les tenants de l’une ou de l’autre conception ne s’adressent pas aux mêmes patients, les premiers travaillant essentiellement dans le champ de la névrose, les seconds dans le champ de la psychose. Mais si l’on considère que le transfert, comme toute projection, n’a jamais lieu au hasard, qu’il nécessite un certain nombre de conditions dont la présence, chez le destinataire du transfert, d’éléments ou de processus suffisamment semblables à ceux transférés, ou de processus dont le travail dans l’espace psychique du destinataire a aménagé une zone susceptible d’accueillir, voire d’attirer, les contenus transférés, on peut alors voir se rejoindre ces deux conceptions apparemment antagonistes. Il me semblerait par ailleurs intéressant de développer une proposition de Salomon Resnik selon laquelle plutôt que de parler de transfert et contre-transfert, il vaudrait mieux parler de double transfert, car l’analyste transfère et projette tout autant que le patient.
Canal Psy : Votre étude donne-t-elle des pistes pour penser les blessures affectant la mémoire collective et la façon dont elles sont transmises et peuvent être réorganisées ?
A. Ciccone : Je crois que la notion de fantasme de transmission, dont la version consciente est représentée par les mythes, les romans, les histoires que l’on construit autour des transmissions traumatiques, ou autour des traumatismes transmis, peut tout à fait être utile pour penser les traumatismes collectifs et leur transmission, et pour penser la manière dont, par de tels fantasmes, la transmission est réorganisée.
Canal Psy : Pourrait-on dire que, tant sur le plan du sujet que sur celui de l’histoire collective, l’enjeu du travail psychique est de pouvoir transformer l’origine en devenir ?
A. Ciccone : Tout à fait. L’origine est toujours en devenir. La question de l’origine n’est pas une question archéologique. Elle est avant tout et essentiellement une question téléologique. La transformation de l’origine, qui est en effet l’un des enjeux essentiels du travail psychique, suppose un travail d’intégration, de subjectivation. Mais elle suppose aussi un travail de réparation, réparation des blessures, des fractures, des effets de la destructivité que contient l’origine. On peut d’ailleurs dire que la réparation est la principale modalité d’intégration. On peut bien sûr l’observer à l’échelle du développement psychique d’un sujet, mais aussi à l’échelle de l’histoire d’un groupe, d’un groupe social, d’une nation. Les exemples ne manquent pas. Mais les exemples ne manquent pas non plus pour illustrer combien le travail de réparation est fragile et doit être protégé. Avant de clore cette interview, j’aimerais profiter de cette occasion pour signaler que La transmission psychique inconsciente est le dernier livre que Didier Anzieu a vu publié dans sa collection, « Psychismes », dont il était toujours le directeur, et pour lui rendre hommage en soulignant la richesse de ce qu’il a transmis, du fait de sa créativité, de sa générosité, de son intelligence, et de sa conception très humaine de la psychanalyse.