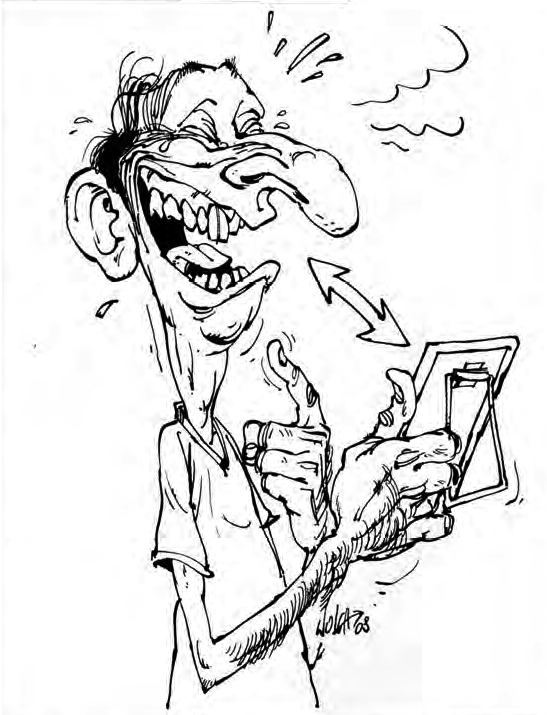Lorsque nous lisons un livre ou un article sur l’humour nous nous attendons à découvrir de bons mots d’esprit ou quelques blagues inédites. Ce n’est hélas pas souvent le cas. Ici je tâcherai de faire un effort ! Dans son ouvrage Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient Freud cite un bon nombre d’histoires drôles, succulentes parfois, toutes empruntées à la tradition yiddish. Cela nous interroge d’emblée sur les rapports de l’humour avec la culture, l’événement historique et les traditions, et sur sa fonction et finalité. J’aborderai dans ce court essai la question du plaisir et celle de la créativité.
Ayant recueilli depuis les années cinquante toutes les histoires drôles que l’on me racontait (et qui il est vrai étaient loin être toutes humoristiques) j’ai en effet remarqué qu’il y avait des thèmes et des modes à des époques très précises : histoires de l’après-guerre, histoires de la guerre froide (sur le régime soviétique, souvent les mêmes que sous le régime nazi : - Un policier arrête un passant et lui dit : Est-ce que vous pensez la même chose que moi ? - Ben, oui ! - Bon ! je vous arrête !), histoires surréalistes des années 1970 (C’est loin l’Amérique, Maman ? Tais-toi et nage !), shaggy dog stories anglaises (J’ai observé votre chien pendant le film, c’est incroyable comme il réagissait et semblait l’apprécier ! - Oui, cela m’étonne aussi car il n’a pas du tout aimé le livre !), histoires belges, juives (Tiens salut, Moshé ! T’as pris une douche ? - Pourquoi ? Il en manque une ?), suisses, histoires racistes, histoires de blondes, histoires des pays de l’Est, etc. L’histoire drôle pourrait être la version moderne du conte en ce qu’elle témoigne d’événements sociaux, politiques et humains mais généralement en moins élaborée et sans la richesse métaphorique que l’on connaît.
Julien Wolga
Ces histoires, dont on ne connaît que rarement l’inventeur, sont constituées au départ comme une interprétation personnelle d’un événement ou d’une situation. Ce sont des façons particulières de voir et de vivre le monde, en prenant beaucoup de liberté, du plaisir et en faisant preuve de créativité.
L’humour est un sujet qui a suscité de nombreux écrits et analyses depuis les travaux de Freud. La plupart de ces travaux reprennent les idées exposées par Sigmund, en particulier sur la fine différence qu’il fait entre le mot d’esprit (petit coup de patte jouissif et agressif) et l’humour (façon de se faire plaisir sans trop consommer d’angoisse et de culpabilité).
Dans ses analyses Freud insiste sur l’aspect interrelationnel de l’humour et du mot d’esprit : l’un et l’autre nécessitent à ses yeux la présence de trois personnes : l’auteur du mot, la victime et un témoin.
Clemenceau recevant à l’Assemblée nationale un député paysan qu’il n’aimait pas lui lança « Quel bovin vous amène ! »
Voilà un bel exemple de bon mot qui apporte jouissance à l’auteur et aux spectateurs, et honte à la victime. Oui, humour et mots d’esprits sont des rhétoriques à risque. Les Anglais disent : « Ne racontez jamais une blague qui puisse vous faire perdre un ami, sauf si la blague est meilleure que l’ami ». C’est dire la force de la fonction libidinale attachée à cette pratique. Le côté « provocation » de l’humour est connu comme les joutes entre raconteurs de blagues. Par exemple dans la tradition juive il est de coutume, lorsque l’on vous raconte une blague, de dire : « Je la connaissais ! » puis « Tu la racontes mal ! » et « J’en connais une meilleure ! ».
« C’est le moi qui en est le grand bénéficiaire » : la question est de savoir de quels réels bénéfices le moi profite au-delà de cette apparente économie d’émotion, d’affects, de conflit interrelationnel, de remords et de cette ouverture non dangereuse aux fantasmes, contenus et interdits, archaïques. Il me semble que la position de l’humoriste ne le place pas dans une très grande neutralité métapsychologique où les pulsions seraient flottantes, anesthésiées, peintes à l’aquarelle, évaporées.
En premier lieu il faut rappeler que le monde de l’humoriste n’est à ses yeux un monde ni parfait ni très heureux. Comme le clown, on lui a souvent renvoyé sa tristesse cachée, sa dépression et sa vision sarcastique du monde, en somme une certaine misanthropie.
Louis Porcher décrit très bien cette attitude en comparant l’humour au tango : « Une pensée triste qui se danse ». L’humour juif de tradition yiddish en est un bon exemple et confirme que l’une des premières qualités de l’humoriste est de pouvoir rire de lui-même, de ses défauts, de ses conditions de vie, de ses désespérances, de ses rêves et cauchemars. L’histoire drôle prend alors une forme de parabole, de métaphore sur les questions angoissantes de la vie comme dans ce court dialogue de deux juifs polonais au début du XXe siècle : « Tu sais je crois que je vais émigrer. Je vais partir en Australie » - « En Australie ! Mais c’est loin, très loin ! » - « Oui, c’est loin, mais loin d’où ? ». Et cette pensée citée par Freud « L’idéal serait de n’être pas né ! ». Façon, dit-il, de relativiser son destin.
Comme le schizophrène, l’humoriste construit un monde à sa façon ; mais lui n’y croit pas ou il fait semblant d’y croire. Le temps de raconter l’histoire, de la partager, le temps d’en rire et d’en sourire est son moment délirant à lui. Une façon d’échapper à la peur, l’inquiétude et la tristesse. À l’effondrement. On s’est souvent interrogé sur les aptitudes à l’humour qu’avaient les patients « réputés schizophrènes » et psychotiques, les mettant en doute du simple fait que l’accès au symbolique et le partage des métaphores culturelles habituelles ne sont pas leur fort. Il n’en est rien et tout clinicien et soignant fréquentant ces patients sait qu’ils sont aptes à jouer avec le réel et le langage. À leur façon, et sur un mode sans doute assez surprenant car plus proche du non-sens et du surréalisme que du bon jeu de mots classique. Et ils en obtiennent une certaine forme de jouissance (Bergeret souligne le côté plaisir préliminaire). Ils ont le verbe comme zone érogène.
Julien Wolga
On peut aussi ajouter que l’humoriste, comme le schizophrène, a un lien privilégié avec certains contenus inconscients et dispose d’aptitudes d’associations de pensées et d’idées très particulières. Tel l’artiste. Comme le disait avec humour Henri Maldiney : « Cause toujours, dit l’inconscient au moi, c’est moi qui cause ! ». Il a été dit que « l’humour c’est donner aux processus primaires des airs de processus secondaires ». Cette idée est communément admise ne doit pas être généralisée. Nous avons tous remarqué que bon nombre de nos connaissances faiseurs de bons mots et personnes d’esprit n’ont rien d’un artiste ou d’un schizophrène mais seraient plutôt à classer du côté des structures obsessionnelles. Dans ce cas la pensée est souvent très érotisée et l’intelligence subtile (par exemple chez le « pince sans rire »).
De là à y voir un lien avec le plaisir autoérotique il y a un pas que nous franchirions bien. La masturbation nous dit Woody Allen « est toujours l’occasion de faire l’amour avec quelqu’un que l’on aime bien ! ». L’humour, reprendrais-je, est toujours l’occasion de se donner un plaisir très personnel et légèrement égoïste. Cette fonction de l’humour lui donne une qualité encore plus paradoxale. Elle décrit un humoriste dans sa solitude et sa résignation et certaines biographies d’humoristes confirmeraient cela (Alphonse Allais, Pierre Dac, Woody Allen, etc.). Plus exactement un homme toujours en lutte avec la vie et s’y prenant maladroitement, parfois malheureux, parfois pris dans une histoire personnelle et affective très compliquée. Mais, à la différence de la masturbation, le plus de jouir perdure en quelque sorte dans l’après coup. Un bon mot bien placé apporte une satisfaction durable et peu de culpabilité ! Il y a même une petite forme de mégalomanie, comme l’a souligné Ferenczi. Et une façon de traiter l’autre (l’Autre ?) par-dessus la jambe en l’enfermant dans la production imaginaire.
Ne vous ai-je pas déjà rencontré quelque part ? - Euh ! Ce doit être dans un cauchemar.
Avez-vous passé une bonne soirée chez les Dupont ? - Et bien, pour tout vous dire, heureusement que j’y étais, sinon je me serais ennuyé !
Dans le bus : Je vous donnerai bien ma place mais elle est occupée (Groucho Marx).
Un critique disait à Alexandre Dumas Vous avez employé l’expression « un vide douloureux » mais un vide ne peut pas être douloureux ! - Ah bon ! Vous n’avez jamais eu mal à la tête !
On est dans ces exemples proche de l’ironie qui, comme le dit Max Jacob, « vous dessèche et dessèche la victime ».
Contrairement à ce que pensait Freud, il nous semble que l’humoriste est un solitaire et qu’il peut donc jouir seul. Et pas comme spectateur ou lecteur mais comme faiseur de bons mots ou inventeur de situations cocasses, étranges et surprenantes. Dans certains de nos rêves (cf. le rêveur fait trop d’esprit) ne découvrons-nous pas des situations comiques ?
Cela tient sans doute à un état d’esprit ou à l’aptitude d’un individu à faire preuve d’humour. Nous y sommes souvent convoqués non sans ambiguïté : l’humour sert alors d’excuse. Et ce n’est plus de l’humour. Façon de dire des méchancetés et de terminer en disant que « c’était pour rire ! ». L’humour est rare et le meilleur humoriste peut vivre des instants ou des périodes où il n’a plus envie de rire. Soit que la dramatisation soit trop forte, soit que la situation ne lui permette plus, malgré tout, de faire cette pirouette verbale, intellectuelle et narcissique. On me pose souvent la question de savoir si l’humour est un don de la nature, un gène, un gonflement du lobe frontal ou une attitude sociale ou culturelle. Je pense qu’il est lié à une aptitude métapsychologique propre à chaque individu, à son éducation et à sa culture, certes, mais aussi à sa mise en place de défenses. Et à sa vision de la vie et du monde.
Ces rapides remarques faites j’en viens à une autre hypothèse, parfois évoquée, que faire de l’humour est un acte de création qui s’apparente à l’activité artistique. Tout comme « l’assassinat comparé à l’un des beaux-arts », me direz-vous ! En effet.
La fonction fondamentale de l’humour n’est-elle pas d’abord esthétique puisqu’elle a une finalité gratuite, rhétorique et exhibitionniste ? Puisque l’humour puise dans tous les événements humains possibles et se pare de toutes les formes, constructions et couleurs possibles. Et la créativité donne la main à la dépression dans sa recherche d’investissement libidinal d’objets nouveaux.
Si je reprends la citation faite plus haut, et pour différencier la dynamique propre à l’artiste, je dirai que l’artiste cherche à donner aux processus secondaires des airs de processus primaires.
Des travaux américains (US) des psychologues Barron-Janus sur la personnalité de l’un et de l’autre contrediraient mes hypothèses. Tout en soulignant, dans les deux cas, l’intérêt pour la culture, la liberté de pensée, l’indépendance, la vie sexuelle, le monde fantasmatique, la vie affective compliquée, l’aptitude à la régression, le sens de l’observation et un narcissisme « à fleur de peau », ils affirment qu’il n’y a pas de corrélation entre art et humour, comme il n’y en a pas entre humour et intelligence. Ils notent que les humoristes professionnels, contrairement aux artistes, ont souvent commencé un travail psychanalytique mais que beaucoup d’entre eux l’ont arrêté pensant que cela risquait d’atténuer leur talent. Tout cela n’est pas très convaincant et reste peu élaboré et, on peut se le demander, légèrement antipsychanalytique ! Ce qu’il faut peut-être retenir de cette analyse c’est qu’en effet l’artiste en son personnage est très rarement drôle et plutôt fragile de contact, voire susceptible, car pris au piège de l’attente du commentaire. L’humoriste, lui, ne donne pas le temps à l’entourage de préparer sa réplique ou son commentaire : d’ailleurs aucun commentaire n’est possible après un bon mot sinon de courir le risque du ridicule.
C’est donc dans l’acte créateur de l’un et de l’autre qu’il y a, à mes yeux, une coïncidence. Faire un bon mot, peindre un tableau c’est aussi ressentir, comme disait Cézanne « ma petite sensation ». C’est fournir un certain travail. P.-L. Assoun dans un article sur l’humour écrit : « Quand il fait un bon mot, l’humoriste ne rit pas il travaille » (cité de mémoire).
L’humour reste une qualité rare et beaucoup d’humoristes ou de rigolos publics actuels semblent bien éloignés de toute activité ou don artistique et de tout humour. Nageant dans la provocation, l’analité, le cloaque, la sexualité dégradée, la morbidité, la violence, la bêtise et la naïveté, ils semblent cependant réussir à exciter un large public puisqu’ils parviennent (est-ce un hasard ?) à le regrouper dans un stade de football (activité sportive ayant des liens fort lointains avec l’humour, il me semble !). Depuis Pierre Desproges, nous cherchons désespérément de vrais humoristes. À le réécouter on se rend compte que parfois le public ne comprend pas la finesse de son humour ou de ses allusions tout comme un spectateur face à certains tableaux. Il y a aussi une méthode assez simple pour vérifier si un professionnel de l’humour en dispose, c’est de lire son texte : l’expérience est édifiante et je vous la conseille.
L’humoriste en tant qu’artiste diffuse la surprise dans sa liberté de pensée et sa peinture du monde. Un monde qu’il déconstruit, déforme et reconstruit, et pare des attributs les plus invraisemblables, jonglant avec les mots, se jouant de toutes les figures de rhétorique, de tous les traits, contours et formes. Il n’a pas peur des mots. Il est cubiste, impressionniste, hyperréaliste, photographe ou sculpteur. Il en dit même beaucoup plus qu’il ne pense. Il prend des risques. Un court instant. Un instant pour lui-même et pour les autres. C’est comme il veut. Il navigue entre souffrance et jouissance, recherche de consolation et besoin de satisfaction. La plupart des vrais humoristes sont inconnus et à ma connaissance il n’y a malheureusement pas encore de musée d’humour brut !