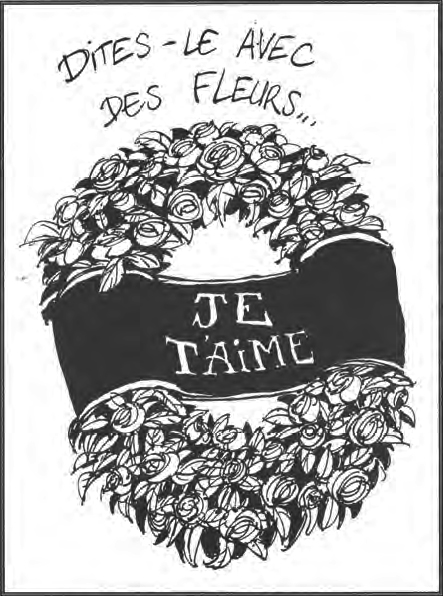Canal Psy : Mme Mercader, cet ouvrage fait suite à un premier publié en 2003, déjà co-écrit avec Annik Houel et Helga Sobota, intitulé Crime passionnel, crime ordinaire ? Qu’est-ce qui a motivé la publication de ce second volet ?
Patricia Mercader : C’était en fait notre projet depuis le début. Nous avons commencé cette recherche il y a longtemps car nous n’avons jamais réussi à la faire financer. Au moment d’écrire nous avions donc un matériel considérable car notre base de données était constituée d’un peu plus de 550 articles de presse concernant 337 crimes. Nous avions alors déjà l’intention de faire une étude à la fois de représentations sociales et de psychosociologie. Mais au moment où nous avons vu que l’on s’acheminait vers un ouvrage de 800 pages, alors que les éditeurs veulent aujourd’hui des petits livres, on s’est dit qu’on allait publier cette première partie sur les représentations sociales séparément. Ensuite on a poursuivi sur notre lancée, donc ce second livre traitant de la psychosociologie. Dans notre projet de départ, nous avions en réalité une troisième partie en vue, qui était le traitement institutionnel de ces affaires, c’est-à-dire une étude de la logique policière et judiciaire de prise en charge, si l’on peut dire, de ce type d’histoire. Ça ferait alors l’objet d’un troisième ouvrage mais là on laisse tomber ! On voudrait travailler maintenant sur des choses plus soft (rires).
Canal Psy : En épigraphe du livre, vous citez un extrait d’Othello de Shakespeare, en français : « Reste ainsi quand tu seras morte, je vais te tuer/Et je t’aimerai après… ». En quoi cette tragédie vous semble rejoindre votre propos ?
Patricia Mercader : Je ne m’avancerai pas trop sur la tragédie Othello en elle-même parce que c’est un drame de la jalousie, et surtout aussi de la manipulation. Or, d’une part, dans notre livre on voit bien qu’il s’agit moins de jalousie que d’angoisse d’abandon ou d’angoisse d’intrusion par l’autre. Par ailleurs on ne retrouve pas la notion de manipulation dans les situations que nous avons étudiées. Par contre, ce vers d’Othello, dans une perspective d’emprise sur l’objet, d’appropriation de l’objet, dit que l’objet n’est jamais autant approprié qu’une fois mort. Donc cette phrase-là illustre une idée très forte dans l’ensemble du livre. Plutôt à décliner côté homme, mais côté femme aussi. Il y a en effet un chapitre où l’on montre bien la dissymétrie de la problématique des hommes et des femmes. Mais un autre chapitre porte sur une femme qui a tué son amant, et cette femme répète tout le temps : « cet homme que j’ai aimé et que j’aime ». Elle ne l’aime que plus maintenant qu’il est mort, l’objet parfait est mort d’une certaine façon.
Canal Psy : Cela me faisait penser à la question de l’altérité de l’autre qui peut être vécue comme dangereuse. Une fois mort, celle-ci se trouverait immobilisée.
Patricia Mercader : Son altérité en tout cas ne peut plus s’exprimer. Quand il est mort, il est définitivement approprié. Son altérité disparaît effectivement radicalement. Et d’une certaine façon il est aussi toujours perdu, jamais atteint.
Canal Psy : Vous relevez dans les articles de presse qui traitent des crimes qui ont lieu dans la sphère conjugale deux types d’interprétation des faits différents, soit du côté d’une violence conjugale, soit du côté du crime passionnel. Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans cette distinction ?
Patricia Mercader : l’interprétation en termes de violence conjugale nous conduit à penser premièrement qu’il s’agit d’un fait banal. En tout cas dont la prévalence est très grande dans notre société. Ça nous conduit à des raisonnements du type « une femme tous les trois jours meurt tuée par son conjoint », et « un homme tous les seize jours » par exemple, en ce qui concerne la France. Donc premièrement c’est du banal, deuxièmement c’est une affaire de pouvoir, c’est-à-dire d’inégalité entre les hommes et les femmes, quel que soit le concept qu’on utilise. On a dit que pour les familles qui en arrivent à ce type de crime, malheureusement le concept pertinent c’est l’appropriation des femmes. Donc vous voyez c’est une analyse sociologique en termes de pouvoir. Lorsqu’on interprète le phénomène en termes de crime passionnel, premièrement on va insister sur le caractère exceptionnel de la chose, c’est un amour hors normes, nos articles de presse disaient « c’est un amour fou, il l’aimait trop, il l’aimait mal », et cette interprétation va insister sur la question d’un lien qui est réciproquement un lien pathogène, d’autres diront romantique. En tout cas on est sur une analyse d’un lien privé entre deux individus. Donc on a d’un côté une interprétation qui fait appel à l’amour, c’est-à-dire à la sphère du privé, et qui appuie sur l’idée d’une situation d’exception, de l’autre une interprétation qui insiste sur l’aspect fréquent d’un point de vue statistique de ce type de fait.
Julien Wolga
Canal Psy : En ce qui concerne les mobiles des crimes, vous relevez une distinction entre ceux des hommes et ceux des femmes auteurs de ces violences, quelle est-elle ?
Patricia Mercader : La formule lapidaire que l’on a finalement gardée – puisque c’est tentant de garder une formule – est celle-ci : « les hommes tuent une femme pour la garder, et les femmes tuent un homme pour s’en débarrasser ». Et c’est en fait lié à la dissymétrie flagrante des mobiles, des types d’histoire, qui conduisent un homme ou une femme à tuer. Côté homme, c’est clair, dans notre corpus on a un peu plus de la moitié des hommes qui tuent une femme qui les quitte ou dont ils craignent qu’elle les quitte, un peu plus de la moitié des hommes qui tuent une femme qui les trompe ou dont ils craignent qu’elle les trompe, et quand on met les deux mobiles ensemble parce que bien sûr il y a souvent deux mobiles au même crime, on s’aperçoit que 75 % des hommes tuent soit pour l’un, soit pour l’autre, soit pour les deux ensemble. Donc il s’agit vraiment ici de perdre la femme, la perdre pour un autre ou pas, ou la perdre tout court. Ça va très loin parce qu’on a vu très clairement, c’est devenu presque un lieu commun, que l’une des périodes les plus dangereuses, c’est l’année qui suit le divorce du couple. Il s’agit alors pour l’ex-mari de la récupérer. Il y a aussi quelques affaires que l’on a appelées « soupirant-dulcinée » : une femme se refuse à un homme, mais lui pense qu’elle est déjà à lui, et cela le conduit à passer à l’acte. Cela reste relativement rare par rapport au reste mais enfin.
Côté femme, c’est complètement différent. Elles tuent des hommes avec qui elles se disputent continuellement, qui les frappent, qui menacent leurs enfants, qui les empêchent de vivre en paix après le divorce, qui les harcèlent ; ou bien pour des histoires d’argent, quelques fois aussi cela arrive. Ce n’est pas du tout le même type de relation. Par contre ce que l’on a constaté c’est qu’entre celle que l’on appelle la « femme battue qui tue », c’est-à-dire une femme victime de violences répétées depuis des années et des années, qui finit par tuer son conjoint – ce qui représente la moitié de nos cas de crimes de femmes – et une femme qui cherche à partir, à quitter un homme, et se fait tuer par lui au moment où elle cherche à le quitter ou juste après, le profil biographique, l’histoire familiale est identique, c’est la même en fait. Dans un cas, elle cherche à partir et elle se fait tuer, dans l’autre cas, elle s’en débarrasse.
Canal Psy : Ce que vous soulignez c’est que ce sont deux issues différentes à une même problématique finalement ?
Patricia Mercader : Oui, je crois.
Canal Psy : Paradoxalement vous notez que « l’homicide conjugal a plus à voir avec une certaine « normalité » », comparativement au profil des auteurs relevant de la délinquance. Voulez-vous nous expliquer ce paradoxe ?
Patricia Mercader : Et bien c’est une violence prétendue « normale » d’une certaine façon. Ce que l’on a écrit c’est que les hommes qui tuent leur partenaire n’ont pas du tout le profil sociologique du délinquant. Ce ne sont pas forcément des hommes qui ne travaillent pas qui se droguent, ils ne commettent pas spécialement d’autres délits, ils peuvent être éventuellement des machos qui conduisent trop vite ! Mais ce n’est pas le profil du délinquant qui sort des banlieues, qui rentre dans un gang, rien à voir avec ça. Ils n’ont pas d’antécédents judiciaires. Ce sont des hommes apparemment normaux sur le plan du rapport à la loi. Ils ont beaucoup d’armes, mais on n’a pas réussi à trouver combien de foyers français possèdent des armes chez eux. Il y a des études qui ont été faites là-dessus aux Etats-Unis mais en France non. Bon, ils ont des armes, beaucoup de fusils. Mais il y a peut-être beaucoup de gens qui ont des fusils et on ne le sait pas.
Canal Psy : Quels sont les traits caractéristiques des relations entre les protagonistes, auteurs et victimes, que vous avez étudiés ?
Patricia Mercader : D’abord le lien d’emprise. Ça c’est vraiment fondamental. Pour l’homme comme pour la femme, s’aimer c’est un lien d’appartenance. Alors c’est vrai que les hommes fonctionnent plutôt sur le mode « elle doit m’appartenir », les femmes fonctionnent plutôt sur le mode « c’est moi qui doit lui appartenir », mais c’est très réversible. Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de jeter un œil au livret de Carmen le chant célèbre « la fleur que tu m’avais jetée… ». C’est Don José, qui va finir par tuer Carmen et qui lui dit « j’en venais à te haïr, à te maudire, puis je m’accusais de blasphème, etc. », et il termine son chant en disant « car j’étais une chose à toi ». En fait ce fantasme d’appartenance, ou d’appropriation selon que vous le prenez d’un côté ou de l’autre, je pense qu’il est partagé par l’homme et par la femme, avec une polarisation : l’homme veut une femme à lui, la femme veut être à un homme, mais cette polarisation n’est pas forcément le plus important de l’affaire même si c’est ce qui apparaît le plus. Au fond, ce lien d’appartenance est absolument fondamental. Du coup on trouve dans l’histoire de ces hommes l’idée qu’ils ne seront jamais vraiment des hommes s’ils n’ont pas une femme à eux, et dans l’histoire de ces femmes un interdit de s’appartenir. Depuis leur plus jeune âge, il leur a été transmis qu’une femme ne s’appartenait pas.
Canal Psy : Vous relevez dans ces situations conjugales l’appropriation des femmes par les hommes en distinguant l’appropriation privée de l’appropriation collective. Pouvez-vous nous parler de cet aspect de la relation ?
Patricia Mercader : Pour revenir sur le concept « d’appropriation des femmes », il a été proposé en 1975 par une sociologue féministe radicale qui s’appelle Colette Guillaumin et elle propose le terme de sexage, construit sur le mode « d’esclavage », pour parler de ce qu’est la relation entre hommes et femmes, c’est-à-dire que leur corps et les produits de leur corps sont traités comme propriété d’un homme, le mari. Il s’agit de l’appropriation « privée ». On est en 1975, la notion de viol conjugal n’est pas reconnue, c’est seulement en 1980 qu’elle devient pensable au niveau de la loi. En 1975, l’idée d’autorité parentale est toute récente, elle a remplacé le régime de la puissance paternelle en 1970. Donc on est dans un contexte où Colette Guillaumin va conceptualiser cette notion d’appropriation privée. Et puis par ailleurs elle dit qu’il y a aussi une appropriation collective des femmes en tant que catégorie par les hommes en tant que catégorie. À preuve, le contrôle du comportement des femmes et de leur utilisation de l’espace, par exemple le fait que toutes les femmes font attention à ne pas aller dans certains lieux, à certaines heures, à ne pas se comporter de telle façon pour ne pas être considérées comme « femme publique », c’est-à-dire prostituée, le fait que si une femme transgresse ces règles non écrites, et qu’elle est violée, on pourra dire « qu’elle l’a bien cherché » et toutes sortes de choses qui font qu’en réalité toutes les femmes sont sous le contrôle de tous les hommes. Donc la conceptualisation de Colette Guillaumin en 1975 est très radicale.
Alors je ne peux pas dire que dans notre livre, les histoires de crimes passionnels nous ont conduites à confirmer la notion d’appropriation collective des femmes, en revanche elles me permettent de dire clairement que dans ces familles-là l’appropriation privée des femmes fonctionne à plein.
Canal Psy : On a fait le tour des questions que je souhaitais vous poser, y a-t-il d’autres points de votre recherche que vous souhaitiez évoquer au cours de cette interview ?
Patricia Mercader : Eh bien, il y a le fait que nous avons conclu notre ouvrage sur la question de la mort annoncée. C’est-à-dire que ce ne sont pas du tout des affaires inattendues en réalité – avec une petite nuance pour les cas où l’homme se suicide après avoir tué sa famille – mais sinon ce sont des affaires où il y a eu des mains courantes à la police, des menaces, tout le monde dit « mais ça va mal finir », il y a eu des violences, même devant témoin mais minimisées par l’entourage. Dans mes cours avec mes étudiants je leur dis qu’il faut faire attention que s’il l’a battue, il la rebattra encore, que s’il tue son canari c’est qu’il est vraiment temps de partir !
Canal Psy : Ce que vous voulez dire c’est qu’il y a des signes annonciateurs qui ne sont pas entendus ?
Patricia Mercader : Oui, ils ne sont curieusement entendus par personne. Même les institutions, même les médecins. C’est un aspect un peu inquiétant et c’est le fond du problème d’une violence paradoxalement prétendue « normale » parce que, du coup, les signes annonciateurs sont négligés. Comment faire de la prévention si tout le monde pense que c’est normal ?
Canal Psy : Oui, votre remarque me fait penser, en lien avec le concept d’appropriation des femmes que vous évoquiez tout à l’heure, aux pratiques africaines d’excision entre autres exercées sur le corps des femmes. Or, dans ces pratiques les mères prennent une part active à la perpétuation de ces pratiques d’une génération à l’autre. Là aussi cette part active que prennent les femmes à l’emprise des hommes sur elles peut apparaitre comme paradoxale.
Patricia Mercader : Effectivement on a parlé des caractéristiques du lien conjugal et j’ai parlé de l’emprise, mais il faudrait aussi parler du type de lien familial qu’on rencontre, parce que ce sont des affaires de famille où l’on a vraiment identifié deux associations d’éléments : la première est l’association du maternalisme et d’un autoritarisme masculin pseudo-paternel. C’est-à-dire que ce sont des fils et filles issus de mères maternalistes au sens où elles étaient mère avant tout, voire « toute-mère ». Donc, au niveau de la triangulation cela ne fonctionne pas. Et par ailleurs ils sont fils et filles de pères qui pratiquaient ce que l’on a décidé d’appeler un autoritarisme masculin « pseudo-paternel ». Il ne s’agit pas du tout ici de la Loi du Père qui serait « le père transmet la loi parce qu’il s’y soumet », mais un autoritarisme, donc la loi du plus fort, masculin soit, parce que le plus fort c’est l’homme dans ces familles-là, mais pseudo-paternel. En fait on n’a que des mères : la mère maternaliste et le père autoritariste sont deux mères phalliques.
C’est le premier élément que l’on va retrouver massivement dans toutes ces histoires. Et puis, toujours chez les parents des criminels et des victimes, on va trouver une association très particulière d’emprise et de négligence. C’est-à-dire que ce sont des personnes, garçons ou filles, qui ont été élevés sous emprise, mais en même temps dans une profonde négligence qui peut aller très loin : il y a une des criminelles citées dans le livre qui a eu une appendicite à l’âge de douze ans et qui a été obligée d’aller à pied jusqu’à la ville voisine pour se faire soigner parce que ses parents disaient qu’elle jouait la comédie. Donc cette négligence peut prendre des formes très sévères, et ça peut aussi prendre la forme d’une totale impossibilité de parler dans la famille, il n’y a aucune écoute, aucune prise en compte de la réalité psychique de l’enfant. Donc ces deux aspects-là sont assez importants dans l’étiologie des crimes. C’est pourquoi on voit bien, et on termine là-dessus l’ouvrage, que l’impossibilité de penser une égalité entre hommes et femmes, c’est-à-dire une autonomie des sujets amoureux a complètement partie liée avec des familles dont le fonctionnement est essentiellement incestuel.
Canal Psy : Avec une impossibilité de se séparer et de s’appartenir.
Patricia Mercader : Oui, d’ailleurs on pourrait peut-être dire que ces hommes-là non plus ne peuvent pas s’appartenir.