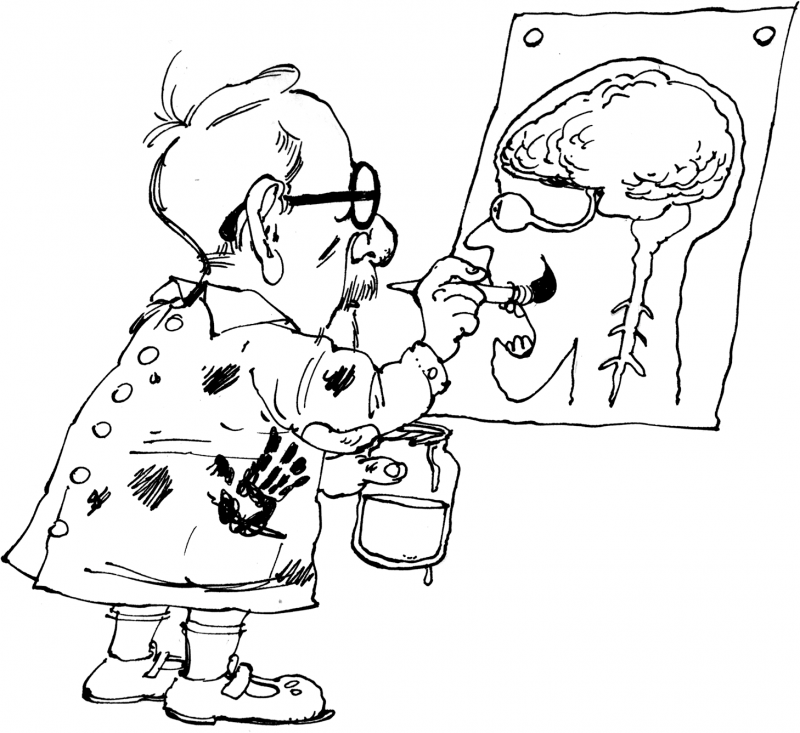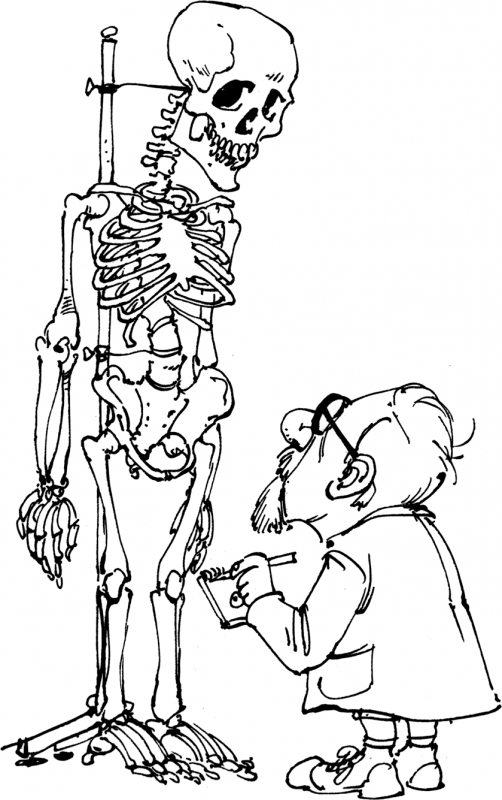Complexes, pour le moins, nous apparaissent aujourd’hui les relations qu’entretiennent le cursus universitaire de formation initiale (les « études en psychologie ») d’une part, et ce qui appartient au domaine de la formation continue des professionnels, d’autre part. Nous avons affaire là à deux formes de transmission instituées dans notre société, au sein de l’Université, mais pas seulement, une transmission diphasée en quelque sorte, dont les particularités ont été éclairées récemment par divers auteurs lyonnais (Mercader, Henri, 2004 ; Gaillard, 2002). Elles tiennent pour l’essentiel à la spécificité de l’objet même de notre discipline, la subjectivité, la psyché humaine, l’inconscient. Nous limiterons notre présent propos au domaine de la psychologie clinique, en lequel nous sommes professionnellement engagé, mais de multiples extrapolations vis-à-vis d’autres domaines peuvent évidemment s’effectuer.
De prime abord, tout paraît opposer formation initiale et formation continue : leurs profondes disparités sont de l’ordre de l’évidence. La « fac », c’est le gigantisme, les « gros bataillons », une pléthore d’usagers, des amphis bondés ; la formation continue, elle, fonctionne plutôt par petits groupes aux effectifs strictement limités. La durée respective des formations n’est en rien comparable ; d’un côté, un cheminement continu de 5, voire 6 ans (et parfois plus), pour obtenir, au terme du cursus initial, le titre de Master 2 Pro et, de l’autre, quelques journées, pour la plupart des modules de la formation continue. Le statut des « formés » se présente lui-même comme marqué par de fortes différences : la formation initiale s’adresse à des « étudiants », avec les droits, devoirs et prérogatives attachés à cette situation sociale, tandis que la formation continue concerne plutôt des « participants ».
Mais l’opposition peut se prolonger quant aux modalités d’évaluation qui, elles, offrent une intéressante figure de renversement ! Traditionnellement, ce sont les profs qui évaluent le travail des étudiants lors des périodes de validation, alors que ce sont les formés qui évaluent la qualité de la formation (et le travail du formateur, nul ne s’y trompe…) au terme du module de formation… La certification de ces deux types de formation n’est nullement identique : délivrance d’un diplôme d’État de reconnaissance aujourd’hui européenne pour le cursus initial, « attestation de formation » pour la formation continue (si l’on excepte bien sûr les D.U., rattachés à Lyon au Service de formation continue). Enfin, les enjeux « pédagogiques » de ces deux dispositifs nous apparaissent profondément hétérogènes. En formation initiale, et au-delà de l’assimilation d’un certain nombre de contenus, ce qui est véritablement en jeu, c’est d’accompagner la construction d’une identité de psychologue clinicien, alors que, parce qu’elle s’adresse à des professionnels, la formation continue, quant à elle, ne saurait avoir, sauf exception, l’ambition d’une telle modification identitaire.
S’il en va bien ainsi, envisager de façon synchronique les liens entre ces deux secteurs formatifs, c’est se demander comment la formation universitaire initiale suscite et alimente en un temps ultérieur des demandes qui émanent de professionnels (jeunes ou moins jeunes) à l’adresse des dispositifs de formation continue, que ceux-ci soient organisés par l’Université ou par les multiples instances privées, qu’ils soient pris en charge financièrement par le demandeur ou par son employeur. Réciproquement, c’est tenter de comprendre comment les demandes et les propositions de la formation continue sont susceptibles de retentir, de rétro-agir sur les contenus, les programmes, voire sur les formes pédagogiques de la formation initiale. C’est toute la question de savoir comment le secteur de la formation initiale « écoute » ce qui se joue et ce qui se noue du côté de la formation continue. Par quels biais, donc, s’articulent – et comment se différencient – ce temps, ce parcours temporel qui est celui de la formation initiale, avec ces espaces diversifiés, qui ressortissent au secteur de la formation continue ?
Une première possibilité consisterait sans doute à concevoir une stricte étanchéité entre ces deux domaines. Les enseignants-chercheurs engagés dans la formation initiale des étudiants en psycho suivent les « maquettes » prévues pour leur cursus d’étude, sans jamais s’inquiéter de l’« après ». Les services de formation continue, quant à eux, se contenteraient de répondre au cas par cas aux demandes formulées par des praticiens, en fonction des aléas et difficultés de leurs pratiques. Or, une telle possibilité doit être reconnue bien évidemment comme fictive ! En effet, quiconque feuillette par exemple la brochure qui présente le programme du Service de Formation Continue de notre Institut de psychologie ne peut manquer de s’apercevoir que ce sont, pour l’essentiel, des enseignants-chercheurs de la formation initiale (ainsi que divers praticiens, eux-mêmes engagés dans le cursus universitaire initial) qui interviennent au sein de la formation continue, selon leurs compétences propres… Il semble donc bien nécessaire de postuler l’existence de coordinations plus fines, formelles ou informelles, que l’on peut estimer suffisantes ou, à l’inverse, qu’il serait souhaitable d’améliorer.
Mais surtout, il existe un lien de nature bien plus structurelle entre formation initiale et formation continue : les objets et contenus de la formation continue sont nécessairement (devraient être ?) en avance sur ceux de la formation initiale, et non pas seulement parce qu’il ne peut s’agir de resservir à des professionnels, dans le cadre de la formation continue, ce qu’ils ont vu quelques années plus tôt sur les bancs de la fac. Quoique selon des épistémologies différentes selon les secteurs de notre discipline, celle-ci a quelque droit à se revendiquer comme « scientifique », c’est-à-dire comme élaborant des discours qui avancent, qui progressent, qui s’efforcent de forger, année après année, en fonction des approfondissements de la recherche fondamentale ou appliquée, des modèles de mise en intelligibilité du psychisme humain, dans ses diverses occurrences, de plus en plus pertinents.
Un exemple, parmi cent autres : j’ai été fortement intéressé, cet été, par la lecture d’un ouvrage tout récent, intitulé Dispositifs de soins au défi des situations extrêmes (Aubert, Scelles, 2007), dont les diverses contributions constituent une indiscutable avancée de la recherche clinique en ce qui concerne l’expérience – récente – que nous pouvons avoir aujourd’hui de la prise en charge clinique des situations de grande précarité psychique et la spécificité du travail d’accueil de la souffrance qui s’y manifeste. Il y a là un ensemble de recherches et d’expériences manifestement novatrices, qui ne sont abordées que de façon très ponctuelle au cours de la formation initiale des futurs psychologues, en particulier cliniciens1. Or, la demande à ce sujet paraît grande à l’heure actuelle dans le champ social ; un nouveau secteur de pratiques cliniques semble s’ouvrir en ce domaine, de telle sorte qu’il n’est donc nullement aventureux de conjecturer que des demandes se feront jour bientôt, à l’adresse des services de formation continue, de la part de praticiens mobilisés par ce type de terrain.
Mais, si la formation continue se spécifie d’anticiper les contenus et objets de la formation initiale, nous ne saurions méconnaître cette évidence que la formation initiale est forcément première, logiquement et chronologiquement antérieure à la formation continue : nous voulons dire par là qu’elle inscrit une forme première, primitive, et pour tout dire matricielle, dans la rencontre avec l’objet même de la discipline. C’est elle, bien évidemment, qui enracine ou inhibe la « pulsion de recherche », sur fond d’identifications durables. Il est donc loisible de faire l’hypothèse que la formation reçue initialement fonctionne comme une sorte de « sas », qui préorienterait les investissements ultérieurs et déterminerait des effets d’ouverture ou de fermeture défensives aux espaces et aux objets de la formation continue.
Plus précisément, l’un des objectifs – non explicitement reconnu, mais peu importe sans doute – de la formation initiale, serait de développer, chez tout étudiant, une capacité à l’auto-formation. Et assurément convient-il de s’arrêter un instant sur cette notion d’auto-formation, qui semble nodale dans notre discipline, comme dans d’autres, parce qu’elle nous permet de comprendre selon quel mode intime peuvent s’articuler formation initiale et formation continue. Loin de s’entendre comme la réalisation d’une fantasmatique d’auto-engendrement qui ne serait que la négation de l’inscription du praticien dans une filiation professionnelle, celle-ci renverrait plutôt à l’investissement d’une sorte d’appétence à l’égard de tout ce qui peut relancer une pensée sur la pratique. Il s’agit bien, en fait, d’une compétence à « prendre soin » de ses compétences professionnelles. Sous cet angle, l’engagement dans tel ou tel parcours de la formation continue ne constitue que l’une des déclinaisons possibles de cette auto-formation. D’autres possibilités sont représentées à l’évidence par les colloques et congrès, les conférences, la participation à des séminaires ou groupes de travail, sans parler des lectures, voire d’une analyse personnelle…
Au risque de simplifier à l’extrême la complexité que nous évoquions, avançons maintenant deux types de possibilités susceptibles d’éclairer les relations entre formation initiale et formation continue : celles-ci concernent la nature de la demande adressée à la formation continue, comme le statut subjectif qui lui est accordé, de la part de jeunes professionnels au terme de leur cursus de formation initiale.
Un premier cas de figure semble pouvoir concerner des demandes de perfectionnement de compétences professionnelles directement articulées sur l’expérience de la formation initiale, dans le prolongement même de celle-ci ; il s’agirait d’en combler les lacunes, du moins celles qui seraient révélées et actualisées par la rencontre avec tel type de terrain de pratique. Toute formation initiale n’est-elle pas par principe nécessairement lacunaire (et pas seulement en psychologie clinique…) et n’expose-t-elle pas les jeunes professionnels à l’inévitable de ses limites et, donc, à une forme douloureuse d’inachèvement ? Faute que ce cursus d’études professionnalisant puisse, par définition, pourvoir à tout, il n’apparaît pas du tout illégitime qu’un jeune praticien, en fonction des spécificités de son domaine de pratique (ou en attendant sa première insertion professionnelle) ressente le besoin de compléter ou d’approfondir sa formation, par exemple en méthodologie projective, en psychodrame… Il n’y a là rien d’autre que la mise en œuvre – malaisée, à vrai dire – d’un discernement en ce qui concerne des compétences professionnelles déjà acquises et celles dont il s’estime dépourvues.
Toutefois, on peut s’interroger sur le sens de ce type de demande, formulée auprès de la formation continue : ne véhicule-t-il pas une possible ambiguïté dès lors qu’il revêtirait une dimension « réparatoire » ? Parce qu’il s’agirait de tenter de récupérer, grâce à tel ou tel module de formation continue, un savoir que l’on croit ne pas avoir acquis lors de la formation initiale, ne peut-il être question, en fait de se procurer davantage de complétude (moins d’incomplétude ?), d’obtenir un surcroît d’identité professionnelle, peut-être pour nier plus efficacement la dimension du manque, inhérente à toute formation, qu’elle soit initiale ou permanente ? En somme, dans ce cas de figure, le processus de désidéalisation qui devrait intervenir au terme du temps de formation initiale n’aurait fait son œuvre que de façon partielle, et ce qui est alors requis de la formation continue pourrait s’entendre ici comme demande d’un pansement narcissique ou d’un complément phallique.
D’un tout autre ordre nous apparaît une seconde forme de demande qui émane plus directement de l’expérience professionnelle du praticien et qui concerne une spécialisation ou une réorientation. Celle-ci se présente comme évidemment tributaire du terrain de pratique où intervient le professionnel, du type de demande que lui adresse son institution et du mode de symptomatologie qu’il a à gérer. Ainsi, un praticien, quelle que soit son expérience antérieure, peut-il éprouver le besoin de se former à la thérapie individuelle ou familiale, à la P.N.L., à la méthodologie d’observation des bébés, à l’intervention clinique en soins palliatifs, à l’animation de groupes d’analyse de la pratique… De telles méthodes et techniques ne sont, la plupart du temps, qu’évoquées dans le cadre de la formation initiale, sans pouvoir donner lieu à l’acquisition de compétences suffisantes. Et, il va de soi que les cadres théorico-cliniques introjectés au cours du cursus universitaire ne sont aucunement rendus caducs par de telles spécialisations, mais bien plutôt revisités et approfondis par rapport à un champ d’application délimité.
Observons que ce type de demande ne peut aller qu’en s’amplifiant au cours des prochaines années, dans la mesure où nous percevons mieux aujourd’hui que la véritable centration des Masters 2 Pro, en dépit de l’accentuation particulière de certains parcours (les « options ») consiste à former des praticiens généralistes : René Roussillon insistait utilement sur cette idée, lors de l’interview qu’il a accordée à Canal Psy, à propos du décret de loi concernant le statut de psychothérapeute (Canal Psy, 2006-2007, p.2). De fait, la visée de la formation initiale, qui entend former des généralistes, apparaît être la seule formule pertinente face à des enjeux éminemment actuels. D’une part, l’extrême diversification des terrains de pratique clinique depuis une trentaine d’années, dont témoigne la variété des terrains de stage proposés à nos étudiants sur la région lyonnaise, l’indique avec une suffisante insistance. Dégageons le postulat qui soutient un tel choix de la part des formateurs universitaires : c’est précisément parce que leur formation initiale a été suffisamment générale (en même temps que suffisamment approfondie) que les jeunes praticiens se révéleront adaptables à des offres d’emploi protéiformes, quitte à suivre, en un temps second, des formations spécifiques.
Le deuxième enjeu me semble participer d’une modification significative des terrains de pratique clinique habituels, avec le recrutement, depuis quelques années, de praticiens non cliniciens, dont le point de vue sur l’humain se spécifie d’être résolument objectiviste : d’un côté, l’écoute comme non-savoir sur l’autre, de l’autre la prétention d’un savoir sur un « fonctionnement »… Loin de considérer ici cette émergence comme une menace – ce qu’elle est pourtant dans tel ou tel lieu de pratique – ou comme un danger pour les usagers, c’est-à-dire pour des patients, je préfère l’entendre ici comme une chance pour de jeunes cliniciens, un « challenge » à relever… Comment ne pas percevoir en effet que ce qui est engagé dans une telle situation est de l’ordre d’une mise à l’épreuve de la fermeté et de la cohérence de l’identité professionnelle des psychologues cliniciens que nous formons ? Une identité nécessairement adossée à une éthique, qui intègre la conception de l’humain qu’a pu éclairer la psychanalyse. Sous cet angle, c’est bien l’exigence et la pertinence des apports et dispositifs tant de la formation initiale que de la formation continue qui en sont interpellés : qu’en est-il, par exemple, de leur contribution à une réflexion épistémologique apte à amener de jeunes praticiens à penser la spécificité de leur propre champ de pratique, en vue d’éviter de céder au confusionnisme et à la tentation de l’indifférenciation des rôles et des places de chacun, sans pour autant basculer dans la rivalité ou l’envie.
On en conviendra, ce n’est pas chose aisée que d’achever une réflexion sur la dimension de l’inachèvement, à l’œuvre tant dans le champ de la formation initiale en psychologie clinique que dans celui de la formation continue… Dans l’espace à nous imparti, bien limité au regard de l’ampleur d’une telle problématique, nous avons tenté d’éclairer quelques-uns des rapports qu’entretiennent ces deux registres, sans méconnaître leurs différences. Prolonger cette analyse supposerait de souligner que ces deux domaines de la formation ne sauraient se résumer à la simple transmission de contenus, selon telle ou telle démarche pédagogique. L’un comme l’autre impliquent de la part du formé des remaniements psychiques profonds, distincts certes, quoique nécessairement articulés. René Kaës (1979, p.50) le perçoit lorsqu’il écrit : « Le modèle de l’Idéal du Moi est formé par l’introjection des parties idéalisées de ceux qui furent nos tout-premiers formateurs2 ». Toute formation, initiale ou continue, comporte bien une transmission. Mais elle ne peut se définir comme reproduction d’un modèle, duplication, donc. Parce qu’elle engage la construction d’une identité professionnelle, ou le remaniement de celle-ci, quoiqu’à des degrés divers selon les cas, elle est création de nouveaux matériaux psychiques identitaires. Ce en quoi elle excède les attentes du formateur sur le formé et leur échappe, inéluctablement. Sous ces aspects, la confrontation à l’inachèvement ne concerne pas seulement le formé, mais sans doute aussi, et au premier chef, le formateur lui-même.