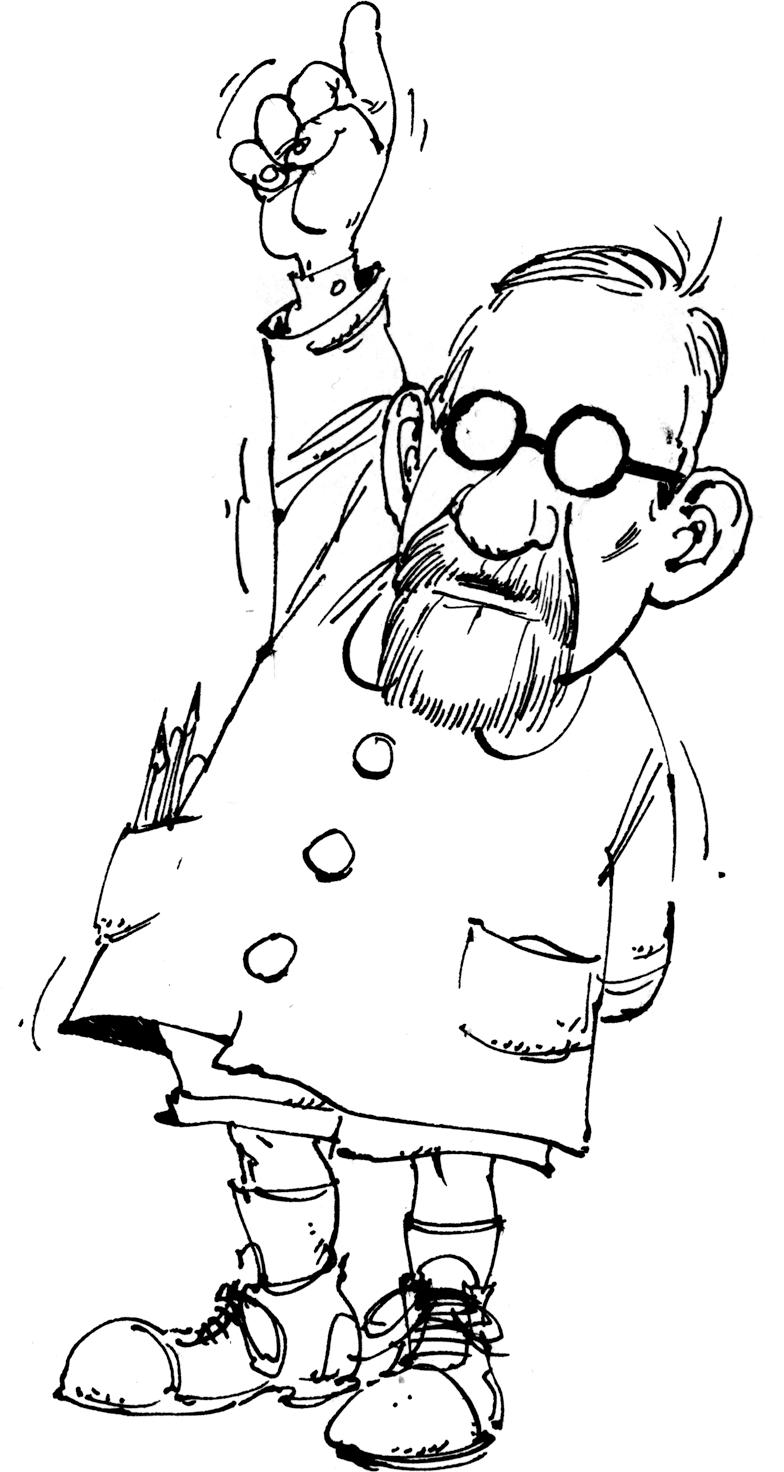Canal Psy : Jérôme Renoult1, bonjour. Dans le cadre de votre Master 2 pro, vous avez été amené à vous impliquer dans les fonctionnements du service formation continue de l’Institut de psychologie de l’université. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Jérôme Renoult : Bonjour. Le travail dont je vais parler a été l’un des objets de mon stage, mais il s’est poursuivi au-delà de mon diplôme de façon concrète. En effet, il s’est agi de mener une réflexion sur les dispositifs de Formation Continue, et leur articulation avec les différentes requêtes et exigences des organismes demandeurs et/ou financeurs. Cela s’est concrétisé par une conceptualisation d’un des moments communs à toute formation : le temps de l’évaluation.
Avant tout, il me semble nécessaire de (re)préciser quelques points utiles à une bonne compréhension.
Le terme de Formation Continue (F.C.) est un terme générique mais dont le champ est clairement délimité. En effet, deux articles de loi (voir Annexe) le définissent et en précisent les contours et les limites. En correction de ces articles viennent aussi les exigences des organismes collecteurs, c’est-à-dire les financeurs officiels des actions de F.C. et auxquels cotisent les établissements s’ils ne financent pas ce type d’actions sur leurs fonds propres.
Le Service F.C., comme tout Organisme de Formation, doit avoir connaissance, vérifier et respecter que les actions proposées sont bien à l’articulation entre la Loi, les exigences des financeurs, celles des demandeurs (collectifs ou individuels), mais aussi la réalité des intervenants/formateurs, des stagiaires, des institutions et des services. Que la formation soit diplômante ou non, il faut aussi comprendre qu’elle ne peut se résumer à des enseignements magistraux : ceux-ci doivent s’inscrire dans un dispositif où processus pédagogique et processus formatif s’articulent et se fondent sur une élaboration théorico-praticienne, elle-même basée sur les pratiques et expériences professionnelles des participants. Les participants sont donc des intervenants, des formateurs, des stagiaires…
Ce dispositif est dit action de formation. Le maître mot est donc action.
Nous pouvons donc résumer ce que doit être la Formation Continue en ces termes, en paraphrasant les articles de loi : Une session de F.C. est une action de préformation et d’adaptation à la vie professionnelle, d’acquisition de qualifications, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances… conforme à un programme établi en fonction d’objectifs et précisant les moyens pédagogiques et d’encadrement et définissant un dispositif permettant de suivre l’exécution de ce programme et d’en apprécier les résultats. C’est en particulier ce dernier point qui a fait l’objet de mon travail où l’idée même d’évaluation en F.C. est certes considérée comme un outil par certains, mais semble ne pas prendre la même valeur selon que l’on écoute la rigueur du législateur et des financeurs, le point de vue des formateurs ou celui des stagiaires.
Canal Psy : Comment comprenez-vous l’appréhension de ce temps d’évaluation par les formateurs ou par les stagiaires, et comment définiriez-vous sa ou ses fonctions dans un dispositif de formation continue ?
Jérôme Renoult : Le terme « appréhension » que vous employez rejoint les conclusions de cette réflexion menée au sein du service. On peut en effet jouer avec deux compréhensions du mot appréhension :
Si la définition est : « action d’envisager quelque chose avec une inquiétude ou une crainte diffuses, mal définies », nous pouvons alors imaginer (envisager ?) de l’ambivalence, tant pour les formateurs que pour les stagiaires : où évaluer peut recouvrir une idée de jugement, de critique, ou de défoulement, de tribunal…
Si la définition est : « Fait de saisir par l’esprit », le mot appréhension pourrait être synonyme de « compréhension subjective, imprécise ». Il semblerait ainsi nécessaire de définir les fondements, le déroulement et les objectifs d’une « action » d’évaluation en amont, dans le « programme établi », donc dans le dispositif même. Ces clarifications autour des intérêts et des objectifs réalisés permettraient une compréhension plus globale et objective et favoriseraient sans doute l’investissement de ce temps par les stagiaires, comme par les formateurs.
Si les deux définitions apparaissent valables, ce petit jeu avec les mots révèle qu’en fait, si la pédagogie connaît les intérêts de ces temps d’évaluation, si le législateur et les financeurs l’exigent, beaucoup de stagiaires et beaucoup de formateurs semblent craindre, ou pour le moins être réservés quant à ces temps d’expression autour d’un « Je » commun (où Narcisse pourrait s’imaginer au centre des considérations ?). Afin de démythifier, peut-être, ce qu’est l’évaluation en Formation Continue et la débarrasser si possible de son aura quelque peu négative, afin aussi, dans le même mouvement, de motiver stagiaires et formateurs, il a été nécessaire d’inventer et d’élaborer un outil-dispositif, à l’usage des formateurs et des intervenants en F.C. Il ne s’est pas agi de construire un questionnaire universel d’évaluation, bien sûr, mais d’imaginer qu’un tel dispositif pourrait devenir un outil d’élaboration et de meilleure compréhension du processus d’évaluation en F.C. à l’usage du formateur.
Les principes de cet outil sont : Un postulat : une évaluation est un bilan motivé et argumenté, pas uniquement un compte rendu d’activité. Elle advient en sus des éventuels contacts/échanges/comptes rendus intervenus tout au long de la formation entre les divers protagonistes de la formation. Elle n’est pas un jugement enfermant mais elle se veut être une appréciation structurante : en vue d’une réflexion, d’une élaboration, tournée donc vers l’avenir.
Elle se décline en trois aspects princeps : Une Évaluation collective : formateur/groupe2 Il s’agit de l’évaluation permanente pour et par le groupe et le formateur. C’est, un moment d’échanges planifié en fin de formation qui autorise et ritualise le terme de cette action et qui doit permettre à chacun des stagiaires de s’exprimer sur son propre parcours formatif, ses acquis et la satisfaction (ou non) de ses besoins. Il permet en outre à l’intervenant d’apprécier, voire de mesurer la qualité et la portée des acquisitions en regard des processus observés et des méthodes employées.
Une évaluation interne : Service/formateur. Il s’agit d’une évaluation de l’adéquation de la formation à la demande, des appréciations quant à l’organisation, à l’administration, à la logistique et à la pédagogie, et qui donnera lieu à deux types d’écrits. Un document strictement interne (au service) s’autorisant une observation critique et constructive des processus et des méthodes, des conditions et du déroulement du ou des modules. Cet exercice générera de fait un temps et un espace d’élaboration professionnelle pour le formateur et pour l’organisateur (le service). C’est la construction d’une trace, d’une référence. C’est à partir de ce document strictement interne que le responsable du Service élaborera un second document, communicable par essence, et argumentant que cette formation relève bien des critères officiels régissant la Formation Continue telle que la définit le Code du travail et que l’exigent les organismes financeurs. Ce dernier document peut être transmis : à la structure si elle en fait la demande ; par la structure à l’organisme collecteur pour toute formation relevant de son financement. Une Évaluation coopérative : service/structure Il s’agit d’une appréciation « in fine » qui cherche à apprécier l’adéquation de la formation à la demande individuelle et/ou institutionnelle, la reproductibilité à d’autres niveaux professionnels et les bénéfices mesurables, les suites possibles et les approfondissements envisageables.
Canal Psy : Pourquoi vous semble-t-il nécessaire d’accorder cette place spécifique au temps d’évaluation en fin de formation ?
Jérôme Renoult : Il est important de considérer le temps d’évaluation comme faisant concrètement partie du dispositif de F.C. C’est ce que veut signifier le titre de cet article : « l’évaluation en formation continue : clé de voûte et interface ». L’évaluation en F.C. est certes un bilan mais aussi une préparation des sessions de formation qui suivront. C’est en cela qu’elle peut être qualifiée d’interface en tant qu’elle est un outil qui relie les différents acteurs (structure, groupe, formateur, service) et qu’elle participe ainsi à la création, à l’invention, à l’élaboration des sessions suivantes :
Ceci est vrai pour le stagiaire qui, fort de nouveaux fondements professionnels et identitaires, inventera son cheminement jeune et inédit et pourra favoriser par exemple certaines orientations, ou affiner ses choix et stratégies professionnels.
Ceci est vrai pour le formateur qui saura utiliser les richesses et les faiblesses remarquées de son intervention afin de construire et d’adapter peut-être mieux les contenus transmis et sa pédagogie. Il faut conserver à l’esprit que l’évaluation dont il est question relève de l’appréciation d’un processus formatif : de l’adéquation du dispositif aux objectifs et aux attentes des stagiaires et de leurs institutions, de l’effet des dispositifs quant à l’appropriation des outils proposés, de l’adaptation des méthodes utilisées pour les transmettre.
Le temps d’évaluation est aussi la clé de voûte de l’action de formation dans la mesure où l’une de ses fonctions est bien de participer à ce qu’un temps d’acquisition de connaissances devienne, se transforme en processus formatif. L’évaluation est ainsi un outil pour une élaboration créatrice et de transformation, pour une métabolisation psychique d’une identité professionnelle nouvelle, fondée et ancrée sur l’expérience revue et élaborée à l’aulne de nouveaux éclairages théorico-praticiens.
L’action d’évaluation (d’élaboration) permet en outre de prendre en compte et de comprendre les – nouvelles – demandes et donc d’adapter les propositions et les dispositifs aux besoins latents ou exprimés. Elle participe au dispositif et à la genèse du dispositif. Elle est planifiée et s’inscrit de facto dans le cadre formatif et dans des repères rassurants : elle veut être une porte ouverte vers l’expression, donc vers l’élaboration praticienne. Elle est aussi ce qui montre le formateur humain, convenablement bon et rassurant, donc cadré et cadrant.
Elle est en amont de la formation, en tant qu’observation et reconnaissance de l’expérience ; transversale dans la mesure où elle est une démarche participant à la fondation et à l’institution du processus de formation ; elle est l’occasion pour chacun (stagiaire et peut-être aussi formateur) de penser « en mode “je” » afin de s’observer et de se situer dans un processus intrapsychique de mutation identitaire professionnelle. ; elle est évidemment après : favorisant la poursuite de processus élaboratifs individuels, collectifs et institutionnels mais aussi participant à l’origine des autres actions de formation à suivre.
L’évaluation est donc un outil d’observation et de compréhension « méta » d’un dispositif et de son adaptation à la réalité et à la demande : au-delà d’un principe de plaisir égotique, il s’agit d’une mise en lien avec une réalité toute professionnelle : collective et individuelle, intrapsychique et intersubjective. Elle est utile aussi aux institutionnels (service et structure) qui, selon leurs politiques et leurs objectifs, pourront fonder à la fois leur réflexion et leurs argumentations, en articulation avec les exigences du législateur.
Canal Psy : Qu’en est-il des interventions d’analyse de la pratique auprès des équipes, proposées par l’Institut ? Ont-elles le même statut que les actions de formation que vous venez d’évoquer ?
Jérôme Renoult : L’analyse de la pratique est expressément exclue du cadre de la formation continue en tant que telle. Le législateur et les financeurs ont effectivement des exigences, et ils demandent de justifier – d’expliquer ? – leurs investissements financiers. Celles-ci sont fondées assurément sur nombre d’excès commis au long des années par, entre autres, de possibles dévoiements sectaires ou simplement par trop d’amateurs qui ont profité de l’engouement pour les théories dites d’évolution personnelle dans les années 1970-1980 d’une part, par l’avidité suscitée aussi par cette nouvelle manne financière.
Tout organisme collecteur refusera donc de financer une action de formation nommée analyse de la pratique et la déclaration officielle d’un Organisme de formation que je citais plus haut, si elle doit se fonder sur une action de formation réalisée, ne peut considérer cette demande au vu d’une action d’analyse de la pratique.
Nous sommes cependant d’accord pour constater que de telles actions ne paraissent pas, aux cliniciens que nous sommes, en contravention avec les articles de loi dont j’ai parlé tout à l’heure. Mais la réalité officielle et administrative est autre.
En conclusion, je dirais qu’une action d’évaluation, en cours, en fin, ou en périphérie d’une action de formation peut et doit être considérée comme une forme singulière d’élaboration autour des pratiques professionnelles : celles apportées par les stagiaires et celles du formateur.
En cela, l’évaluation d’une session, d’une intervention ou d’un module, en concourant à l’accession aux objectifs de formation, participe à la transmissibilité des savoirs, à la transférabilité des acquisitions sur les différents registres professionnels, à l’observation, à la reconnaissance et à la mise en valeur de l’expérience mais aussi à l’amélioration de l’outil formatif.
Au cours de ce travail, il est apparu important de (re)donner à ce temps de nouvelles lettres de noblesse, de l’envisager comme un dispositif, comme un outil, comme un module non contournable de toute formation proposée par le service F.C. de l’Institut de psychologie, mais aussi, pourquoi pas à toute formation ?