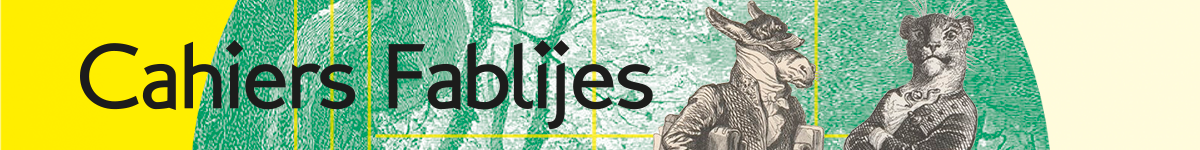Dans son très sérieux ouvrage L’Éducation des filles, Henri Marion, premier titulaire d’une chaire en science de l’éducation en France, fait un rare aveu de perplexité lorsqu’il aborde l’épineuse question de la lecture des fillettes : « Quant à la question de savoir ce qu’on peut faire lire à une fille intelligente, elle est fort difficile1 ». Il décrète toutefois immédiatement l’« interdiction générale de lire à tort et à travers2 » pour les demoiselles.
Le xixe siècle tente d’éduquer ses petites filles à la vertu. Le nouveau modèle bourgeois s’appuie sur une famille réduite, notamment grâce aux progrès de la contraception3 ; on cherche de plus en plus à prendre en compte – et donc à contrôler – l’intériorité des petites personnes. Les petites filles méritent une attention toute particulière : il convient de protéger leur pureté, tout en leur livrant des rudiments d’instruction qui fassent d’elles des ménagères rationnelles et des épouses convenables. Comme le résume Legouvé, directeur de l’École normale de jeunes filles de Sèvres, dans son Histoire morale des femmes : « Savez-vous pourquoi il faut bien élever les femmes ? Parce que c’est le meilleur moyen de bien élever les hommes4 ! »
L’alphabétisation des filles se diffuse dans tout le peuple, particulièrement après les lois Ferry de 1881-1882, qui rendent l’enseignement primaire gratuit et obligatoire pour les enfants des deux sexes, de six à treize ans. Martine Reid estime qu’à « la fin du xixe siècle, caractérisé par un véritable “âge d’or du livre”, le taux d’alphabétisation atteint 90 % pour les hommes comme pour les femmes alors qu’il était de 30 % pour les femmes et de 50 % pour les hommes à la Révolution5 ». Les petites filles peuvent désormais lire, et elles ne s’en privent guère : la littérature pour la jeunesse se développe, grâce par exemple à la création dès 1856 par Hachette d’une collection qui leur est dédiée, la Bibliothèque rose. Des imprimés pour petites filles, tel le Journal des demoiselles, rencontrent également un franc succès.
L’on se souvient qu’Henri Marion avertissait des dangers d’une lecture hors de contrôle pour les fillettes. Que peut-il donc arriver à une enfant qui lit « à tort et à travers » ? Elle risque, menace le pédagogue, d’être « diminuée et comme déflorée6 ». Le problème de la lecture des petites filles touche à celui de la maîtrise de la sexualité des jeunes filles qu’elles deviendront. Une fillette qui lit s’expose à échapper à ce que Gabrielle Houbre nomme la « pédagogie de l’ignorance7 », éducation à l’innocence imposée aux demoiselles jusqu’à leur nuit de noces. Préserver les petites filles de la mauvaise lecture, ce serait garantir la moralité des futures jeunes filles à marier. L’enjeu de la lecture enfantine féminine est primordial pour un xixe siècle qui considère la virginité physique et morale comme le capital essentiel d’une demoiselle. Les récits du second xixe siècle manifestent donc à l’inverse leur inquiétude vis-à-vis d’une « mauvaise » littérature qui pousserait les petites filles à la découverte du désir, tandis que la lecture pourrait au contraire, si elle était bien orientée, préserver l’enfant de toute future pensée érotique. Comment s’exprime et se construit, dans les discours du second xixe siècle, cette obsession de la lecture comme poison ou antidote qui pousserait les petites filles au vice, ou bien les en préserverait ?
Le réquisitoire contre les lectures déraisonnables des petites filles, qui précipiteraient les futures jeunes filles dans l’adultère ou l’hystérie, devient un véritable topos de l’époque, appuyé par des arguments scientifiques. Pour contrer ce fléau, des lectures recommandables tentent d’enseigner la maîtrise des pulsions, tout en préservant le secret de la sexualité. Conciliant de manière inédite savoir sur la sexualité et objectif moral, les positifs élaborent déjà pourtant des leçons de choses censées former des petites filles savantes, capables de se garantir elles-mêmes contre le désir physique.
Lectures tentatrices : les « mauvais livres »
Déjà Rousseau avertissait à l’orée de sa Nouvelle Héloïse en guise de paradoxale préface : « Jamais fille chaste n’a lu de romans8 ! » Le second xixe siècle ne dément guère le père de Julie : la plupart de ses héroïnes entament leur chemin de perdition dès l’enfance, par de précoces et trop libres lectures. L’exemple paradigmatique de ces rêveuses bien punies est Emma Bovary, qui bien avant son mariage, s’est égarée dans les keepsakes et leurs songes d’amour :
Elle frémissait, en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures, qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C’était, derrière la balustrade d’un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche9.
Lorsqu’elle succombe pour la première fois aux bras d’un amant, le lien est immédiatement fait entre sa chute adultère et ses lectures de jeunesse : « elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus10. » Certes, Flaubert est ironique, et joue avec les topoï des effets de la littérature récurrents chez les censeurs de son temps. Mais son roman, pour être sarcastique, n’en reflète pas moins un discours d’époque – fût-ce avec distance. Ernest Pinard, procureur impérial chargé du réquisitoire contre Flaubert lors du procès de Madame Bovary, pointe quant à lui sans nulle dérision ce danger de la lecture dans une vertigineuse mise en abyme, accusant l’ouvrage de produire sur ses lectrices – et particulièrement les plus jeunes – l’identification romanesque néfaste qui a perdu son héroïne11. Marie Baudry explique, dans Lectrices romanesques, comment le xixe siècle a forgé, notamment après la parution houleuse de Madame Bovary, l’image d’une lectrice naïve et prompte à se perdre dans les romans, par opposition à celle d’un lecteur sérieux et capable de recul critique. La « maladie de la lecture » est désormais genrée : « la réception romanesque commune – qui va notamment faire de Mme Bovary une hystérique malade de ses lectures, quand bien même le terme “hystérie” n’apparaît jamais dans le roman – contribue à forger l’image d’une lectrice malade12. »
Les médecins du temps érigent en effet la lecture féminine en question d’hygiène publique. Dans son Traité complet de l’hystérie, le docteur Landouzy fait des romans un facteur prédisposant à l’hystérie : « les romans troublent ce calme du cœur si indispensable à la moralisation […] [et] préparent pour l’avenir ces désillusions, ces désenchantements, causes premières de tant d’accès hystériques13. » Le médecin cite avec déférence une sentence qu’il attribue à Tissot : « Si votre fille lit des romans à dix ans, elle aura des vapeurs à vingt14. » Le siècle positif remplace la rhétorique du péché par celle de l’hygiène, mais l’impératif est le même : si la petite fille s’écarte des lectures permises, elle menace de devenir une adolescente corrompue par le désir.
Les romanciers s’emparent de cette pathologisation de la petite lectrice, la nourrissent, et la transforment en un matériau poétique métalittéraire qui fait de leur œuvre le remède autant que le mal. La lecture devient, pour les fillettes du roman du second xixe siècle, l’instrument privilégié de l’initiation sexuelle. Dans Chérie, le personnage éponyme de Edmond de Goncourt découvre la jouissance physique en lisant des romans, avant même sa première communion. La petite hystérique connaît sa première fièvre de lecture lorsque, atteinte de la scarlatine, elle dévore des romans dans « une espèce d’exaltation bizarre15 », « une absence d’elle-même ineffable, dans laquelle elle ne savait trop ni ce qui se passait autour d’elle, ni ce qu’on lui disait16 ». Le roman file la métaphore de l’extase avec une insistance grandissante. La lecture de l’enfant est progressivement assimilée à la masturbation : elle est « jouissance donnée par l’accomplissement d’une chose défendue17 », accomplie « la nuit, dans le noir du grand salon du Ministère, sollicitée par une curiosité malsaine de vierge18 ».
Selon l’expression de Marie Baudry, « le livre [est] devenu métonymique de l’amant19 » – mais il n’offre que de fictives satisfactions, qui laissent la petite fille épuisée, comme le fait l’onanisme dans le discours médical du temps20. Chérie finit par mourir de désir inassouvi ; sa pratique immodérée de la lecture dans l’enfance l’a menée à une frustration sexuelle fatale pour la jeune fille qu’elle est devenue. La lecture mal dirigée est un plaisir coupable, qui fait frémir les vierges, elle est une honte, un secret qui brise l’innocence de l’enfance et s’aiguise dès les émois de la puberté. Dans la nouvelle « Après la bataille », Paul Alexis met entre les mains de sa lectrice néophyte des ouvrages pornographiques, auxquels mène, bien sûr, toute fréquentation trop assidue et solitaire de la bibliothèque :
[…] n’ayant plus rien à lire et assoiffée de nouveau, elle bouleversait de fond en comble la bibliothèque, le hasard lui avait révélé l’existence d’un « secret ». Elle n’avait eu qu’à presser un imperceptible bouton simulant une nodosité naturelle du bois, et un panneau avait basculé, découvrant une cavité cachée. Elle était tombée sur une vingtaine de volumes pornographiques.
[…] sûre de n’être pas dérangée, au pied d’un vieux faune en pierre, mutilé, lutinant une nymphe sans bras, elle avait regardé de nouveau les gravures. […] Autour d’elle, dans la profondeur des charmilles, de doux frottements d’ailes palpitaient avec un bruit de caresse invisible. La joue embrasée et le front en sueur, suffoquée, elle cessait parfois de lire21.
La diégèse donne raison aux discours médicaux du temps : la porte de la bibliothèque a mené à la découverte de la masturbation. Le « secret », terme de mobilier qui désigne un mécanisme caché, figure aussi le secret de la sexualité révélé à la très jeune fille. Le terme de « bouton », que la demoiselle comprend comment presser en découvrant ledit secret, désigne dans l’argot du xixe siècle le clitoris. Par une métonymie graveleuse, qui reflète de manière dissimulée mais très compréhensible pour les contemporains un topos du discours social sur la lecture féminine, le paysage est chargé de signifier la dimension masturbatoire de la lecture féminine, à travers une isotopie de l’onanisme légitimée par ce déplacement descriptif. La jeune lectrice présente bientôt tous les symptômes de la petite masturbatrice : amaigrissement, cernes, apparente anémie, et guérison par le mariage. Les noces, remède préconisé par la nourrice, qui elle, n’a point perdu son bon sens puisqu’elle ne sait « ni lire ni écrire », rétablissent la lectrice.
Les différents discours du second xixe siècle font donc de la lecture un danger parfois mortel pour les fillettes, et du « mauvais livre », le chemin de perdition qui mènera la future jeune fille à l’immoralité. Alors, que serait le « bon livre », qui au contraire fermerait la porte de la tentation aux petites filles ?
Lectures pour petites filles modèles : préserver les demoiselles du désir
La « bonne » lecture est celle qui permet à la petite fille, selon la formule de Martine Reid au sujet des recommandations de lecture genrées du temps, de « devenir une tendre épouse et une mère dévouée, l’amour étant inlassablement présenté comme la juste récompense de celles qui auront su se conformer aux modèles22 ». Le choix des lectures enfantines est, nous l’avons dit, une question de mœurs, mais aussi d’hygiène pour le second xixe siècle ; il s’agit de fournir aux demoiselles des aliments livresques adaptés à leur physiologie délicate, qu’un rien peut bouleverser. Emma Pieczynska file à dessein la métaphore alimentaire :
Les lectures et les conversations obscènes, par les objets dont elles remplissent l’imagination, ont sur les organes un effet analogue à l’alcool et aux autres toxiques excitants, de sorte qu’en prescrivant une alimentation sobre, il s’agit, au même titre, du régime de l’esprit et de celui du corps23.
Seules des lectures saines – qui ne parlent pas d’amour, et encouragent à la bonne conduite, c’est-à-dire à la discipline du corps et de l’esprit – peuvent garantir les fillettes contre une future irruption du désir. Malgré les désaccords idéologiques sur la place de la religion dans l’instruction des filles, on retrouve donc ces impératifs pédagogiques à la fois chez les éducateurs laïcs, partisans de programmes scolaires mettant au premier plan la dimension morale de tout enseignement, et chez les cléricaux, qui font de la piété le socle moral des petites filles.
Du côté des républicains laïcs, Henri Marion souligne la dimension genrée de ses instructions : « dévorer les livres, qui est un si bon signe et une promesse de développement pour les garçons, importe beaucoup moins pour les filles. Que sera-ce si elles dévorent des romans24 ? » Aux filles, sentimentales et malléables, il convient de « donner le goût et l’habitude des lectures solides qui développent le goût et la raison, qui augmentent le lest de l’âme25 », afin de contrer tout penchant romanesque. Marion, dont la femme a dirigé l’École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, recommande la lecture des classiques (Virgile, Horace, Racine, Hugo et Sand), par parties, afin d’élaguer les passages « délicats » – on connaît trop les filles d’Ève – ainsi que « les voyages, l’histoire, les mémoires, tout ce qui instruit et initie à la vie réelle, sans exciter par l’imagination ni faire parler le cœur26 ».
Mêmes consignes chez les cléricaux, qui y ajoutent un peu de lectures pieuses. L.-B. Daguirre, institutrice de son état, et autrice de Ce que Fénelon dirait au xxe siècle sur l’éducation des filles, affirme : « s’il faut absolument qu’une jeune fille lise des romans, je choisirais l’auteur dont jamais une ligne ne risque de troubler l’âme la plus neuve27. » Elle « tolère » Zénaïde Fleuriot et quelques autres car « ils la reposent et ne lui fournissent que des idées riantes et saines28 », en vertu d’« un réalisme de bon aloi ». On pourrait extraire de leurs œuvres « toute une galerie curieuse de types locaux très pittoresques : originaux de petites villes, vieilles filles maniaques et touchantes, vieilles femmes avares et dévotes, et tant d’autres qu’on croit avoir rencontrés29 ». Le « bon livre » est même préférable au « beau livre » : il ne faudrait mettre entre les mains des filles que des romans moraux, qui montrent « Les Deux Chemins de la vie, ou la Puissance des principes », pour reprendre le titre évocateur d’un ouvrage de Mme Caubet-Darius30, autrice de romans éducatifs pour demoiselles sages. Alexandra Delattre a montré comment s’est constituée une « littérature de contre-offensive31 », lisible par les plus immaculées, dans laquelle « la jeune fille ou la vierge chrétienne devient l’étalon d’une littérature honnête, dont l’ambition est de convertir le romanesque à la pureté32 ».
Si, lorsque Hachette crée la « Bibliothèque rose » en 1856, l’éditeur cherche avant tout à exploiter économiquement l’explosion de la lecture enfantine, la collection produit de manière sérielle de petites héroïnes qui trouvent le chemin de la vertu en domptant leurs vices. Ces romans de formation enseignent le moyen de devenir la demoiselle idéale, qui sait maîtriser toutes ses pulsions mauvaises, à l’instar de Sophie, que la comtesse de Ségur présente ainsi dans la préface de ses Malheurs :
Voici des histoires vraies d’une petite fille que grand-mère a bien connue dans son enfance ; elle était colère, elle est devenue douce ; elle était gourmande, elle est devenue sobre ; elle était voleuse, elle est devenue honnête ; enfin, elle était méchante, elle est devenue bonne33.
La petite fille modèle est celle qui laisse à sa mère le soin de lui fournir des livres bien sages, comme l’indique la tournure factitive à la clausule des Malheurs de Sophie : « Si vous désirez beaucoup savoir ce que devint Sophie, demandez à vos mamans de vous faire lire les Petites filles modèles, où vous retrouverez Sophie34. » Mais les mamans chez Ségur ne font jamais lire à leurs petites filles de « vrais » livres : l’épisode du « faux » livre que reçoit Sophie pour son anniversaire est à cet égard significatif. Pour ses quatre ans, la mère de Sophie lui offre une boîte à couleurs en forme de livre – l’enfant est déçue, jusqu’à ce que la mère dévoile l’heureuse supercherie, en une formule lourde de sens : « Tu étais un peu attrapée tout à l’heure, quand tu as cru que je te donnais un vrai livre ; mais je ne t’aurais pas joué un si mauvais tour35. » La lecture bien dirigée peut avoir un pouvoir lénifiant, qui permet aux petites filles d’acquérir le calme silencieux attendu de leur sexe, et l’art de discipliner leur corps. Lorsque Sophie fait pénitence, après un caprice au cours duquel elle a déchiré un livre : « elle se m[e]t à lire36 », puis va embrasser tout doucement Marguerite, contre laquelle elle s’est mise en colère avant la lecture. Également dans Les Petites Filles modèles, chez Madeleine, perfection de fillette, la lecture calme et instructive va de pair avec l’apprentissage de la maternité : « Madeleine préférait au contraire à tout ce joyeux tapage la lecture d’un livre intéressant, les soins qu’elle donnait à sa poupée37. » Voilà une habile mise en abyme, qui félicite implicitement la petite fille modèle en train de lire Ségur, et la prépare à son rôle futur de mère de famille raisonnable, capable de maîtriser les désordres extérieurs et intérieurs. Marie-Christine Vinson souligne cet apprentissage des bornes de la féminité dans et par les romans de Ségur, où
la conscience de sexe se forme à travers le repérage des limites : encloses dans des rôles sociaux (mère-éducatrice) régnant sur des espaces “autorisés”, refoulées hors des espaces interdits, les fillettes doivent apprendre, sous la tutelle maternelle, à reconnaître leur domaine38.
Zénaïde Fleuriot, qui remplace la comtesse de Ségur chez Hachette en 1874, confère également à la lecture le pouvoir de mettre les petites filles à leur place – c’est-à-dire bien loin du désir. Cette fervente catholique traditionnaliste a laissé plus de quatre-vingt-trois romans pour enfants, extrêmement populaires en leur temps. Visant toujours l’édification morale de ses lectrices, ses romans s’achèvent souvent par une petite leçon de bonne conduite. Ainsi en va-t-il de la clausule de Sans Beauté, réédité pour la vingt-et-unième fois en 1905, qui s’adresse directement à la destinataire afin de prêcher un amour chrétien détaché du corps :
Après l’avoir lu, chère lectrice, que vous soyez jolie, ce qui est agréable, ou que, comme madame du Bressy, la nature à cet égard vous ait mal traitée, vous penserez qu’avec un cœur aimant et dévoué, un caractère égal, des sentiments nobles et élevés, la ferme pratique de la religion bien entendue, une femme peut être heureuse et se faire sérieusement aimer39.
Se développe donc au cours du second xixe siècle, de manière massive grâce à l’industrialisation, à l’alphabétisation et aux évolutions du statut infantile féminin, une littérature pour les petites filles, visant à leur enseigner la pureté. L’autodiscipline corporelle et mentale, apprise dès l’enfance, permettrait une maîtrise des pulsions plus aisée lorsque vient la puberté. L’habitude des limites acquise par la petite fille préserverait la future jeune fille de l’idée même de la sexualité.
Pourtant, quelques voix s’élèvent déjà contre cette école à œillères, et soutiennent au contraire que seules des lectures qui leur apprennent clairement ce qu’est la sexualité peuvent garantir les fillettes contre l’envie d’ouvrir sans surveillance la boîte de Pandore.
Leçons de choses : les filles savantes
Certains romanciers défendent avec verve la nécessité de fournir aux filles des lectures qui ne soient pas édulcorées de toute référence à la sexualité. Zola se fait le champion de la cause, prenant position dans son article « De la moralité en littérature » en 1880 :
Notre jeune fille française, dont l’instruction et l’éducation sont déplorables, et qui flotte de l’ange à la bête, est un produit direct de cette littérature imbécile, où une jeune vierge est d’autant plus noble qu’elle se rapproche davantage d’une poupée mécanique bien montée. Eh ! Instruisez nos filles, faites-le pour nous et pour la vie qu’elles doivent mener, mettez-les le plus tôt possible dans les réalités de l’existence40.
Les romans de Zola, et particulièrement ses derniers, virulents contre la tutelle de l’Église, illustrent cette thèse. Dans La Joie de vivre, Pauline est tellement choquée à l’arrivée de ses premières règles, dont personne ne lui a annoncé la venue ni expliqué le fonctionnement, qu’elle est menacée par une fièvre cérébrale. Afin de réparer cette ignorance qui a failli la tuer, elle fait sa propre éducation sexuelle, en fréquentant le Traité de physiologie de Longet (auquel Zola ajoute un « u » fautif) et l’Anatomie descriptive de Cruveilhier :
Elle les sortait, dès que sa tante tournait le dos, puis les replaçait, au moindre bruit, sans hâte, non pas en curieuse coupable, mais en travailleuse dont les parents auraient contrarié la vocation. D’abord, elle n’avait pas compris, rebutée par les mots techniques qu’il lui fallait chercher dans le dictionnaire. Devinant ensuite la nécessité d’une méthode, elle s’était acharnée sur l’Anatomie descriptive, avant de passer au Traité de physiologie. Alors, cette enfant de quatorze ans apprit, comme dans un devoir, ce que l’on cache aux vierges jusqu’à la nuit des noces. […]. Il n’y avait aucun mal à savoir41.
Voici une nouvelle figure de jeune lectrice : non plus la petite masturbatrice qui lit en cachette comme on s’adonne à un vice coupable, ni la petite fille modèle qui lit des contes de fées à sa poupée, mais la « travailleuse », qui s’attelle au grand jour à des lectures scientifiques sur la reproduction humaine. Contrairement à ce que redoutent les partisans du roman catholique, la connaissance de la sexualité, acquise dans des ouvrages techniques, ne menace pas l’innocence de Pauline, mais la préserve : « Ses lectures, cette anatomie, cette physiologie épelées passionnément, lui avaient laissé une […] virginité de corps42. » A contrario, Louise, personnage construit en miroir inversé de Pauline, est corrompue par les demi-savoirs acquis dans la tartufferie du couvent, qui n’ont fait qu’attiser son avidité fouineuse. Zola va jusqu’à suggérer qu’il aurait mieux valu fournir ces explications scientifiques à Pauline avant même l’arrivée de sa puberté, afin de lui éviter la crise de panique qui a submergé l’enfant trop inculte. C’est la fiction sentimentale qui est stigmatisée comme un ferment de vice : « les romans qui traînaient dans la maison, des histoires d’amour aux trahisons poétisées, avaient toujours révolté sa droiture43. » Zola recourt de plus en plus à ces jeunes héroïnes savantes et sages : Clotilde, dans Le Docteur Pascal, sait les choses du sexe, de même que Marie, dans Paris, instruite au lycée Fénelon :
Elle savait tout. Mais si elle n’avait plus la poésie de la jeune fille ignorante et bêlante, elle y gagnait une réelle probité de cœur et d’esprit, une parfaite innocence au grand jour, sans réserve d’hypocrisie, sans perversité cachée, aiguillonnée par le mystère44.
Reprenant les thèses zoliennes dans Prostituée, Victor Margueritte inscrit le personnage de Gaby au lycée Molière, où elle acquiert des connaissances anatomiques et un esprit critique qui lui permettent de se garder pure :
Bien qu’il eût donné à ses filles, — Gaby avait suivi le cours du lycée Molière, — une éducation moderne, de libre pensée et d’examen scientifique, M. Ardant ne s’était pas fait encore à toute cette franchise de réflexion, et de parole. Certaines hardiesses l’étonnaient, le heurtaient même parfois. Il se louait que Gaby fût avertie, connût, du problème sexuel, les données théoriques. Ainsi la pensée féminine se libérait de cette funeste demi-ombre, d’où tant de malentendus, sentimentaux et charnels, prennent naissance et corps. Et cependant, — tant était fort, invétéré le préjugé masculin en vertu duquel la jeune fille doit être tenue dans une secrète ignorance, arriver au mariage, selon les termes de Gaby, comme une victime à l’autel ! — M. Ardant, souvent hésitait, penchant du côté de sa femme traditionnaliste45.
La « femme traditionnaliste » en question, ironie narrative, se prostitue tous les après-midi dans une maison de rendez-vous, tandis que sa fille Gaby devient une mère et une épouse modèle. Ces cas de revendication d’initiation des jeunes filles restent toutefois rares dans le roman du second xixe siècle. Quoique le personnage de la jeune fille instruite soit de plus en plus valorisé, grâce notamment aux figures zoliennes, la doxa préfère encore massivement pour les demoiselles des lectures épurées de toute allusion au désir physique.
En outre, quelques romans pour jeunes filles proposent une autre voie, moins genrée, et moins sexualisée, élaborant des modèles alternatifs mixtes qui ne célèbrent pas la pureté féminine. C’est le cas des Contes d’une Grand’Mère, où Sand met à l’honneur le respect de la nature, fondé sur la communion entre les êtres végétaux, animaux et humains. Le récit « La Fée Poussière », qui fait l’éloge de la beauté de la saleté, éloigne les fillettes de l’idéal de la femme d’intérieur qui apprend à la traquer. Loin de confiner les petites filles dans la prison dorée d’une maison de poupées trop cloisonnée, Sand réenchante le réel, et invite les enfants des deux sexes à se confronter au vaste monde. Elle n’aborde guère la question de la police des pulsions physiques : l’obsession du rapport féminin à la sexualité semble écartée par les contes sandiens.
Lecture et initiation féminine à la sexualité sont intimement liées dans l’imaginaire du second xixe siècle : à la petite lectrice de mauvais livres, qui transgresse le secret, est bientôt réservé le sort douloureux des onanistes et autres hystériques. Certaines petites filles évitent ces romanesques rêvasseries qui mèneraient à la déception sexuelle, en fréquentant des romans moraux édifiants, écrits spécialement pour elles, afin de les éloigner de tout savoir sur la sexualité. Chez quelques rares romanciers défenseurs d’une éducation résolument moderne, au premier rang desquels Zola, émergent des personnages de filles encore vierges dévorant des ouvrages d’anatomie ; l’ignorance n’apparaît déjà plus comme le moyen de préserver l’innocence.
Le lien entre lecture romanesque et masturbation est établi moins couramment pour les garçons, dont la raison serait moins perméable aux œuvres d’imagination. Chez Proust pourtant, dès les premières pages de La Recherche, le narrateur s’adonne conjointement dans le petit cabinet qui sent l’iris, cachette pour ses rêves purs et moins purs, à la lecture et à la masturbation :
Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce, d’où l’on voyait pendant le jour jusqu’au donjon de Roussainville-le-Pin, servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu’elle était la seule qu’il me fût permis de fermer à clef, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude : la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté46.
Tel le cabinet proustien, la lecture – fût-elle sage comme une image – constitue pour les petites filles du xixe siècle cette pièce mentale, « room of one’s own » dont les mamans, les médecins et les institutrices n’ont pas toujours la clef.