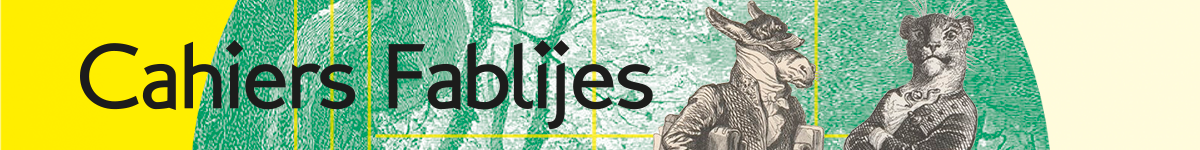Alors que les études balzaciennes ont accordé depuis quelques décennies une place centrale à la réception des œuvres du corpus de La Comédie humaine, en montrant particulièrement la place, à la fois fictive et effective, accordée au public féminin, les études de la lecture féminine dans les œuvres littéraires, et en premier lieu dans les romans, restent peut-être à développer. Les travaux portent souvent sur le rapport entretenu par la narration balzacienne avec une correspondante fictive ou réelle féminine, à laquelle le texte s’adresse plus ou moins explicitement1. D’autres travaux étudient le lectorat historique du roman balzacien, tel qu’on essaye de le reconstruire actuellement en observant la distribution des journaux et des supports imprimés dans la société du xixe siècle sous la monarchie de Juillet, et les lettres de lectrices envoyées à Balzac, portant la trace des lectures – ou des non-lectures – de femmes correspondant avec l’auteur2. Le constat de l’augmentation sensible des pratiques de lecture et de la démocratisation de la lecture est général : les femmes lisent beaucoup au xixe siècle, quand elles savent lire. La multiplication et l’intensification des pratiques d’impression font que, dans une certaine mesure, elles lisent beaucoup. Il est probable que la représentation de la femme lisant dans le roman balzacien procède d’une forme d’homologie dans la création littéraire : c’est parce qu’il y a de plus en plus de lectrices réelles du roman, que le roman peint des figures féminines lisant.
Mais la représentation des femmes qui lisent à l’intérieur du roman balzacien n’est ni neutre ni accessoire : tous les personnages féminins qui lisent proposent, plus ou moins explicitement, un protocole de lecture adressé aux femmes hors de la diégèse. La question du protocole de lecture n’est pas sans évoquer les travaux d’Umberto Eco et de Vincent Jouve sur l’esthétique de la réception, et plus précisément sur les effets qui concourent à expliquer « comment le texte (une fois produit) est lu et comment toute description de la structure du texte doit être, en même temps, la description des mouvements de lecture qu’il impose3 ». Nous partageons ici l’approche du texte comme un espace d’interaction entre un personnage (celui de la lectrice, Modeste, Renée, Louise, etc.) et un narrataire. Comme il est le destinataire final du contenu idéologique du roman balzacien (à savoir, pour le résumer rapidement, que la lectrice est un personnage problématique dans l’appréhension de la valeur du texte littéraire, bien qu’elle en soit paradoxalement le juge le plus sûr), le narrataire joue un rôle essentiel dans la construction d’une vision genrée de la lecture et dans la réception de protocoles de lecture. Aussi, comme le note Vincent Jouve, à propos de ce lecteur programmé par l’énonciation du texte, qu’il nomme « lecteur virtuel » :
Le lecteur a une part active dans la création des personnages : il est absent du monde représenté, mais présent dans le texte – et même fortement présent – en tant que conscience percevante. Il joue, pour les figures romanesques, le rôle de témoin et d’adjuvant4.
Ces protocoles de lecture féminine sont d’autant plus importants que, dans de très nombreux romans balzaciens qui composent La Comédie humaine, la lecture n’est pas un acte neutre. Par la lecture, les personnages accèdent à un degré de connaissance et d’action sur le monde, qui nourrit et innerve l’intrigue même des romans. Pourtant, paradoxalement, dans les deux textes qui nous intéressent, les lectrices expertes sont très rares, voire inexistantes. La Comédie humaine se présenterait alors comme une œuvre adressée à un public féminin, tout en dépréciant et en condamnant l’effet des lectures sur les femmes. C’est ici au concept d’identification que nous devons faire référence, entendu que l’identification est possible, comme son étymologie nous l’indique, parce que la lectrice de fiction, le personnage lisant, est placée dans la même configuration que la lectrice réelle, tenant le livre en main :
Le code narratif est fonction de la place du lecteur dans l’intrigue. Sa force repose sur son caractère mécanique : je m’identifie à qui occupe dans le texte la même position que moi5.
Nous nous interrogerons donc sur les modalités et l’axiologie de la représentation des héroïnes lisant dans le roman balzacien, en nous intéressant principalement à ces deux romans, Mémoires de deux jeunes mariées (1841, roman entièrement épistolaire) et Modeste Mignon (1844, roman à la troisième personne, mais dont une partie constitue un échange prolongé de lettres), où la question de la lecture occupe un rang essentiel6. Dans les deux romans, en effet, les héroïnes, Renée et Louise d’une part, Modeste d’autre part, lisent et communiquent avec des interlocuteurs qui leur écrivent des lettres ; elles reçoivent une correspondance que le lecteur ou la lectrice réelle lisent également. Les romans jouent et jouissent d’une énonciation multiple ; la question de la lecture y est centrale, objet d’une mise en abyme plus ou moins idéologique, qui codifie les pratiques de lecture féminine. En représentant des femmes qui lisent, et en s’adressant à une lectrice idéale qui observe ces femmes qui lisent, le roman balzacien apporte-t-il une condamnation ou un éloge de l’activité de lecture féminine ? La figure du/de la narrataire ne permet-elle pas une relative fusion des genres et une légitimation de l’acte de lecture de La Comédie humaine ?
Trois gestes énonciatifs coexistent en effet dans ces deux romans : d’abord, on examinera la narration comme le fait de parler des femmes. La représentation de femmes qui lisent dans le roman nous apparaîtra ainsi dans son caractère paradoxal, puisque le nombre et les qualités des lectrices du monde de la fiction n’empêchent pas une condamnation générale de la lecture féminine dans cette même fiction. On étudiera alors le roman comme un texte cherchant à parler aux femmes. La question de l’inscription d’une lectrice féminine dans la narration balzacienne, sous la forme d’un idéal-type, nous conduit à montrer comment Balzac s’adresse à des femmes qui le lisent, dans un geste qui cependant n’exclut pas les stéréotypes de lecture, avant même que ceux-ci ne soient réalisés par la lecture effective des femmes. On s’intéressera enfin à l’idée selon laquelle l’œuvre balzacienne est une œuvre qui parle comme les femmes. La figure du/de la narrataire finit ainsi par s’extraire de toute question de genre, pour être à la fois celle de la lectrice et celle du lecteur ; elle est davantage une figure qui offre ses mots au romancier, et qui lui permet de parler des femmes avec les mots des hommes, et des hommes avec les mots des femmes.
« Les mille dégâts des romans qui entrent chez une existence bourgeoise » (I, 5407)
Le roman balzacien est constamment travaillé par l’ambiguïté de la position du narrateur par rapport à un public féminin auquel il s’adresse tout en le tenant à distance. À cet égard, la figure de la lectrice dans l’œuvre est marquée par une alternance entre des représentations stéréotypées et une véritable lectrice authentique d’un matériau romanesque lui-même ambigu, comme si la compétence de lecture du personnage lui permettait de déchiffrer des textes plus complexes, plus mouvants, que le roman lui-même : les textes épistolaires. La lectrice est donc la femme qui sait bien lire, et à laquelle correspond un paradoxe bien connu de la vision balzacienne du roman : le genre ne serait pas encore sérieux, et ne s’adresserait qu’à un public féminin de mauvaises lectrices ; aux bonnes lectrices des œuvres non romanesques, permettant le recul critique et analytique. Et c’est pourtant paradoxalement dans un roman que Balzac représente des bonnes lectrices suspicieuses envers le contenu et la didactique romanesque.
Dans Modeste Mignon, les deux femmes qui entourent l’héroïne sont de mauvaises lectrices. La première, Mme Latournelle, se rend ridicule quand elle parle de littérature :
Vous n’avez pas pu juger de l’impression qu’a produite sur [Modeste] cette symphonie de bourreau (mot de Butscha qui prêtait de l’esprit à fonds perdu à sa bienfaitrice), appelée le Dernier jour d’un Condamné ; mais elle me paraissait folle avec ses admirations pour ce monsieur Hugo. […] La petite m’a parlé de Childe Harold, je n’ai pas voulu en avoir le démenti, j’ai eu la simplicité de me mettre à lire cela pour pouvoir en raisonner avec elle. Je ne sais pas s’il faut attribuer cet effet à la traduction ; mais le cœur me tournait, les yeux me papillotaient, je n’ai pas pu continuer. Il y a là des comparaisons qui hurlent ; des rochers qui s’évanouissent, des laves de la guerre !… (I, 495-496)
La charge portée contre la mère de Modeste n’est pas moins acerbe. Modeste elle-même est une lectrice fort sentimentale, et fort exaltée au contact de livres d’aventures et de romanesque :
Elle se supposait adorée à ses souhaits, en passant par toutes les phases sociales. Devenue l’héroïne d’un roman noir, elle aimait, soit le bourreau, soit quelque scélérat qui finissait sur l’échafaud, ou, comme sa sœur, un jeune élégant sans le sou qui n’avait de démêlés qu’avec la Sixième Chambre. Elle se supposait courtisane, et se moquait des hommes au milieu de fêtes continuelles, comme Ninon. Elle menait tour à tour la vie d’une aventurière, ou celle d’une actrice applaudie, épuisant les hasards de Gil Blas et les triomphes des Pasta, des Malibran, des Florines. (I, 506)
La lectrice balzacienne de lettres par excellence, c’est bien Renée de l’Estorade ; son portrait psychologique, longuement détaillé dans Mémoires de deux jeunes mariées, autorise le narrateur à dévoiler ses propres opinions sur ce qui fait une bonne lectrice. La racine de cette opinion est qu’il faut retirer aux femmes qui lisent toute tentation identificatrice et romanesque. Tel est le cas pour Renée, partagée entre son affection sororale pour Louise, et son rôle de femme qui interdit la lecture sentimentale :
Adieu donc, pour moi du moins, les romans et les situations bizarres dont nous nous faisions les héroïnes […].
Tu seras, ma chère Louise, la partie romanesque de mon existence. Aussi raconte-moi bien tes aventures, peins-moi les bals, les fêtes, dis-moi bien comment tu t’habilles, quelles fleurs couronnent tes beaux cheveux blonds, et les paroles des hommes et leurs façons. (I, 221-222)
Le rejet du romanesque des lettres adressées de Louise à Renée (tout ambigu, car il n’empêche pas Renée de demander régulièrement à Louise de lui en envoyer d’autres) se complète bientôt par une véritable critique littéraire en règle : « Oui, tes amours me semblent un songe ! Aussi ai-je de la peine à comprendre pourquoi tu les rends si romanesques. » (I, 299)
Comme le note Marie Baudry, le roman épistolaire à deux voix est l’un des moyens mis en scène par Balzac pour proposer une étude de l’alternative de la lecture : identificatrice et passionnée chez Louise, rigoureuse et sérieuse chez Renée8.
Dans ce dernier exemple, la femme se révèle donc être le meilleur critique, le meilleur lecteur de l’œuvre littéraire de tous les personnages balzaciens ; mais, par l’artifice de la narration, le narrateur tend à faire croire que cette compétence de lecture est à la fois antiromanesque, car le roman ne pourrait produire que de mauvaises lectrices éprises de sentimentalité et d’invraisemblable, et antiféminin, car dans les rapports de force qui les unissent aux hommes, Renée serait toujours dominante et non dominée, lucide et puissante, nettement supérieure à son mari. C’est donc toute une part de la féminité qui est redéfinie par son exemple.
Féminité et lecture : deux aspects incompatibles ?
La position du narrateur balzacien sur la lecture féminine est par conséquent beaucoup plus ambiguë qu’au premier regard on pourrait le penser. Car si la jeune femme dans le monde de la fiction est une bonne lectrice ; si d’une part elle ne s’arrête pas à la lecture romanesque a priori déqualifiée dans le roman balzacien, et si d’autre part elle est capable de deviner les attentes d’un public et de conseiller l’homme (généralement le mari ou l’amant) dans ses productions littéraires, elle est par d’autres aspects une lectrice problématique.
Si, dans Mémoires de deux jeunes mariées, Renée joue le rôle de la lectrice sérieuse et appliquée, ayant renoncé à l’exaltation dramatique du roman (les références du texte à Adolphe et Corinne, œuvres paradigmatiques d’une littérature de la passion amoureuse et de la trahison, sont nombreuses), on ne peut pas pour autant qualifier Louise de Chaulieu de mauvaise lectrice. Certes, l’issue de l’intrigue donne raison à Renée : « Mon cher docteur en corset a raison : le mariage ne saurait avoir pour base la passion, ni même l’amour », écrit Louise à Renée avant de mourir. (I, 401) Mais l’affection du lecteur irait davantage à Louise.
Le roman balzacien se met donc, de lui-même, dans une contradiction : il écrit à propos de femmes et met en scène des femmes tout en rejetant leurs compétences de lectrices ; les seules femmes capables de comprendre les livres seraient alors celles qui en rejetteraient le romanesque… et donc toute une dimension du roman lui-même.
L’approche théorique de la lecture dans le roman balzacien nous conduit ici à reprendre à notre compte la distinction faite par Vincent Jouve, elle-même empruntée à Michel Picard, entre lectant et lisant, ou, si l’on autorise la féminisation des concepts, la lectante et la lisante. Il semble en effet que, chez Balzac, le discours sur la lecture soit fortement polarisé autour de ces deux manières de représenter la lecture et son principal actant : la bonne lectrice est lectante du texte : elle considère « le personnage [comme] le support du jeu de prévisibilité qui fonde la lecture romanesque9 ». Renée sait que les amours de Louise, aussi exaltées soient-elles, derrière des « décorations fantastiques » qui sont les ornements de toute une littérature sentimentaliste, vont se terminer dans le mariage. Sa rationalité et la distance qu’elle observe par rapport au texte épistolaire de son amie, ne l’empêche pas d’y deviner une marche à suivre : « Mais, enfant, derrière tes décorations fantastiques s’élève un autel où se prépare un lien éternel. » (I, 299) À l’inverse, la mauvaise lectrice est lisante : à l’instar de Modeste obsédée par les héros de la littérature sentimentale anglaise, « le sujet voit sa faculté de distanciation anesthésiée et […] l’illusion référentielle fonctionne à plein10 ». Ces deux modèles de lectrice sont également deux modèles de narrataire féminin : la mise en abyme de la femme qui lit retrouve ici sa pleine fonction pédagogique de critique sociale.
Du discours au narrataire féminin
Parce qu’il ou elle aurait « la main blanche », le narrataire du Père Goriot a souvent été caractérisé comme un représentant du genre féminin, la blancheur connotant l’innocence et l’oisiveté d’un destinataire de salon. Or l’identité du narrataire balzacien et sa fonction posent problème dans les textes de La Comédie humaine, et d’avantage peut-être dans des romans en partie ou en totalité épistolaires, où la question de la double énonciation se pose avec une grande acuité.
Les études de narratologie balzacienne ont bien montré que la jeune lectrice était un narrataire négatif dans la pensée de Balzac : certes il s’agit d’une des figures potentielles du destinataire des textes, mais c’est souvent une figure moquée, voire déqualifiée sur le long terme. Franc Schuerewegen note ainsi :
Que l’appel au narrataire s’avère souvent plus complexe qu’on ne le pense, qu’il y ait beaucoup d’ambiguïté dans ce geste qui tente d’inscrire le lecteur dans le texte, c’est ce que vient attester, dans le Père Goriot, l’adresse à la lectrice « à la main blanche », passage célèbre, s’il en est, exemple canonique, canonisé, dans les études de narratologie. […] Le Père Goriot se transforme graduellement en roman d’apprentissage (modèle générique auquel on aura à revenir dans le chapitre suivant) : transformation qui nécessite, entre autres choses, l’émergence d’un nouveau type de lecteur, le lecteur informé, concerné, qui n’a plus rien à voir avec ce qui est représenté au début du texte […]. Il y a d’abord et surtout, dans l’interpellation balzacienne, un geste d’exclusion, de discrimination11.
Dans les textes épistolaires que sont Mémoires de deux jeunes mariées et le premier tiers, environ, de Modeste Mignon, la question du narrataire est d’autant plus délicate qu’elle est à dissocier de celle du destinataire des lettres12. Balzac interpelle une narrataire à travers un dispositif dans lequel une jeune lectrice interpelle une autre lectrice ou un lecteur. Les marques caractéristiques de l’interlocution épistolaire ne seront donc pas les mêmes que les marques de l’inscription du narrataire dans le texte.
Dès les premières pages de Mémoires de deux jeunes mariées, à côté de Renée de Maucombe à qui Louise de Chaulieu destine sa lettre, le narrateur construit une figure de narrataire induit. Les marques de cette inscription sont de plusieurs ordres :
- le pronom « on » reçoit, derrière sa dimension indéterminée constitutive, une orientation vers un lecteur extérieur ; il est souvent utilisé pour permettre au narrateur de s’adresser à son narrataire, en palimpseste sous le texte d’une émettrice fictive s’adressant à son ami (principalement à l’aide des pronoms traditionnels de l’interlocution, « tu » et « vous13 »). Ainsi c’est au narrataire que s’adressent certaines phrases du texte présentant ce pronom : « On parle toujours du premier amour, il y en a donc un second ? », (I, 195) qui dissimule généralement le genre ;
- le présent de vérité générale est mobilisé pour évoquer, sur le modèle d’une exophore mémorielle, un univers de croyances et de connaissances commun à toutes les lectrices, y compris celles qui sont en dehors du schéma épistolaire : « Pour être embrassée à nos âges, la vie religieuse veut une excessive simplicité que nous n’avons pas » (I, 196) ; « rien n’attise un sentiment autant que le vent glacé de la persécution » (I, 201), « comme toutes les filles à caractère extrême, elle but quelques gorgées de trop à la coupe du Désenchantement » (I, 609) ;
- les démonstratifs déictiques à valeur non pas de monstration, mais de généralisation, relevant eux aussi d’une exophore mémorielle, sont aussi employés pour extraire d’un constat de Louise une vérité générale qui peut correspondre à l’expérience intime de la narrataire : « Cette vie monotone où chaque heure amène un devoir, une prière, un travail si exactement les mêmes, qu’en tous lieux on peut dire ce que fait une carmélite à telle ou telle heure du jour ou de la nuit ; cette horrible existence où il est indifférent que les choses qui nous entourent soient ou ne soient pas » (I, 196) ; « Ces femmes du temps passé emportent avec elles certains secrets qui peignent leur époque » (I, 201) ;
- les questions rhétoriques indiquent le plus explicitement peut-être la présence d’un autre destinataire des lettres que le personnage de la lectrice à l’intérieur du roman ; elles sont d’un emploi très libre et fréquent dans les parties épistolaires des récits balzaciens, et s’adressent sans doute à des lectrices extérieures qu’il s’agit d’interroger : « Qui peut se sacrifier à des inconnus ou à des idées ? » (I, 197) ;
- les exclamations, interjections et marques de la fonction phatique du langage s’adressent, elles aussi, à la fois à une destinataire de lettres, et à l’ensemble des personnages qui participent de cette sensibilité exprimée ; l’expressivité des lettres devient un moyen pour le narrateur d’interroger la sensibilité des lectrices : « Combien la vie du cœur nous est nécessaire ! » (I, 196) ; « Il est si doux de savoir où et comment vit l’être qui nous est cher ! » (I, 203) ;
- le recours explicite à une catégorie de lectrice permet de s’appuyer sur les sentiments féminins pour emporter l’adhésion de la narrataire : « Maintenant, toutes les jeunes filles, romanesques ou non, peuvent imaginer dans quelle impatience vécut Modeste pendant quelques jours ! » (I, 514) ; « Quelle fille à l’âme ardente ne se serait pas brisée dans une chute pareille ? » (I, 608)
Dans Modeste Mignon, qui entrecoupe les lettres de Modeste au pseudo Canalis par des commentaires du narrateur, les marques de la narrataire féminine sont nettement plus explicites. Dans les commentaires, les apostrophes directes et indirectes se multiplient : « toutes les jeunes filles, romanesques ou non, peuvent imaginer […]. » Un formidable effet de réalisme est renforcé par ces commentaires du narrateur : les jeunes femmes ressentent comme Modeste ressent, c’est donc bien que Modeste est plus qu’un personnage, elle deviendrait le type même de la jeune lectrice amoureuse ! À l’intérieur des lettres que Modeste lit (celles donc de La Brière signant Canalis), on retrouve la même inscription en double jeu de la narrataire féminine, auditrice des lettres de Mémoires de deux jeunes mariées : comme il s’agit d’un homme qui écrit, cependant, les principes exposés sont nettement plus rétrogrades et stricts que ceux de Louise écrivant à Renée :
- les tournures au présent de vérité générale et l’usage des proverbes et maximes sont renforcés, souvent ils concernent des principes de relation entre hommes et femmes, et s’appuient sur la connivence et les croyances de la lectrice contemporaine : « La plus belle palme d’une jeune fille est la fleur d’une vie sainte, pure, irréprochable » (I, 522) ; « L’homme ordinaire tranche le nœud gordien que constitue un mariage d’argent avec l’épée de la tyrannie. L’homme fort pardonne. Le poète se lamente. » (I, 531), « Quand une femme, courtisane ou jeune fille, a laissé échapper cette phrase : “Tu es beau !”, fût-ce un mensonge, si un homme ouvre son crâne épais au subtil poison de ce mot, il est attaché par des liens éternels à cette menteuse charmante, à cette femme vraie ou abusée […]. » (I, 585) ;
- la dimension péremptoire et catégorique des adresses à la narrataire est accentuée par l’usage des phrases nominales, répandues chez La Brière : « Autant d’auteurs, autant de caractères. » (I, 523) ; et par l’emploi de phrases de liaison qui assurent le déroulé d’un discours pédagogique : « Allons plus loin !… » (I, 523) ; « Hélas ! triste conclusion… » (I, 523)
Si l’on regarde à présent le contenu des adresses du narrateur à son ou sa narrataire, on peut confirmer l’identité féminine de celle-ci en regroupant les apostrophes sous un certain nombre de thèmes et/ou de stéréotypes qui marquent la vision de la femme au début du xixe siècle. C’est presque un portrait-robot de la lectrice que Balzac dresse dans ces deux romans, s’appuyant sur un parcours de vie canonique et sur une représentation de l’intériorité qu’il espère englober le plus grand nombre de lectrices réelles.
La narrataire balzacienne est donc née dans une famille bourgeoise ou aristocrate. Élevée dans la nostalgie de ses ancêtres, bourgeois enrichis par la Révolution (Modeste) ou aristocrates de la haute société du xviiie siècle (Louise), elle passe sa jeunesse au couvent (Louise) ou au sein d’une famille qui lui impose une forme de coercition (Modeste) : accorder une grande place à la sentimentalité et à la recherche d’un amour qui ne soit pas un sacrifice est son dilemme principal. Stéréotypie oblige, la jeune lectrice est une pianiste accomplie (preuve de son éducation bourgeoise) : « [Modeste] se mit à son piano, ce confident de tant de jeunes filles, qui lui disent leurs colères, leurs désirs, en les exprimant par les nuances de leur jeu. » (I, 560)
Le portrait redouble donc les stéréotypes et les représentations dépréciatives : la jeune narrataire est une ingénue bourgeoise, rarement éduquée pour comprendre le texte littéraire ; elle est l’un des « narrataires négatifs » que Balzac se plait à mobiliser dans son œuvre, pour provoquer la lectrice. Charles Mignon se moque ainsi de sa fille : « Vous voilà bien, vous autres jeunes filles avec vos sentiments absolus et votre ignorance de la vie ! » (I, 607)
Le/la narrataire comme fusion des lectures masculines et féminines
Ces deux romans assez tardifs dans La Comédie humaine marquent donc l’aboutissement, commencé avec la Physiologie du mariage, du travail d’étude et de critique des mœurs et des rapports entre les deux genres. Les récits achèvent de déqualifier une certaine production romanesque et un certain archétype de lectrice naïve ou rêveuse, coupable de lire.
Mais le projet balzacien est également de construire un autre portrait de la narrataire en lectrice idéale, concernée au premier degré par les dilemmes et les actions des personnages, mais pour ainsi dire interpellée en palimpseste, en dessous du texte épistolaire et de son dispositif de conversation classique. Par cette construction littéraire énonciative, l’auteur parvient à donner, sans le dogmatisme ou l’arbitraire de l’intervention directe, son point de vue et ses recommandations sur l’éducation littéraire des jeunes filles, et sur le rapport qu’elles doivent entretenir avec la littérature et, en premier lieu, le roman.
Deux pistes de lecture se dessinent alors : la bonne lecture est celle qui neutralise le genre. La femme devient une lectrice compétente en parvenant à un stade de la lecture qui autorise à la fois l’intuition féminine et la logique masculine prétendues : tout comme le texte neutralise son genre14, le narrataire le fait également. L’autre piste de lecture qui se met en place est celle où l’acte de lecture devient intrinsèquement un acte de communication bi-genré : la narrataire est celle qui prête à l’auteur des mots féminins pour décrire des réalités masculines, tout comme il emprunte des mots masculins pour décrire des réalités féminines.
Le narrateur balzacien recourt volontiers à des provocations, à des apostrophes ironiques, pour modeler la lecture de celui ou celle qui le lit. Cet aspect bien connu de la geste narratoriale balzacienne, qui renoue avec un des rôles du narrateur dans le roman depuis Rabelais, nous permet cependant de voir, derrière la condamnation de certaines pratiques de lecture, l’émergence d’une leçon sur la bonne manière de lire. Dans Modeste Mignon, une fois la reproduction des lettres de La Brière et de Modeste terminée, le narrateur reprend ainsi le fil du récit :
Ces lettres ont paru très originales aux personnes à qui la Comédie Humaine les doit ; mais leur admiration pour ce duel entre deux esprits croisant la plume, tandis que le plus sévère incognito met un masque sur les visages, pourrait ne pas être partagée. Sur cent spectateurs quatre-vingts peut-être se lasseraient de cet assaut. Le respect dû, dans tout pays de gouvernement constitutionnel, à la majorité, ne fût-elle que pressentie, a conseillé de supprimer onze autres lettres échangées entre Ernest et Modeste, pendant le mois de septembre ; si quelque flatteuse majorité les réclame, espérons qu’elle donnera les moyens de les rétablir quelque jour ici. (I, 553)
Un procédé similaire est employé, plus explicitement encore, dans la préface de Mémoires de deux jeunes mariées, lieu par excellence du discours au narrataire :
Chacune de ces lettres se composait de fragments. Si quelques-unes, faciles d’ailleurs à reconnaître, sont sorties d’un seul jet et comme une flamme, de cœurs oppressés ou heureux, les autres ont été écrites à diverses reprises. Ces dernières étaient alors ou le résultat des observations faites pendant quelques jours, ou l’histoire d’une semaine. Le livre, cette chose plus ou moins littéraire qui doit passer sous les yeux du public, a exigé la fusion de ces éléments. Peut-être fut-ce un tort. La critique ou la louange, d’indulgentes amitiés, des inimitiés tout aussi fidèles le dirent à celui qui mit en ordre cette succession curieuse, à lui léguée par une main amie et sans aucune circonstance romanesque. (I, 193)
Dans les deux textes, le narrataire est pris à partie selon plusieurs caractéristiques : il est celui à qui l’on avoue le retrait de certaines parties de texte, pour satisfaire un besoin frivole d’intérêt – le lecteur se lasserait de lire des correspondances entières. Plus encore, le narrataire apprend que les lettres sont un don fait au narrateur par une « main amie » – que le lecteur ne cherche pas, pour satisfaire une curiosité malvenue, à démasquer l’identité des vrais épistoliers ! Enfin, le lecteur est présenté comme celui qui obéit aux caprices de la majorité, que Balzac déteste, et qui impose son désir à l’auteur : si les lecteurs veulent d’autres lettres, ils n’ont qu’à écrire !
Derrière ce portrait à charge, teinté d’ironie, faussement respectueux et reprenant à son compte les faux-semblants du genre épistolaire, on peut ainsi dresser les compétences du bon narrataire, celui qui est exclu de cette caricature de lecteur15. Ce qui est peut-être le plus important, c’est le recours quasi constant, dans les deux romans, aux tournures unipersonnelles (« personnes », « spectateurs », « public »), aux métonymies qui neutralisent le genre (« le respect » pour ceux ou celles à qui il s’adresse, encore une « main amie », de femme ou d’homme ?), aux constructions passives (« se composait de »). Le genre du narrataire idéal semble, à dessein, masqué derrière ses qualités16.
Les deux romans, à leur manière, vont incorporer dans l’intrigue et dans leurs personnages cette compétence hermaphrodite du narrataire : Modeste Mignon le précise avec beaucoup de finesse lors du portrait de La Brière :
Joignez à ces qualités féminines un parler doux comme la physionomie, doux comme des yeux bleus à paupières turques, et vous concevrez très bien que le ministre eût surnommé son jeune secrétaire particulier, mademoiselle de La Brière. (I, 575)
Quel est le genre du narrataire convoqué ici par les impératifs et le pronom « vous » ? Ne peut-on pas faire l’hypothèse que c’est à un narrataire des deux genres qu’on s’adresse, lorsque justement on dresse un portrait d’homme féminin, dont les attributs masculins sont facilement déchiffrés… par les femmes ? Notons d’ailleurs que Balzac, qui répugne à utiliser le mot « lecteur » dans ses adresses au ou à la narrataire17, s’appuie volontiers sur des substantifs neutres, dans le paradigme des « gens ». (I, 576)
Le roman balzacien : un roman des deux gens, roman des deux genres ? À coup sûr, un roman des deux paroles : à côté de la tentative du narrateur de dégenrer le narrataire en neutralisant les adresses qu’il lui fait, on note enfin une tendance tout à fait caractéristique de la narration balzacienne à bigenrer son lectorat. Les femmes et les hommes sont invités à lire de concert le texte, et les mots des femmes sont repris par un narrateur masculin, dans une entreprise à la fois d’appropriation peut-être violente, mais aussi, sur l’autre versant de la pièce, dans une tentative collective d’avènement de la femme, personne et parole, dans l’espace public et littéraire :
La Brière se retourna pour examiner la grande et fière notaresse, le petit notaire et le paquet (expression consacrée entre femmes), sous la forme duquel Modeste s’était mise. (I, 577)
La lecture se présente alors comme un geste de reconnaissance de la part de féminité de tout phénomène de langage.