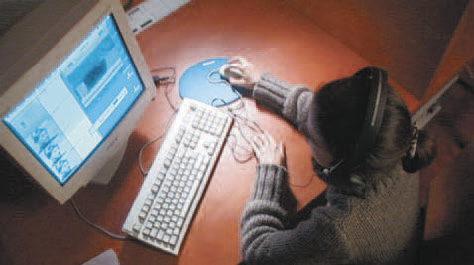Constat alarmant en 1999 : 80 % des archives de l’INA sont menacées de disparition d’ici 20 ans
Objectif ambitieux en 2004 : 100 % des archives de l’INA seront sauvegardées en 2015
Menacées par l’usure du temps, les archives de l’INA font l’objet d’un ambitieux plan de sauvegarde depuis 2001. Depuis 2000 on sait que la durée de vie des supports vidéo est estimée aujourd’hui à cinq ans et celle des supports film et radio à dix ans. De plus, à la dégradation physicochimique des supports analogiques, s’ajoute également l’obsolescence des équipements de lecture. URGENCE !
Pour ses lecteurs, Arabesques a contacté Jean-Marc Bordes, directeur général délégué de l’INA chargé du pôle patrimoine et de la direction de la recherche et de l’expérimentation. Il a bien voulu revenir sur le projet de migration des données de l’analogique vers le numérique appelé Plan de sauvegarde et de numérisation - PSN.
INA – Salle de consultation à la BNF
Copyright INA avril 2002 – Photo : J-M. Briard. http://www.ina.fr/presse/phototheque/photos/ina/BnF_consultation03.jpg
Avant tout, Jean-Marc Bordes insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de restauration mais bien de sauvetage d’archives. « On restaure un programme lorsqu’on souhaite améliorer la qualité de l’enregistrement (suppression des rayures d’un film, des parasites d’un enregistrement sonore, reconstitution d’images ou de sons manquants) en vue d’une édition sonore ou vidéo, ou de la rediffusion d’une fiction. C’est une opération coûteuse, car très minutieuse, qui est engagée dans la perspective d’une exploitation commerciale. En revanche, la sauvegarde est une opération systématique d’une nature quasi industrielle » L’objectif est clair, toutes les archives menacées seront sauvegardées, les documents en danger immédiat seront traités prioritairement.
L’échéancier est annoncé.
Fin 2004, 22 % du fonds menacé est sauvé soit 181 000 heures d’archives. Fin 2009, 52 % du fonds menacé sera sauvé soit 433 000 heures d’archives. Fin 2015, 100 % du fonds menacé sera sauvé soit 835 000 heures d’archives. Au cours de cette numérisation, les archives menacées sont systématiquement visionnées ce qui permet, à terme, le contrôle des données de catalogage et de description des contenus, leur enrichissement par les documentalistes de l’INA et des découvertes de documents rares ou inédits.
Le travail entrepris alimente les bases de données de l’INA pour la recherche documentaire. Plus de cinq millions de notices documentaires sont aujourd’hui disponibles qui décrivent les fonds, nationaux et régionaux, propriété de l’INA.
L’INA en bref
Statut
L’Institut national de l’audiovisuel est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), créé par la réforme de l’audiovisuel menée en 1974 et mis en place le 6 janvier 1975.
Missions
- La conservation du patrimoine audiovisuel national.
- L’exploitation et la mise à disposition de ce patrimoine.
- L’accompagnement des évolutions du secteur audiovisuel à travers ses activités de recherche, de production et de formation.
Budget et personnel
103 M€ et 945 personnes.
Dépôt légal
Loi du 20 juin 1992.
L’INA a pour mission le dépôt légal des programmes radiodiffusés et télédiffusés.
Collections
2 500 000 heures d’archives composées des émissions des radios nationales et privées, chaînes de télévision publiques et privées, hertziennes, câblées et satellites.
INA : 1re banque mondiale d’images numérisées.
Inathèque
1995 : création de l’Inathèque de France.
1998 : l’inathèque ouvre son centre de consultation à la BNF.
En fait, le Plan de sauvegarde et de numérisation des archives a pour effet d’accélérer et de développer l’accessibilité des archives grâce au numérique. Fin 2005 ce sont déjà 250 000 heures de vidéo qui sont disponibles en consultation et visionnage pour les professionnels (producteurs, chaînes de TV, etc.) sur Internet à travers le service www.inamedia.com.
De plus, avec l’attribution à l’INA du dépôt légal des programmes radiodiffusés et télédiffusés, un champ nouveau de diffusion a été ouvert en direction des publics scientifiques, chercheurs et universitaires.
En 1998, l’Inathèque a ouvert un centre de consultation à la Bibliothèque nationale de France et doit ouvrir six nouvelles implantations équivalentes en région afin de rendre la mémoire accessible pour le grand public d’ici 2009.
La question de la pérennité des nouveaux produits créés par la numérisation s’est bien évidemment posée. Jean-Marc Bordes précise que le format Mpeg s’est imposé, Mpeg1 pour le visionnage, Mpeg2 pour la qualité broadcast ; les outils utilisés sont des encodeurs Mpeg alimentés par cinq robots de la marque FlexiCard.
On le voit, l’INA historiquement destinée aux diffuseurs et producteurs professionnels de l’audiovisuel a considérablement valorisé ses fonds et les rend progressivement accessibles au grand public. La numérisation, la réindexation des documents ont créé de la valeur ajoutée qui permet à l’INA de passer d’un statut de grand musée de la mémoire à celui d’un lieu de référence vivant et riche.