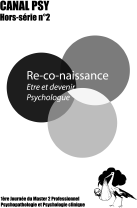Je me suis beaucoup tu et j’ai beaucoup écouté. Ce que j’ai à dire est pour partie en articulation avec ce que j’ai entendu et aussi pour partie en articulation avec ce que j’ai pensé. Premier point qui m’a frappé, une des difficultés majeures d’ailleurs : notre pratique a un versant clinique et un autre politique, qu’il me paraît important de différencier. Or, j’ai le sentiment qu’il y a toujours la menace de la contamination d’un niveau par un autre. C’est-à-dire la crainte de la contamination de la clinique par des positions qui seraient politiques, on a vu ce que ça pouvait donner dans la mouvance « post-soixante-huit ». D’autre part, la menace d’une contamination de nos positions politiques par des positions cliniques : on interpréterait volontiers des résistances inconscientes de la population, ce qui n’est pas très efficace.
Au début de cette journée, Albert Ciccone avait commencé par un cri d’alarme qui me semble tout à fait salutaire. J’avais envie pour ma part d’essayer de voir ce que l’on pourrait faire dans l’état actuel des choses. Je n’en ferai sûrement pas le tour, mais j’évoquerai un certain nombre d’actions à entreprendre en différenciant ce qui concerne précisément le niveau politique de ce qui concerne le niveau proprement clinique ; ce que l’on a appelé très joliment la « résistance du quotidien »1.
Il faut qu’il y ait une action au niveau social et cette action ne peut être menée de façon isolée. Il existe à l’heure actuelle une série de mécontentements qui affecte les professionnels de la santé, de la recherche, etc., mécontentements qui se sont traduits par une multitude d’appels. Et l’idée qui a émergé au sein du Séminaire Inter Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche de la Psychanalyse et de la Psychopathologie (SIUEERPP) qui rassemble tous les enseignants de psychologie clinique et psychopathologique d’orientation psychanalytique, est que tous ces appels soient rassemblés. « L’appel des appels » circule actuellement, pointant ainsi qu’il y a une direction politique problématique et une opposition à cette direction politique. C’est un premier niveau d’action.
Deuxième point auquel il faut réfléchir sur un plan collectif : Alain Ferrant évoquait tout à l’heure 200 syndicats de psychologues, je crois que l’on est plus proche de 350… peu importe le nombre, le fait est que les psychologues cliniciens ont une multitude de syndicats, c’est une situation tout à fait exceptionnelle sur laquelle il y a lieu de réfléchir… En écoutant ces réflexions sur le groupe2, je me disais que, peut-être, l’appétence du psychologue à travailler sur les groupes est directement proportionnelle à son isolement comme professionnel souvent unique de son espèce, sur un terrain donné. Vous savez qu’une série d’actions a donc été entreprise. En juin dernier une première action s’appelait « Sauvons la clinique », à partir d’une pétition, elle a donné ensuite lieu à un congrès.
Depuis, dans le cadre du SIUEERPP, nous préparons les États généraux de la psychologie clinique avec l’optique que l’ensemble des cliniciens de Lyon, et même de la région Rhône-Alpes, se rencontrent, se réunissent, évoquent les différents problèmes qui peuvent se poser à eux : la gratification des stages, les dispositifs d’isolement des symptômes et leur traitement expéditif sur les terrains de soin, les inquiétudes concernant l’état et l’évolution de notre système de santé, suffisamment alarmant dans cette conjoncture pour mobiliser les choses.
Je suis extrêmement sensible à cette démarche qui consisterait à dire qu’il ne s’agirait pas de créer un syndicat « de plus » mais de faire une association, un « réseau des psychologues », hors syndicat et mis au service de tous. Sur ce site-là, qui existe avec maintenant 7 000 adhérents, apparaissent des demandes d’emploi, les grands textes qui concernent la profession, toutes les informations vous permettant d’être tenus au courant de ce qui se passe en France… Il se trouve qu’à l’heure actuelle avec les débats sur les arrêtés d’application du décret sur le titre de psychothérapeute, les représentants du réseau ont été reçus de manière préférentielle à des tas d’autres organisations de psychologues qui étaient nettement moins représentatives.
Alain le disait tout à l’heure et je le pense aussi : on ne peut pas s’en tenir à une seule position qui est une position de lutte sociale. Il faut que nous ayons un certain travail de regroupement à organiser, un travail qui pourrait être facilité avec des initiatives comme « Sauvons la clinique ». J’avais d’ailleurs remarqué que c’est bien joli de vouloir « sauver la clinique » mais peut-être faudrait-il commencer par la définir. Je crois qu’en premier lieu, un travail est à faire qui est de trouver une définition de la clinique qui soit à la fois suffisamment unificatrice, pour que les quelque 45 000 psychologues s’y retrouvent ainsi que les 13 000 psychiatres et les 5 000 psychothérapeutes (parmi lesquels au moins la moitié de psychologues). De cette manière, nous avons potentiellement un poids considérable pour autant que les psychologues s’inter-reconnaissent entre eux comme tels. Cette inter-reconnaissance, ce serait quelque chose dont on peut témoigner par l’appartenance à un réseau. Un travail à faire pour définir ce qu’est la clinique donc, non seulement dans sa démarche, mais aussi au niveau de ce que sont les dispositifs des cliniciens. Cette définition devrait être suffisamment unificatrice pour que tout le monde s’y retrouve et en même temps autoriser suffisamment de diversité, là aussi, pour que différents types de pratiques qui se sont développées sur différents lieux puissent s’y retrouver. Là encore, on oscille. Dans la définition de la clinique, un des composants qui a été avancé avec une certaine pertinence a été la notion d’une méthode implicite à tous les dispositifs cliniques. Cette méthode est l’associativité que l’on va retrouver aussi bien dans les tests projectifs que dans les groupes et les entretiens individuels. L’idée mérite d’être assise et ceci pourquoi pas aussi sur des bases biologiques. Dans le débat social, ces arguments-là ont du poids. Or, il faut penser aussi une stratégie à ce niveau. Nous organisons le 27 novembre 2009 à Lyon un colloque international sur l’associativité en psychanalyse3 et, d’une manière générale, dans la clinique et les neurosciences. Et la bonne nouvelle c’est que, vraisemblablement, le cerveau fonctionne de manière associative. Ainsi, si Freud a eu une telle pertinence, c’est parce qu’il avait mis le doigt sur quelque chose qui ne concernait pas seulement un épiphénomène de surface, mais véritablement un mode de fonctionnement de fond de l’être humain. Peut-être bien que la biologie, le vivant, fonctionne de manière associative, avec des couples, des copulations et tout ce que vous pouvez imaginer qui va avec…
À l’heure actuelle, et cela n’a pas été suffisamment dit, mais ce serait sous-jacent à ce qui se passe dans les institutions en particulier lorsque les psychologues sont menacés, la question se pose de savoir « À quoi ils servent ? » Et je dois dire que là, les petites hordes de cognitivistes qui se sont emparées d’un certain nombre de terrains ont eu beau jeu de dire : « Nous, on a des évaluations, regardez, nous sommes sérieux, scientifiques ». Car dès lors, les gens se sont tournés vers les cliniciens et ont dit : « Et vous, qu’avez-vous à dire ? » Et les cliniciens ont répondu : « Nous, on est contre l’évaluation ». Le problème c’est que comme tout le monde n’est pas contre l’évaluation parmi les gens qui nous emploient, nous gouvernent, nous nous sommes immanquablement retrouvés en position de relative faiblesse. Or si cela a un sens d’être psychologue clinicien, si cela a un sens de monter ces groupes, ces psychodrames, si cela a un sens de se bagarrer, c’est bien parce que cela marche ! Ce n’est pas parce que je suis clinicien que je fais un groupe à médiation. Parce que si c’était uniquement ça, ce serait effectivement uniquement pour notre jouissance personnelle et il ne faudrait pas se plaindre de ne pas être mieux payé. Non, il y a une efficacité certaine de nos dispositifs soignants.
L’autre bonne nouvelle, c’est qu’un certain nombre de chercheurs, notamment américains, se sont mis à reprendre la question des évaluations. En particulier, ils ont repris ces fameuses évaluations sur lesquelles le Livre noir de la psychanalyse4 s’était appuyé pour dire qu’il n’y a que les thérapies cognitivo-comportementales qui sont efficaces. Ces chercheurs se sont ainsi employés à repasser sur les résultats chiffrés et ont ré-analysé l’ensemble des données. Et là, oh surprise, ils ont constaté qu’il y avait des biais tout à fait considérables dans les premières évaluations. Ces biais provenaient du fait que ces évaluations surgissaient de commandes d’assurances qui avaient comme projet de rembourser les soins. Elles ne se posaient donc pas tant la question de l’efficacité thérapeutique que la question de l’efficacité à court terme puisque c’est ce qui était remboursable. Alors, lorsque l’on ré-analyse ces chiffres, avec des travaux qui sont tout à fait considérables (je tiens à votre disposition les versions anglaises de deux articles qui sont sortis dans le Journal of American Medical Association en septembre 2008 que l’on va prochainement faire traduire bientôt dans une revue de psychanalyse5), les résultats de ces études sont sans ambiguïté : dès que des troubles sont installés depuis un an au moins, dès qu’il y a une comorbidité importante, c’est-à-dire que les individus présentent des symptomatologies un peu complexes et plurielles, ce qui est de loin la situation la plus fréquente, le seul système de soin qui « marche » est celui donné par les psychothérapies d’orientation psychanalytique. Et celles-ci marchent mieux quand il n’y a pas de médicament plutôt que lorsqu’il y en a. Non seulement, il faut le faire savoir, mais il faut aussi que l’on s’appuie sur cet exemple-là pour que nous acceptions d’évaluer nos pratiques. Il nous faut établir nos propres critères d’évaluation et nous les avons potentiellement, ils sont déjà disponibles. Par contre, il faut les extraire, les travailler, les faire connaître, il faut voir ce que ça donne dans une application avec un groupe, dans une thérapie au long cours et ceci, dans tous les dispositifs de soin dans lesquels nous sommes amenés à pratiquer. Nous ne pouvons faire l’économie de ce travail-là, non seulement en direction des autres, mais aussi pour nous.
Cela fait des années que j’ai le sentiment qu’il faut développer dans les doctorats de psychologie des évaluations des dispositifs de soin. Il y a quelques années on avait essayé avec l’ancien directeur du Vinatier de monter ces dispositifs de recherche.
Je passe à l’idée de « résistance du quotidien »6. J’aime beaucoup le terme, notamment parce que si le psychologue est du côté de la résistance, peut-être que l’on aura un petit peu moins tendance à interpréter les résistances des autres et que l’on sera amené à penser que la résistance du quotidien, ce serait aussi notre propre résistance. La polysémie du terme l’autorise. Première des choses qui paraissent importantes parce qu’elle est extrêmement dommageable pour notre santé psychique : il y a lieu de rompre l’isolement dans lequel sont de nombreux psychologues sur leur lieu de soin. Quand il n’y a qu’un seul psychologue sur un lieu de soin, ce n’est pas très facile de rompre l’isolement s’il n’y avait pas de regroupements entre psychologues, les groupes de supervision payants, les groupes d’intervision non payés, de nombreuses possibilités qui sont à organiser, à penser. Je considère que la psychologie n’est pas une pratique solitaire. C’est une pratique qui comporte un temps solitaire, mais qui a aussi des temps collectifs, des temps groupaux et des temps universitaires. Je crois que nos équipes de praticiens-chercheurs à l’université pourraient avoir une fonction à ce niveau-là pour penser, aider à penser, l’émergence des nouvelles pratiques, leurs paramètres principaux, leurs caractéristiques : Nous essayons de le faire. Nous allons renouveler avec Albert Ciccone et Alain Ferrant, les samedis après-midi du Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique de l’Université Lumière Lyon 2 (CRPPC) centrés sur les nouvelles pratiques, cette émergence et les efforts pour les penser. Il y a des va-et-vient à faire ici. Stéphanie Ranéa disait tout à l’heure que nous avons de la chance à Lyon d’avoir pas mal de contacts entre les universitaires et les praticiens ; c’est vrai que c’est une situation très particulière. À Paris par exemple, il est très difficile de le faire, car les praticiens sont référés aux cinq différentes universités qui font de la psychologie. Dans le Sud, d’autres problèmes se posent. En tout cas, nous avons cette possibilité-là et il faut absolument l’utiliser. Je crois que si les enseignements universitaires sont coupés de la pratique, un moment va venir où ils vont se dessécher. Je pense aussi que si les pratiques sont coupées de l’université, quelque chose risque fort de s’y scléroser.
Cela fait quelques années que je travaille dans cette université et je peux vous dire que j’ai vu évoluer les formations, les psychologues et… leur look. Il y a une certaine époque, celle des post-soixante-huitards, on ne pouvait pas être psychologue si on n’avait pas une barbe, une pipe et l’air assez profondément déprimé, du côté des femmes cela ne valait guère mieux. On n’est plus du tout là-dedans maintenant dans notre manière de nous présenter et de nous reconnaître comme psychologue. Évelyne Grange-Ségéral l’a évoqué tout à l’heure : la problématique du jeu, la capacité de jouer sont tout à fait importantes concernant notre identité professionnelle. Donc il me semble que c’est une première direction que d’affirmer haut et fort que nos pratiques, même si elles s’exercent de manière individuelle, sont sous-tendues par des groupes, des références collectives et par un travail d’élaboration de la profession.
Il ne faut pas oublier qu’il y a une hostilité ambiante à l’égard des psychologues dans les institutions. Mais cette hostilité-là, qui est vraiment de constat courant, n’est pas simplement liée au fait qu’on dérange ou qu’on est comme un « cheveu sur la soupe ». Cette dimension existe, mais elle est aussi liée à quelque chose qui est beaucoup plus important : Il n’y a pas de psychologue s’il n’y a pas de manque, s’il n’y a pas de sentiment d’une blessure, de quelque chose qui est à traiter d’une manière ou d’une autre. Alors quand on travaille sur ces dimensions-là, on les rappelle et ce n’est pas tout le temps agréable. Ainsi, Il y a de quoi interpréter l’hostilité du côté du rapport au manque et à la zone blessée.
Mais je crois que cela ne suffit pas et qu’il y a autre chose, pour des raisons qui seraient liées aux défenses des psychologues entre autres. En effet, il y a un certain nombre de moments où les psychologues sont vécus, et pas tout le temps de manière projective, comme ceux qui vont critiquer les pratiques des autres. Corentin Gidrol7 disait bien ce matin « Je suis arrivé, j’étais perçu comme le sauveur ! ». Quelle est cette position-là ? Qui serions-nous pour penser que l’on pourrait débarquer sur un lieu de soin, rencontrer des gens qui se sont frottés à des difficultés depuis une vingtaine d’années et dire : « Là, dans votre institution, il y a un dysfonctionnement et là dans votre pratique, il doit y avoir un aspect pervers. Êtes-vous sûrs d’avoir bien nettoyé votre transgénérationnel ? ».
À la sortie comment voulez-vous que les gens le prennent bien ? C’est-à-dire qu’il y a quelque chose d’extrêmement dommageable qui est précisément la confusion entre une position d’analyse et une position surmoïque. C’est comme si on oubliait que l’analyse se fait à partir d’une position de neutralité bienveillante. Du coup, elle virait à une forme sophistiquée du Surmoi. Sur ce point-là, je pense qu’une réflexion serait à engager aussi du côté de la formation et également du côté de nos interventions. Sachant qu’on travaille sur des zones fragiles, blessées, douloureuses, il faut que soient prises des précautions tout à fait particulières quand on est sur ces zones-là, chez les autres et aussi chez nous.
Troisième point qui me paraît être tout à fait important et qui a surgi implicitement dans la discussion. C’est l’idée qu’il y aurait par exemple une interprétation pour une séquence clinique et une seule. Quand je suis face à un travail d’étudiant et que j’ai le sentiment que la conviction de l’étudiant est qu’il a la vérité, la seule interprétation valable, je considère que nous ne sommes plus alors dans la psychologie clinique, mais que nous avons viré dans l’idéologie. La complexité de la psyché humaine, de la vie humaine, et du comportement des gens dans les institutions est telle que jamais un sujet, fut-il extrêmement bien formé à la psychologie, n’est détenteur de l’interprétation. Ce qui veut dire que dans notre contact avec les autres soignants, ce n’est pas simplement des résistances auxquelles nous sommes confrontés, c’est aussi d’autres manières de concevoir les choses. J’ai beaucoup aimé le processus de découverte de cette donnée-là chez Julie Pascal8. Partie d’une position surmoïque, on a pu voir son évolution vers une position qui consiste à se dire : « Mais peut-être que dans ce que disent les éducateurs, les infirmiers, les lacaniens, que dans toutes ces positions- là il y a quelque chose à entendre ». Alors, entendre pas nécessairement pour s’y rallier, mais en tout cas entendre qu’il y a une pluralité. Parce qu’en effet la réalité psychique et la réalité humaine sont à multiples facettes et, travailler ces facettes, ce n’est pas simplement déconstruire un clivage, c’est aussi expérimenter les différents aspects d’une situation, déjà commencer à jouer, ce qui fait peut-être tout autant partie du travail de symbolisation. Le travail de symbolisation dans les institutions de soin, ce n’est pas un travail individuel, c’est un travail collectif.
Dernier point concernant cette question de l’hostilité. On en rit un peu de temps en temps, il arrive que des étudiants de Licence me disent : « Je voudrais faire une analyse ». Je les reçois, on discute un peu et je m’aperçois que leur représentation de l’analyse est « Je vais voir un psychanalyste une fois. Il me fait ma psychanalyse et c’est fini ». Alors effectivement on se dit « bigre ! ils ont fait trois ans de psychologie et voilà la représentation qu’ils ont… ». Or, ce sont des étudiants en psychologie. Alors, dites-vous bien que lorsque vous arrivez dans une institution, que vous avez derrière vous plus ou moins l’ombre de la psychanalyse, vous êtes un objet bizarre parce que les gens ne savent pas ce que c’est. Un intervenant évoquait ce matin l’idée de l’explicitation du cadre. Eh bien oui, il faut expliciter. Expliquer, je ne suis pas sûr que cela soit intéressant. Car on s’y perd dans les explications. Mais nous pouvons faire l’hypothèse qu’une partie de l’hostilité n’est pas liée en premier lieu à une résistance à l’égard de l’inconscient, à la vie psychique profonde, aux zones en souffrance. Mais elle serait liée à une méconnaissance assez importante de ce qui est notre pratique, de ce qui nous meut, de ce qui fait qu’on dit telle chose, de ce qui fait qu’on a telle raison d’apporter tel type de réponse dans une situation donnée plutôt que tel autre. Expliciter cela me semble en effet être le préalable. Et on va s’apercevoir que, très souvent, cette explicitation va être une ouverture en direction d’une meilleure connaissance. Peut-être qu’on peut aussi essayer de faire en sorte que les autres explicitent aussi quels sont les sous-tendus de leurs propres démarches. Je pense qu’on se fait trop le crédit de se comprendre a priori, comme si ça allait de soi de rencontrer un psychologue et de savoir ce que c’est et comme si ça allait de soi pour un psychologue de rencontrer des éducateurs, des infirmiers et de savoir quels étaient les ressorts de leur profession. Mais ce n’est pas parce que nous sommes les spécialistes de la vie psychique inconsciente qu’on doit négliger la vie psychique consciente. Parce que dans une institution, avant de se rencontrer sur la base de l’exploration mutuelle de nos inconscients, on commence par se rencontrer à un niveau manifeste, à partir de la secondarité. Je souhaiterais terminer sur une phrase : « Aimer les choses à double sens, mais assurez-vous bien d’abord qu’elles ont un sens ». C’est le préalable, c’est le premier temps.