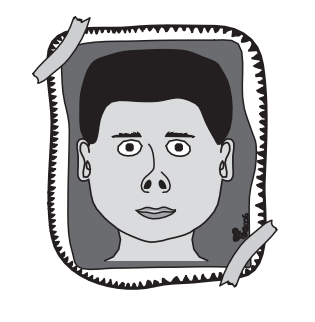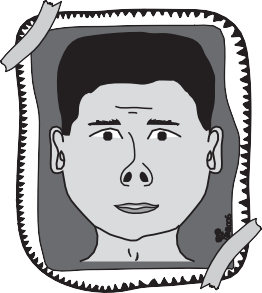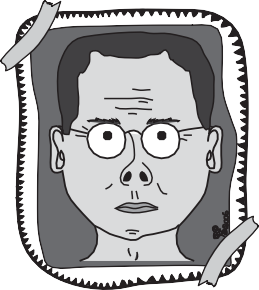Canal Psy : M. Talpin, voulez-vous revenir pour nos lecteurs sur l’origine de ce livre ? Qu’est-ce qui vous a conduit à réunir ce collectif autour de cette question du vieillissement ?
Jean-Marc Talpin : L’idée première était de faire un bilan. Il y avait en cela tout d’abord une dimension personnelle : cela fait 25 ans que je m’intéresse à la gérontologie, et je me suis rendue compte quand j’étais étudiant qu’il y avait très peu d’ouvrages sur la question, en particulier très peu d’ouvrages actuels. Au fur et à mesure des années, on a vu des ouvrages être publiés, se développer, et du coup cela pouvait être intéressant d’avoir une vision d’ensemble sur la façon dont le territoire de la psycho-gérontologie a été défriché par ces auteurs, soit du côté de la psychologie clinique, soit du côté de la psychopathologie, avec des ouvrages de psychologues, de psychanalystes mais aussi de psychiatres. On a des ouvrages extrêmement différents, avec des choix théoriques qui peuvent être très distincts les uns des autres, certains se complètent, certains peuvent être un peu redondants, d’autres au contraire ouvrent vraiment des pistes neuves.
Un de mes grands points de départ pour ce livre a été l’ouvrage de H. Bianchi sur la question du vieillissement, qui était paru lui aussi chez Dunod. Le projet des « Cinq paradigmes » se voulait une réponse. De plus, H. Bianchi est l’un de ceux qui ont disparu du champ de la recherche gérontologique, comme s’il avait eu besoin de passer à autre chose, tout comme des auteurs tels que C. Balier, qui est bien connu des psychologues puisqu’il est passé ensuite au travail en SMPR, à la violence, notamment sexuelle, etc. Nous avons ainsi essayé de dégager quelques lignes de force à partir de tous ces auteurs. Ce qui explique qu’au début du livre on fait un peu le point sur les écrits de S. Freud, S. Ferenczi, K. Abraham ; mais ce qui m’intéressait c’était plus les auteurs contemporains, on va dire en gros à partir des années 80.
Canal Psy : Pourquoi cette organisation du livre en cinq parties ?
J.-M. T. : Cela n’a été ni évident ni immédiat. Avec du recul j’ai un regret : ne pas y avoir intégré le paradigme de l’institution. Parce que c’est aussi un des paradigmes importants. J’ai essayé de me centrer effectivement plus directement sur la clinique de l’individu, de l’individu et de la famille si l’on pense à l’intervention de P. Charazac et de Ch. Joubert, mais ça vaudrait la peine d’ouvrir un deuxième chantier : « vieillissement et institution », de pouvoir le reprendre dans une perspective clinique là aussi. Ce que j’ai essayé de définir quand j’ai travaillé là-dessus c’était quels étaient les paradigmes qui me paraissaient saillants, ces paradigmes étant des fils conducteurs pour travailler les questions gérontologiques. En ce qui me concerne j’ai choisi de travailler le paradigme structural.
Il me paraissait aussi évident qu’il fallait travailler le paradigme du corps. Or, je fais partie du comité d’organisation de l’ARAGP, l’Association Rhône-Alpes de Gérontologie Psychanalytique. À l’occasion des journées d’étude annuelles, nous avions sollicité entre autres Marion Peruchon il y a deux ou trois ans, et elle développait déjà cette question psychosomatique. Je me suis dit que c’était nouveau que l’on se pose la question comme ça. Jusque-là on était plus sur un modèle plutôt réactionnel : qu’est-ce que ça fait de vieillir ? Et là on voyait apparaître un décalage : comment peut-on penser le vieillissement en tant que phénomène psychosomatique ?
Pour ce qui était de la famille, on ne pouvait pas éviter ce paradigme, en particulier parce que dans la pratique, on se rend bien compte que c’est comme en pédopsychiatrie, on ne peut pas ne pas prendre en compte la famille. Quand on travaille avec des personnes âgées dépendantes, les familles qui nous sollicitent accompagnent leur parent, sont présentes dans l’institution, et du coup il faut pouvoir penser les choses dans un cadre un peu plus large, ce qu’on a aussi dans le livre que P. Charazac a fait paraître chez Dunod en même temps que cet ouvrage, et que l’on trouvait aussi dans son livre Psychothérapie du patient âgé et de sa famille. Je crois que vraiment on est dans des situations où ne peut pas se contenter d’accueillir uniquement l’individuel. Il faut évidemment prendre en compte la clinique individuelle, mais en même temps le paradigme de la famille est un paradigme tout à fait important.
Laurence Chassard
L’autre paradigme auquel je tenais beaucoup était celui de la démence. D’abord parce qu’il me paraissait important de déconstruire ce terme de démence qui est devenu une véritable tarte à la crème de la gérontologie, au sens où les gens voient de la démence partout. On appelle alors « démence » un peu tout et son contraire. Il n’y a pas toujours une définition clinique précise. André Chevance, dont j’avais lu plusieurs articles par ailleurs, me paraissait tout à fait indiqué pour traiter cette question, en proposant un décalage. Ce que j’ai beaucoup apprécié dans cette collaboration avec André Chevance, c’est que ce n’est pas quelqu’un qui est sur une position dogmatique. Bien sûr il apporte une dimension cognitive, j’en dirai un mot tout à l’heure, mais en même temps il propose surtout une écoute clinique de la dimension cognitive de la démence. Et il montre ainsi que le dément ne se réduit pas à son déficit. Certains exemples le disent bien, il y a des échanges avec les déments, et la démence peut aussi être pensée comme une défense. Ce qui pose aussi la limite de notre intervention : est-ce qu’on respecte ces défenses, etc. ?
Et puis dernier paradigme, le paradigme cognitif, qui est très en lien au fond avec la question de la démence. On se rend compte que toute une série de lieux gérontologiques se réorganisent autour de consultations mémoire. Il y a une très grosse demande des populations, et du coup, soit on a une approche purement cognitive, c’est-à-dire qu’on va faire de la quantification, on va évaluer, soit on va articuler cette dimension évaluative avec une dimension plus psycho-dynamique. Les deux auteurs qui ont été sollicités, Denis Brouillet et Sophie Martin, ont fait ce lien, eux se situant du côté cognitif. Et je me suis rendu compte qu’il y avait très peu de cliniciens qui se sentaient prêts à travailler cette question-là. Or je crois que les cliniciens ne pourront pas faire l’économie tôt ou tard de cette question. J’espère aussi que ce travail sera une porte ouverte pour essayer d’aller plus loin : qu’est-ce que la pensée clinique de la cognition ? Il y a des choses très intéressantes sur la pensée clinique de la cognition chez les enfants, on peut penser à D. Anzieu, avec le concept des enveloppes, je pense aussi à d’autres auteurs comme Elsa Schmidt Kitsikis. Mais en ce moment pour le vieillissement, il n’y a pas d’auteurs qui aient pris la problématique à bras-le-corps.
Canal Psy : En ce qui concerne plus particulièrement votre partie, qu’est-ce qui a orienté votre questionnement du côté de la structure psychique du sujet vieillissant ?
J.-M. T. : Comme je le dis un petit peu dans l’article, c’est parti de plusieurs choses, d’une part d’une clinique, d’autre part de ma position d’enseignant. Je me rendais compte que beaucoup d’étudiants, en particulier en DESS de gérontologie à l’époque, avaient tendance à voir des états limites partout. Je sais bien que Jean Bergeret lui-même a tendance à en voir beaucoup, puisqu’il dit que ça représente plus ou moins 40 % de la population, mais ce que les étudiants faisaient bien ressortir c’est que dans le vieillissement il y avait quelque chose en jeu, qui était sans doute la moindre efficacité de la structuration sur un mode névrotique pour un certain nombre de personnes. Je dis bien pour un certain nombre, car on continue à voir des personnes âgées organisées sur des modes hystérique, obsessionnelle ou phobique, de manière très structurée, mais on voit aussi apparaître toute une série de situations à la configuration clinique moins claire, plus floue, avec parfois des éléments délirants. Mais en même temps on n’est visiblement pas dans une organisation vraiment psychotique. Donc je me suis demandé ce qu’il en était de la structure dans le temps.
Je n’ai pas inventé cette question-là, elle est présente déjà dans un autre livre de H. Bianchi qui s’appelle Le moi et le temps, et où lui opposait la structure et le sujet, la structure étant ce qui ne vieillit pas, tandis que le sujet résiste au temps tout en étant pris dans le temps. J’ai essayé de traiter cette question un peu différemment, en m’appuyant sur le modèle que développe S. Freud dans Les nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, celui du bloc de cristal. Freud écrit que la psyché se cristallise d’une certaine manière et qu’ensuite la cassure se fait sur les lignes de cette cristallisation. Il me semble que ce modèle-là bien sûr est un modèle qui demeure valable, mais qu’en même temps il doit intégrer l’idée que certaines circonstances de la vie permettent des remaniements psychiques. On retrouve cette idée très fortement chez D. W. Winnicott. En effet la pensée de Winnicott est moins une pensée structurale qu’une pensée du processus. Du coup il revient sur la façon dont le sujet peut se soigner spontanément par son environnement. Au fond cette proposition fonctionne si les gens ne sont pas trop malades, sinon il y a besoin de dispositifs spécifiques. Je pense aussi à l’article d’E. Jaques, « Mort et crise du milieu de la vie », dans lequel il montre comment la crise du milieu de vie peut être un moment de réaménagement. On peut alors effectivement se demander s’il s’agit d’un réaménagement de la structure, ou plutôt dans la structure.
Le deuxième élément à partir duquel j’ai été intéressé par cette question, c’est lorsque je me suis rendu compte que les soignants en gérontopsychatrie pensaient selon deux modèles, c’est un point que j’essaie de développer dans le livre. Il y aurait ceux qui adhèrent à un modèle structural, c’est-à-dire « ce patient est psychotique, ou bien névrosé, il a toujours été comme ça, éventuellement compensé et puis les aléas de la vie ont entraîné une décompensation ». Mais du coup on ne pense pas la question du vieillissement. Et il aurait ceux qui seraient plutôt dans l’événementiel, et qui vont alors penser le vieillissement, mais plus la question de la structure. Or, ce qui me paraît fécond c’est de penser la tension entre ces deux pôles. Je pense par exemple à un article de J. Rouart qui m’a beaucoup fait réfléchir : « Les âges de la vie et la psychopathologie ». C’est un article de 1963, dans lequel il s’interroge sur une question qui n’a d’ailleurs pas été beaucoup traitée : les psychopathologies ont-elles des périodes d’apparition privilégiées dans la vie ? Par exemple, pourquoi la schizophrénie apparaît-elle avant 30 ans ? Il n’y a en effet jamais de première décompensation schizophrénique à 70 ans. Comment se fait-il qu’il y a beaucoup de premières dépressions autour du milieu de la vie, ou encore que les psychoses paranoïaques s’expriment généralement après 30-40 ans ? Globalement, chaque âge renvoie à ses propres enjeux psychiques.
Laurence Chassard
Canal Psy : Relieriez-vous le phénomène de perte de repères sociaux pour vivre son vieillissement à une plus grande fréquence d’apparition de symptômes du côté de l’angoisse chez les personnes âgées ?
J.-M. T. : Oui. On pourrait dire qu’un des symptômes majeurs du vieillissement c’est la mémoire. Du coup toute difficulté de mémoire va être interprétée comme potentiellement le signe d’un Alzheimer. Je donne toujours cet exemple qui m’avait frappé, d’une dame qui était venue me voir en consultation en me disant : « Je viens parce que j’ai des problèmes de mémoire, j’ai peur que ce soit un Alzheimer... ». Elle était âgée d’une soixantaine d’années. En entretien elle ne semblait pas vraiment présenter des problèmes de mémoire. Elle m’expliqua qu’elle allait à la cave, et qu’en remontant elle s’apercevait qu’elle avait oublié de prendre ce qu’elle était allée chercher, ou qu’elle allait faire des courses et qu’elle avait oublié quelque chose... Et puis au fur et à mesure de l’entretien j’en suis venu à lui demander : « Mais vous avez l’impression que ça a commencé quand ? ». Et là elle me dit : « En fait j’ai toujours été comme ça » ! Sauf que lorsqu’elle avait 30 ans, elle se disait qu’elle était un peu tête en l’air et elle y retournait, et là tout d’un coup, alors qu’elle avait quelques problèmes d’arthrose au niveau du genou, ces allers et retours lui coûtaient davantage, et elle réinterprétait alors ce qui jusque-là était un signe de son étourderie, en un signe d’une possible pathologie. On a fait un bilan, il n’y avait aucun problème. Par contre c’est quelqu’un que j’ai ensuite suivi pendant quelque temps pour l’angoisse qu’elle manifestait, elle avait d’ailleurs perdu sa mère peu de temps avant.
Je crois que cette angoisse est intéressante parce qu’elle permet de questionner véritablement le modèle qu’on a de l’appareil psychique. Par exemple en ce qui concerne l’angoisse de mort, pense-t-on comme Sigmund Freud que l’inconscient ignore la mémoire, ou comme Melanie Klein qu’il y a une angoisse de néantisation ? Ce que je peux dire, d’après ce que je vois avec les patients âgés, c’est que certains qui ont élaboré un certain nombre de choses sont plutôt dans une sorte d’attente paisible de la mort, quelques-uns ont plus de 90 ans et disent « j’ai fait mon temps ». Ils ne sont pas forcément dans des grandes attentes vis-à-vis de la vie, l’actuel est vécu plutôt comme du surplus. Mais il y a d’autres moments beaucoup plus aigus où de fortes angoisses peuvent ressurgir. Ce qui n’économise pas d’utiliser le modèle de Freud, c’est lorsque ce qui est mis parfois en avant comme une angoisse de mort est en réalité une angoisse de castration, ou une angoisse d’abandon ; mais je crois que dans un certain nombre de cas on touche à quelque chose de très radical qui est effectivement cette angoisse de disparaître.
Laurence Chassard
Canal Psy : En ce qui concerne les processus de vieillissement, quelle serait votre hypothèse quant aux manifestations psychopathologiques tardives du sujet âgé plutôt du côté de l’effondrement narcissique ?
J.-M. T. : C’est un aspect effectivement important. Un certain nombre d’auteurs développe que la psychopathologie du vieillissement est une psychopathologie qui a beaucoup à voir avec le narcissisme. C’est l’hypothèse que faisait Claude Ballier il y a une bonne trentaine d’années maintenant, et que l’on retrouve chez des gens comme Paul-Laurent Assoun quand il parle de la « désaide » vis-à-vis du vieillissement : quid de ce narcissisme dans le bilan de vie puisque le bilan de vie c’est vraiment la confrontation de ce que le sujet a vécu avec l’idéal du moi ? Le bilan de vie est-il alors suffisamment positif pour continuer d’alimenter l’estime que le moi peut se porter à lui-même ? On peut aussi le traiter d’un autre aspect, en effet le narcissisme est aussi atteint par la multiplication des pertes des objets. C’est quelque chose qui dans ma pratique me frappe beaucoup, je me rappelle par exemple d’un monsieur qui avait 90 ans et me disait : « Je n’ai plus un ami de ma génération, ils sont tous morts... ». Il y a donc quand même toute cette dimension narcissique du deuil, même si l’on n’a pas à faire avec une personnalité « narcissique ». Le deuil sollicite le narcissisme : comment le moi va-t-il réussir éventuellement à réinvestir de nouveaux objets ? Et puis, évidemment, il y a toute la part narcissique de soi qui est confiée aux objets.
Canal Psy : Comment envisagez-vous, à partir de cette problématique ainsi définie, le travail d’accompagnement du psychologue dans cette crise ?
J.-M. T. : Je crois que vous répondez à moitié à la question en parlant d’accompagnement. C’est peut-être un terme sur lequel on peut s’arrêter, parce que j’ai des réserves à l’utiliser, au sens où je crois qu’effectivement il y a des situations où on va faire de l’accompagnement, lorsque la demande ne va pas plus loin. Dans le cadre d’une hospitalisation en gérontopsychiatrie, il y a des patients qui n’adhèrent pas à l’idée qu’il pourrait y avoir un suivi en CMP à la sortie de l’hôpital. La crise est gérée sur le moment, mais ils ne veulent surtout pas aller voir plus loin. On sait que ça reste fragile, mais on en reste là. Je crois que pour d’autres, ce n’est pas la majorité, quelque chose peut être mis en travail y compris tardivement. Alors, au-delà de l’accompagnement, on a un vrai travail psychique à faire. Les gens ont rarement une demande de travail en profondeur, à ce moment-là il faudrait réorienter vers un analyste, mais ils ont quand même envie de comprendre un peu plus loin, plutôt que de seulement effacer les traces de la difficulté. Il y a effectivement un travail sur le narcissisme, mais aussi tout un travail de reprise des objets internes. Et on se rend compte que l’une des choses qui va être en jeu c’est non seulement le rapport aux parents de l’enfance, mais c’est aussi les identifications aux parents vieillissants. Il y a parfois des identifications aliénantes, des personnes qui vont avoir peur de devenir dément parce que dans leur famille un parent a été dément… Et du coup, il y a aussi tout un travail pour sortir de cette représentation en terme de fatalité.
Laurence Chassard
Canal Psy : C’est vrai qu’étant donné que l’on vit plus vieux, cela signifie aussi que l’on peut survivre à nos parents...
J.-M. T. : Oui, de plus en plus, et cela pose une vraie question. J’ai commencé à réfléchir là-dessus. C’est très bien décrit dans le livre d’Albert Camus Le Premier homme. C’est un livre que Camus n’a pas fini puisqu’il est mort durant sa rédaction. Il avait perdu son père alors qu’il était enfant, et dans ce livre il dit qu’un jour il est allé sur la tombe de son père, et qu’il a pris conscience qu’il était plus vieux que l’âge auquel son père était mort. Il a eu peu à peu le sentiment que le sol se dérobait sous ses pieds. Même si Camus avait trouvé des figures paternelles de substitution, il n’empêche que là, Camus avait tout à inventer. Je pense de la même façon que pour ces vieillards, il n’y a pas de modèle pré-établi de ce que ça va être que d’être très vieux. Il y a des stéréotypes, mais les gens se rendent vite compte que ce n’est pas très étayant.
Canal Psy : Je voudrais revenir sur un point que j’avais trouvé assez intéressant, autour de la vignette clinique d’une patiente que vous avez appelée Marguerite. Voulez-vous reprendre ce que vous souhaitiez mettre en évidence à travers cet exemple ?
J.-M. T. : Oui. Je pense que ça renvoie à une question que l’on peut aborder dans d’autres endroits, c’est ce qui se passe entre un patient et le cadre institutionnel. Au fond, on a toujours un peu tendance à se dire que ce qu’on voit du patient c’est lui, et on oublie que c’est lui tel qu’il peut s’actualiser, si je peux dire cela comme ça, dans un certain type de cadre institutionnel. L’exemple de Marguerite est une situation qui m’avait beaucoup marqué professionnellement. Pour aller à l’essentiel, c’est une dame qui avait été hospitalisée sur une présentation plutôt démentielle, mais pas très démente, qui avait été mise en maison de retraite parce que seule chez elle, elle n’y arrivait plus. Elle avait une nièce qui s’occupait d’elle, mais étant donné son caractère difficile, sa nièce s’est fatiguée de la situation, et a trouvé cette solution de la maison de retraite. Or en une semaine Marguerite a fait tout ce qui fallait pour se faire virer de la maison de retraite. Elle était très agressive, donc elle est arrivée en psychiatrie. Elle était déjà venue une fois. Elle revient avec un tableau clinique pas dramatique, mais avec la demande de pouvoir rentrer chez elle, et elle fait alors vivre aux équipes des choses très douloureuses. Dès qu’on arrive à la porte, elle nous supplie presque à genou de la ramener chez elle, ce qui fait qu’au bout d’un moment on s’est senti horriblement coupable, alors, dans une réunion de synthèse, on se dit, après tout, c’est vrai elle peut bien avoir le droit de retourner chez elle. On fait alors le point avec l’assistante sociale, qui dit qu’elle va se renseigner sur ce qu’il est possible de mettre en place comme aide à domicile. La synthèse a lieu à 14h ; dans l’après-midi le médecin reçoit la dame, lui annonce que l’on a décidé de voir ce qu’on pouvait faire pour accéder à sa demande. En fin d’après-midi elle tombe et elle se fracture le col du fémur. Sur le coup, évidemment, on s’est dit : « Mince, c’est vraiment pas de chance... », et quand même, très vite, on se dit : « Étrange…!?? ». Donc ensuite Marguerite est allée à l’hôpital général pour soigner la fracture, puis elle est revenue, et elle n’a plus jamais sollicitée de retourner chez elle. L’hypothèse que je fais alors dans le livre, et qui est celle que l’on avait refait en équipe, c’était qu’au fond, le cadre n’avait pas été assez contenant, c’est-à-dire qu’on n’avait pas entendu toute l’ambivalence de Marguerite. Son discours conscient c’était « Laissez-moi rentrer chez moi ! », tandis qu’au fond il y avait un transfert sur le cadre institutionnel qui lui permettait de gérer toute sa dépendance. En lui disant « D’accord, on va essayer de faire en sorte que vous rentriez chez vous », on l’abandonnait, on la laissait tomber.
Un jour j’avais présenté cette situation dans un groupe de travail à l’université, et un collègue qui travaillait avec des adolescents me disait qu’il avait rencontré la même situation avec un adolescent qui était en famille d’accueil, qui n’avait pas de cesse de dire « Je suis mal, remettez-moi dans ma famille », et les éducateurs ont fini par dire « oui, on est trop cruels », il faisait vraiment vivre cela, l’adolescent s’est alors effondré psychiquement quand on l’a remis dans sa famille. Dans un cas comme dans l’autre, l’opposition structurait ces personnes, et à partir du moment où ils n’ont plus trouvé de butée à leurs revendications, ces gens se sont effondrés, pour la dame sur un mode somatique assez grave car il y a eu besoin d’une opération, pour l’adolescent sur un mode très dépressif.
Canal Psy : Quelle était votre hypothèse concernant le transfert qui était fait sur l’institution et la relation de cette patiente avec sa mère?
J.-M. T. : Nous étions dans un mouvement où en même temps elle nous attaquait, et où, dans son propos, elle était dans une position très idéalisante vis-à-vis de sa famille, et particulièrement de sa mère. C’est quelque chose que l’on retrouve beaucoup avec les patients âgés, très souvent, on a affaire à des mères ou à des parents très idéalisés, mais qu’il serait du coup interdit d’attaquer. La contre-partie de l’idéalisation de la mère en ce qui concerne Marguerite, c’est qu’elle nous attaquait, nous. Sauf que ce qu’on n’avait pas compris à ce moment-là c’est qu’il fallait que l’on reste cette mère contenante, étayante, et si on accédait à sa demande, tout se cassait la figure.
En conclusion, je crois que ça permet de souligner qu’il y a des spécificités bien sûr dans la clinique gérontologique, mais que ce sont aussi des problématiques qui ne sont pas exclusivement celles de la vieillesse, hormis peut-être la proximité de la mort, encore que l’on peut la trouver aussi dans la maladie, à tous les âges. Pour le reste, on peut dire qu’il y a une remise en jeu de problématiques récurrentes, et que cette question de l’autonomie est aussi celle de l’adolescence. Il ne faut finalement jamais enfermer le vieillissement comme si c’était une fin en soi, mais plutôt s’appuyer sur une culture psychopathologique plus large pour l’aborder.
Laurence Chassard
Canal Psy : Pour terminer, j’ai envie de vous demander : si vous aviez un message, une expérience, à transmettre aux jeunes psychologues qui débutent dans ce champ de pratique, quels seraient-ils ?
J.-M. T. : D’abord je dirais que c’est une pratique qui peut être extrêmement riche, et qui, d’une certaine manière, sollicite de façon un peu spécifique du côté d’un transfert filial. Le clinicien est forcément plus jeune que son patient, il est alors de la génération des enfants, voire des petits enfants, donc il y a dans ces situations des enjeux du côté de la transmission. Je me souviens d’un patient qui disait « Quand il se passera ceci, vous penserez à moi ». On participe d’une certaine manière à cette idée d’une immortalité, d’une survivance à travers la mémoire des autres. En cela c’est assez différent des situations où l’on travaille avec des enfants et où l’on est situé essentiellement dans une position parentale. Ce qui n’empêche pas, l’exemple de Marguerite l’illustre bien, qu’il y ait aussi des mouvements de transfert parentaux. Au moment où j’ai commencé à travailler cette question de la transmission, je m’étais rendu compte qu’il y avait un certain nombre de patients qui n’avaient pas d’enfants, et qui nous convoquaient pour garder mémoire d’eux. Quand je m’appuie aujourd’hui sur une situation clinique pour un travail, parfois je me dis : « Voilà, j’ai rempli un mandat ». Je continue à les faire exister. Marguerite était ainsi une patiente qui était mariée, mais qui n’avait pas pu avoir d’enfants, et en racontant son histoire c’est aussi une manière pour moi de continuer de la faire exister.