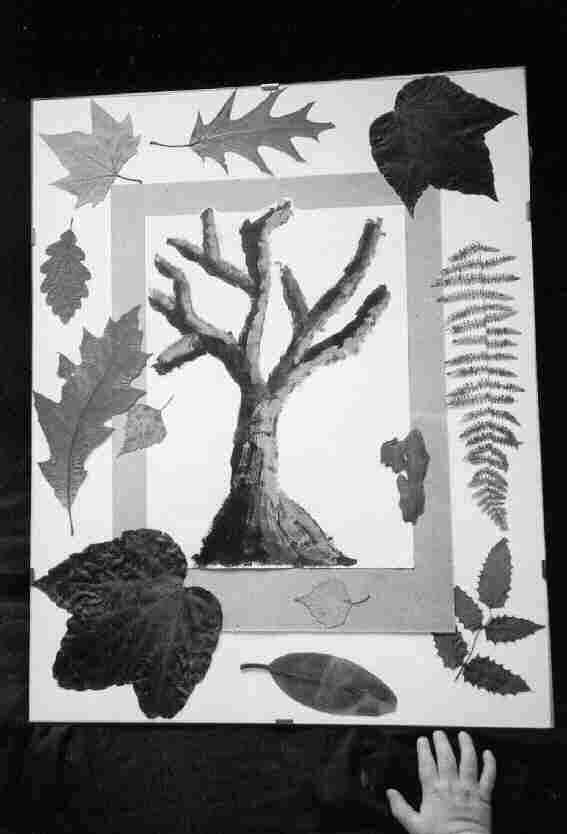Le présent article vise à rendre compte d’une recherche-action, réalisée entre 1999 et 2001, sur la question des avatars de l’adoption à l’étranger, dans le contexte des expressions de la violence et des souffrances dans les liens tels que peuvent les connaître les différents établissements et services ayant en charge la protection des mineurs et la prise en charge des mineurs délinquants dans le cadre de mesures judiciaires en France.
Cette recherche a mobilisé une équipe de recherche à double composante universitaire et professionnelle (éducatrices et directeur de service), à laquelle se sont joints, à différents temps de la recherche, une trentaine de travailleurs sociaux des établissements et services sollicités.
Outre le projet d’une meilleure compréhension clinique de ces situations, qui viennent interroger de manière répétitive les pratiques éducatives depuis plusieurs années, il s’agissait d’interroger ces dernières, afin de proposer des pistes d’infléchissement de la pratique au travers de l’élaboration d’un certain nombre de repères à destination des professionnels.
Si cette recherche s’inscrit de manière privilégiée dans une orientation de psychologie clinique, en appui sur une démarche de type psychosociologique, il s’est avéré précieux de confronter ce registre d’élaboration à l’apport d’autres disciplines connexes qui ont, elles aussi, à un titre ou à un autre, à connaître de ces situations d’adoption à l’étranger.
Perspectives interdisciplinaires
Si l’approche historique de l’adoption à l’étranger en France se trouve limitée dans son projet par le faible recul d’un phénomène qui s’est largement développé seulement à partir des années 1980, il paraît intéressant de s’arrêter sur trois propositions de J.-J. Yvorel, historien1, qui concernent l’adoption de manière générale, mais qui viennent en écho de la situation actuelle d’adoption à l’étranger :
- dans l’histoire de l’adoption, au début du XXe siècle, le projet n’était pas tant de donner une famille à un enfant que de s’attacher à son accueil, sans que nécessairement celui-ci n’entraîne un effet en termes de filiation (et de succession),
- la particularité de l’adoption dans cette période est de constituer une pratique de proximité ; l’adoption fait l’objet d’une sorte de contrat, au sein des relations de voisinage et/ou de famille,
- l’adoption, avant les lois récentes sur l’adoption plénière, ouvre sur une parentalité multiple au travers de la connaissance de la parenté biologique.
Ainsi, on peut comprendre que la pratique actuelle de l’adoption d’un enfant à l’étranger, dans la plupart des cas, introduit une rupture radicale, point à point, au regard des pratiques traditionnelles en France : adoption sur le mode de l’adoption plénière, adoption à l’autre bout du monde, rupture radicale au regard de la parenté biologique. De plus, ces pratiques se trouvent également bien souvent en rupture avec les pratiques traditionnelles des pays d’origine des enfants adoptés.
Les travaux d’E. Rude-Antoine2 mettent l’accent, en particulier, sur la double tension propre à la démarche de l’adoption d’un enfant à l’étranger :
- en premier lieu, tension entre une dimension de l’intime dans la nécessité d’assurer sa filiation au travers de l’adoption, qui intervient comme palliatif au regard d’une procréation impossible, et une dimension de l’universel qui traverse la motivation humanitaire propre à spécifier la démarche de l’adoption à l’étranger,
- en second lieu, tension entre ce qui relève d’un empêchement de la filiation biologique, qui appartient à la sphère du privé, et ce qui s’inscrit dans la filiation adoptive, dans un nécessaire processus d’affiliation, qui renvoie à la dimension du social.
Il semble que les conflits de législation, auxquels la Convention Internationale de La Haye tente de proposer des issues, en encadrant de manière plus précise les conditions de recueils des enfants en vue d’adoption dans les pays d’origine ainsi que les conditions d’adoption dans les pays d’accueil, entraînent un certain nombre de difficultés qui tendent à renforcer la charge traumatique propre à cette situation particulière que représente l’adoption d’un enfant à l’étranger.
Par ailleurs, les perspectives ouvertes dans le champ de la sociologie, particulièrement au travers de l’analyse des modalités d’inscription de la filiation dans une logique de circulation du don, dont on peut trouver trace, de manière spécifique dans la pratique de l’adoption à l’étranger, apportent un éclairage sur les enjeux de cette pratique.
S’appuyant sur des travaux antérieurs menés dans des champs connexes (la garde des enfants, la pension alimentaire dans le cadre des séparations…), F. Bloch3 propose une lecture de l’adoption de l’enfant à l’étranger qui intègre le mode de circulation du don dans l’ordre des générations : ainsi, l’adoption d’un enfant à l’étranger se trouverait-elle en risque de s’extraire d’un système de rétribution mutuel (dans une logique don/contre-don), dans la configuration d’un lien familial contaminé par l’argent, au sein duquel l’enfant adopté (ce que je propose de repérer à partir de la figure complexe et ambiguë d’un enfant à tout prix) serait pris comme un élément d’une transaction, sans possibilité pour les parents adoptifs de se dégager, par un système d’échange, de l’aliénation que leur confère le don de l’enfant.
Il semble intéressant de signaler, en contrepoint de cette rapide présentation, l’intérêt d’interroger la manière dont la question de l’adoption des enfants à l’étranger s’inscrit dans une histoire universelle, qui traverse l’histoire de l’humanité pour prendre forme dans les grandes formes de compréhension symbolique que représentent les récits mythiques.
À ce titre, les figures de Moïse et d’Œdipe me paraissent à même d’éclairer notre compréhension… de l’histoire de Moïse, l’enfant hébreu abandonné par sa mère et adopté à l’étranger par le puissant pharaon égyptien à celle d’Œdipe, exposé sur le Mont Cithéron par ses parents, les souverains de Thèbes, suite à l’oracle, puis adopté à l’étranger par les souverains de Corinthe, se joue l’articulation des positions de sauveur et de sauvé, sur fond d’une double confrontation à l’étranger… et à l’étrange.
Lien de filiation adoptive étrangère et « crise de l’adoption »
Quelques grandes lignes de compréhension des enjeux spécifiques du lien de filiation adoptive étrangère apparaissent au décours des 46 situations d’adoption à l’étranger sur lesquelles a porté la recherche. Celles-ci peuvent se comprendre au travers de trois axes principaux : celui des origines, celui de la réparation et celui du lien entre violence et sexualité.
Lien de filiation adoptive et origines : les trous de l’histoire
L’insu de l’histoire des origines de l’enfant adopté à l’étranger tend à laisser place au déploiement de théories au sein des familles adoptives qui se fondent sur l’exacerbation de la différence comme organisateur des liens de filiation adoptive : différence d’appartenance sociale entre famille d’origine et famille adoptive, différence d’appartenance culturelle (avec changement quasiment systématique du prénom, idéalisation du pays d’origine, tenu à distance par ce mouvement, assignation d’une place dans la culture, dont l’enfant ne va pas pouvoir se dégager : trafiquant de stupéfiant pour l’adolescent issu de Colombie, geisha pour la jeune fille adoptée en Corée, truand pour un adolescent du Mexique), différence de repère quant à la référence à la norme (un certain nombre de comportements délinquants à l’adolescence s’inscrivent dans cette problématique de la radicalité de la différence).
En contrepoint, la problématique de l’idéal (du côté des parents au travers de l’écart maintes fois nommé entre le projet de l’adoption et la réalité de sa mise en œuvre : nombre d’enfants adoptés, âge, sexe, pays d’origine… du côté des enfants, au moment de l’entrée dans l’adolescence avec la confrontation entre une représentation idéale de parents sauveurs, et qui bien souvent se présentent explicitement comme tels, et la réalité des liens engagés) apparaît comme point de nouage de la problématique du lien de filiation adoptive.
C’est plus précisément autour de la rupture de l’idéal que se joue l’impossibilité de faire famille.
Adoption et don : une histoire de réparation des traumatismes ?
L’adoption de l’enfant à l’étranger semble s’inscrire dans un jeu complexe entre traumatisme et réparation. Ce jeu met en tension, voire en écho, les vécus traumatiques des parents et ceux des enfants qui ne trouvent pas à se résoudre dans un système d’échange par le don.
En effet, il apparaît que l’adoption de l’enfant à l’étranger s’engage sur fond d’une double histoire traumatique : du côté des parents, avec le repérage récurrent de situations traumatiques, qui renvoient à des problématiques de deuil (de l’enfant biologique, d’un parent ou du conjoint), du côté des enfants, avec le contexte d’abandon et de maltraitance et des vécus traumatiques parfois inimaginables…
Dans ce contexte, la compréhension de la place de l’adoption à l’étranger entre traumatisme et réparation pourrait être la suivante : l’investissement d’un enfant à tout prix témoigne chez les parents adoptifs d’une souffrance au lieu de la filiation, souffrance qui se trouve contre-investie par une démarche réparatrice dans l’ordre de l’humanitaire.
On le sait, l’adoption d’un enfant à l’étranger requiert de la part des parents adoptants une disponibilité importante, un engagement sans faille, et des moyens financiers relativement conséquents.
La prise en compte de la place de l’économique, voire du financier, comme organisateur du lien de filiation adoptive s’est imposée dans la mesure de la dimension récurrente de cette question dans les rencontres avec les parents. Dans les situations de crise ou de rupture, l’enjeu autour de l’argent s’est révélé central, présenté, dans de nombreuses situations, dans un habillage humanitaire ou religieux sous-tendu par l’investissement d’une position de Sauveur. À partir de là, et face à l’échec de l’échange par le don, émerge un système que l’on peut qualifier de comptable, système qui vise à se substituer au précédent comme modalité d’interprétation du lien de filiation adoptive.
La violence et la sexualité au risque de l’adoption
La rencontre avec les situations d’enfants adoptés à l’étranger confronte à une interrogation quant à la place de la violence dans les liens entre parents adoptifs et enfants adoptés à l’étranger. Il semble que cette violence constitue tout à la fois la marque de l’échec d’une symbolisation du lien de filiation adoptive et une tentative de se protéger contre les fantasmes incestueux.
Cette violence prend des formes diverses : violence physique, parfois violences sexuelles, menace, violence verbale souvent marquée par une connotation sexuelle, violence dans les conditions d’éducation de l’enfant.
Cette configuration tend alors à placer les parents dans un vécu de victimisation et l’enfant adopté à l’étranger se trouve alors enfermé dans la figure du mauvais, du contaminant voire du pervers.
On peut dire dans ce contexte que la violence, dans ses différentes manifestations, signe un double échec :
- pour l’enfant, échec de sa capacité à être suffisamment aimable pour se laisser adopter, dans une réactivation de l’abandon initial,
- pour le parent, celui de sa capacité à être parent, au travers d’une réactivation de la charge traumatique aux fondements de la démarche d’adoption ; l’illusion d’une position de Sauveur s’écroule avec cet échec, entraînant des défenses massives.
Au regard du lien entre violence et sexualité, deux grandes configurations peuvent alors se préciser :
- d’une part, la référence à une sexualité transgressive (prostitution, abus et violences sexuelles…), et une assignation culturelle de celle-ci à l’origine de l’enfant adopté à l’étranger, viennent infiltrer les représentations du lien à l’enfant et l’assigner à une place impossible dans la famille adoptive,
- d’autre part, l’interdit de l’inceste ne trouve pas à s’établir de manière suffisamment fiable et sa fragilité laisse place à des mouvements violents peu élaborables.
Se dégage alors le sentiment d’une insécurité partagée dans le lien de filiation adoptive étrangère, sentiment sur lequel prend place la violence préalablement repérée.
Des repères pour une pratique ?
La mise en perspective des enjeux de l’adoption à l’étranger peut se penser à différents titres, au travers de la rencontre avec la famille adoptive et avec le ou les enfant(s) concernés, et qui concernent particulièrement :
- le repérage des lieux de souffrance traumatique afin d’éclairer les conditions de nouage réciproque du lien de filiation adoptive étrangère et d’approcher la place de la violence dans les liens,
- les modalités selon lesquelles la place de l’enfant adopté à l’étranger peut être pensée dans l’histoire de la famille adoptive, et le type de théorisation familiale entravant son inscription dans une mythologie familiale,
- enfin, la capacité de chacun des acteurs de l’adoption à l’étranger à se mobiliser dans une démarche de transformation.
Les effets de répétition, et d’emboîtement des mouvements de réparation (du côté des parents adoptifs, du côté des éducateurs…), constituent des éléments à interroger dans la pratique éducative, en mettant l’accent sur l’analyse des modalités d’infiltration des positions personnelles dans la pratique éducative, en recourant, le cas échéant à des dispositifs individuels ou collectifs d’analyse de la pratique ou de supervision, et ce sur deux plans :
- d’une part, celui de la rencontre des ressorts de la démarche d’adoption des parents adoptifs et du choix professionnel de l’éducateur dans ce qu’ils mobilisent, l’un comme l’autre, une démarche de réparation,
- d’autre part, celui de l’investissement des positions d’idéalité qui traversent les positions parentales (que la filiation soit biologique ou adoptive) et professionnelles et qui portent tant sur la figure du parent que sur celle de l’éducateur ou de l’enfant…
La question se pose, par ailleurs, de la capacité d’un même travailleur social à se trouver engagé simultanément (ou même alternativement) dans un lien éducatif à la fois avec les parents adoptifs et l’enfant adopté à l’étranger, dans la mesure d’une identification conjointe qui se révèle pour le moins acrobatique…
On peut alors reconnaître la nécessité, dans les situations d’enfants adoptés à l’étranger, de l’intervention systématique de plus d’un professionnel, doublée de l’intervention de plus d’une professionnalité : ce dispositif semble à même de garantir une position d’écart suffisante face aux mouvements de séduction/répulsion potentiellement à l’œuvre dans cette rencontre, et un accompagnement différencié de la souffrance de chacun des acteurs de l’adoption.
La contrepartie nécessaire de la mise en œuvre de ce type de dispositif tient à la capacité de dégager, au sein de l’équipe, des collaborations spécifiques qui reposent sur un projet d’intervention suffisamment discuté et partagé.
Au-delà, cette recherche a largement mis en évidence la nécessité de penser, tant dans le registre de la prévention que de l’accompagnement éducatif, de véritables dispositifs d’évaluation quant à l’instauration du lien de filiation adoptive étrangère.
D’une certaine manière, l’accompagnement des familles adoptant à l’étranger devrait pouvoir être pensé à partir de l’espace temporel singulier que constitue le temps de l’agrément, à considérer davantage comme processus que comme label, dans la perspective de l’actualisation d’une instance tierce en contrepoint du huis clos dramatique sur lequel se replient trop souvent parent(s) et enfant(s) et dont la violence est le témoin.