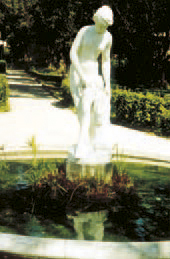Dans notre précédent n° d’Arabesques, l’Université de Nice-Sophia Antipolis, « deux ans après », faisait le point sur son expérience de site pilote du Sudoc. Cette université a développé une offre importante en documentation électronique et a entrepris une réflexion sur son financement. Geneviève Gourdet, présidente de l’UNSA et présidente du CA de l’ABES, et Louis Klee, directeur du service commun de la documentation, présentent ci-dessous cette politique de mutualisation.
La bibliothèque de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, service commun de la documentation, conformément au décret 85‑694 (JO du 11 juil. 1985), associe deux types de bibliothèques :
- une bibliothèque centrale, la BU, comptant sept implantations,
- des bibliothèques d’UFR, de départements, d’instituts et de laboratoires, dont une vingtaine sont importantes.
La documentation électronique est utilisée comme un outil d’évolution de l’organisation documentaire de notre université. Tout le processus a été d’une grande transparence car il a été discuté dans toutes les instances de l’université et a fait progressivement l’objet d’un consensus. Les protagonistes de cette opération ont, dès le départ, éprouvé le besoin de faire un bilan quasi permanent de cette « nouvelle donne ».1
La BU a créé en son sein un nouveau service, celui de la documentation électronique pour la maîtriser sous tous ses aspects : réseau, politique documentaire, financement, prospective. Sa création s’est réalisée grâce à un redéploiement de moyens en personnels et une nouvelle organisation.2 Le financement de la BU est en augmentation considérable. La documentation électronique, au départ, a été financée sur BQR voté par le conseil scientifique.
Le grand bond en avant. De 13 300 recherches à 86 000 !
Les statistiques montrent une stabilisation ; l’augmentation est modérée en 2000. L’année 1999 a été celle d’un véritable « bond en avant ». On est passé de 13 316 recherches en 1998 à 86 081 en 1999, soit plus de 6 fois plus. On peut comprendre ce saut à la fois comme le signe d’une « acculturation » des usagers à la documentation électronique et comme le reflet de l’élargissement de l’offre – cf. les budgets.
Le service de la documentation électronique, créé en 1997, correspond, en résumé, à la nouvelle donne documentaire : on passe d’une logique de territoire à une logique de partage, de réseaux. Or, l’organisation documentaire traditionnelle de l’université, fondée sur une BU répartie en sections et sur des bibliothèques d’UFR, de départements et de laboratoires menant chacune leur propre politique documentaire, ne permet plus de maîtriser cette nouvelle donne. Le nouveau service, « docélec », consacre cette évolution : les négociations avec tous les protagonistes (enseignants-chercheurs, directeurs de la BU, des UFR, départements et laboratoires, conservateurs chargés des sections, vice-présidents, conseils, fournisseurs, etc.) n’auraient pas été possible si elles n’avaient pas été centralisées. La présidence de l’université a désormais la maîtrise des grandes options de politique documentaire de l’établissement à travers le SCD.
La baigneuse, d’après Etienne Falconet (1716 -1791)
Université de Nice-Sophia Antipolis, Parc Valrose
Cliché : A. Wygaerts - BU Sciences
Financement et mutualisation
L’UNSA s’est trouvée devant un choix stratégique concernant le financement de la documentation de la recherche et surtout des périodiques en ligne.3 Elle a opté pour une politique volontariste qui se donne les moyens d’un traitement global et mutualisé des réseaux et de la documentation en ligne y associant les grands organismes de recherche, dont l’adhésion lui semble inéluctable. Elle fait le pari raisonnable qu’un large accès au catalogue d’un éditeur favorise une recherche en temps réel et plus ouverte.
Évolution de l’utilisation de l’offre en documentation électronique
Pour obtenir des chiffres comparables, on a divisé le nombre de recherches annuelles par le nombre de mois pris en compte dans les statistiques (3 en 1997).
Comprendre ce saut, à la fois, comme le signe d’une « acculturation » des usagers à la documentation électronique et comme le reflet de l’élargissement de l’offre.
La logique de consortium
La logique pure d’un consortium documentaire signifie qu’un groupe d’institutions universitaires se comporte à l’égard d’un producteur de documentation électronique (périodiques ou bases de données) comme une seule institution. La conséquence est qu’un abonnement pris par une institution profite à tous les adhérents du consortium : c’est l’accès croisé.
Le consortium COUPERIN compte 91 membres – 65 universités dont l’UNSA, 16 écoles, 11 organismes de recherche. Il a deux particularités.
Il négocie des conditions générales avec les éditeurs permettant à chaque adhérent de négocier des avenants correspondant à ses spécificités locales.
Il propose l’accès à des catalogues complets en raison du nombre élevé de ses adhérents.
Il est à noter que l’INSERM et le CNRS ont négocié séparément dans un premier temps mais se rapprochent actuellement de Couperin.
Avantages
Accès à l’ensemble des publications d’un éditeur sur tout le réseau de l’université.
Accès immédiat à l’information la plus récente.
Puissance de recherche par la multiplicité des clefs d’accès, dont le service CrossRef : une seule recherche permet d’accéder aux articles publiés chez plusieurs éditeurs.
Veille documentaire.
Engagement sur trois ans d’une masse financière au minimum constante encourageant une politique documentaire d’établissement.
Modération de l’augmentation du coût des abonnements.
Opérateur unique pour comprendre, expliquer, gérer cette question en interne comme en externe.
Inconvénients
La BU et les labos s’engagent auprès d’un éditeur à maintenir durant trois ans le même volume financier d’abonnements avec augmentation contractuelle.
Discipline de la BU et des labos à cause du consortium.
Discipline injuste car les labos déjà abonnés paient pour les labos qui ne le sont pas et qui profitent gratuitement de cette occasion.
Danger permanent de désabonnements, qui remettraient en cause les engagements pris par l’université, d’où cessation du service sauf si la BU prend le relais aux dépens de ses autres missions.
Synthèse
La distribution de la documentation électronique sur le réseau de l’université par la BU est, désormais, un fait acquis.
Le principe de la BU, interlocuteur unique des éditeurs et des courtiers, permet aux instances de l’université de mieux maîtriser la situation.
Le transfert des charges des labos vers la BU est pour le moment assumé par cette dernière, mais elle ne pourra le faire longtemps sauf au prix d’un appauvrissement global des ressources documentaires.
Budget documentaire
Après un débat étalé sur plusieurs séances du conseil scientifique, le principe d’un transfert progressif des abonnements inclus dans les consortiums à la BU et de leur financement a été voté le 19 juin 2001. Ce transfert est estimé à environ 500 KF pour 2002. Il sera évalué et discuté par une commission de suivi de cette politique (enquête sur les budgets documentaires, transfert des abonnements des labos vers la BU, politique documentaire) créée à cette effet. Il suppose aussi une estimation de la masse globale des abonnements souscrits auprès des éditeurs couverts par les consortiums : Elsevier, Wiley, Academic Press, Lippincott, Kluwer, High-Wire Press, Williams, Springer, Masson, etc.
Son financement combine, en fait, deux sources de financement.
- BQR (bonus qualité recherche) de 100 KF par an. Cette source a été volontairement plafonnée car sa vocation, définie par le conseil scientifique, est incitative et non récurrente. Ce conseil porte une attention particulière au développement de la documentation électronique et la gestion des consortiums d’achat de périodiques en ligne est un nouveau projet.
- Ticket modérateur à taux unique sur les micro-ordinateurs. Ce système fonctionne pour le financement du réseau du CRI (centre de ressources informatiques) : il est simple à mettre en œuvre et à contrôler. Pour 6 300 machines (5 150 UNSA + 1 150 CNRS, chiffres CRI), le ticket mensuel par machine serait de 1 € venant s’ajouter au ticket modérateur du réseau du CRI. Ce ticket serait révisable annuellement.
Conclusion : une nouvelle organisation
Le résultat de la nouvelle organisation documentaire de l’université est une nouvelle relation entre la BU-SCD et la présidence de l’université.
Ce schéma d’évolution correspond assez bien à l’organisation des BU américaines en services techniques et en services publics avec un service du développement des collections très proche du directeur. Le service de la documentation électronique annonce la création d’un service de développement des collections pour tout le SCD. Le directeur du SCD n’apparaît plus seulement comme le gestionnaire avisé du budget et des personnels de la BU mais surtout comme le conservateur responsable de la mise en œuvre de la politique et de l’organisation documentaire de toute l’université. La politique documentaire de l’université devient une politique partagée par tous les protagonistes et non pas une chasse gardée. La présidence se trouve dotée « d’un outil » lui permettant d’avoir une politique documentaire à l’échelle de l’université. Jusqu’à présent, l’organisation « traditionnelle » de la documentation échappait presque totalement à l’intervention présidentielle et assez largement à celle du directeur de la BU.
Avec la refonte des instruments de politique documentaire, le rôle et la composition des commissions scientifiques consultatives spécialisées ont été revus ; ainsi, une commission « sciences de la vie » regroupe les campus de médecine et de sciences. Tous les membres des commissions sont désormais nommés par les décideurs (directeurs d’UFR et de laboratoires) et leurs décisions engagent ces derniers. Le SCD dispose de rapporteurs au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire – CEVU. L’importance de ces commissions s’est trouvée renforcée. Elle a suscité un intérêt et un engagement nouveaux de la part des enseignants-chercheurs qui ont vu leur rôle de prescripteurs fortement reconnu. Les commissions ont contribué à maîtriser les classiques querelles des Anciens et des Modernes, à faire connaître et reconnaître puis à valider la nouvelle politique documentaire auprès des conseils comme… de la présidence. Et nous ne sommes pas arrivés, et sans doute n’arriverons-nous jamais, au bout de ce long chemin…
Le web est devenu le support indispensable de la documentation électronique. Il est impensable qu’il n’existe pas.
L’inventaire des ressources documentaires sera réactualisé dans sa présentation comme dans la collecte d’informations.
La mutualisation de la documentation électronique remet en cause notre organisation traditionnelle mais il faudra mener ce changement d’une manière souple et progressive. Le service de la documentation électronique doit aussi être un lieu de débat pour que la nécessaire adaptation des personnes comme des structures se fasse sur la base d’une compréhension claire des enjeux.
Évolution du budget de la documentation électronique
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| CS | 155 000 F | 220 000 F | 300 000 F | 300 000 F | 250 000 F |
| SCD | 35 000 F | 260 000 F | 600 000 F | 800 000 F | 2 250 000 F |
| Total | 190 000 F | 480 000 F | 900 000 F | 1 100 000 F | 2 500 000 F |