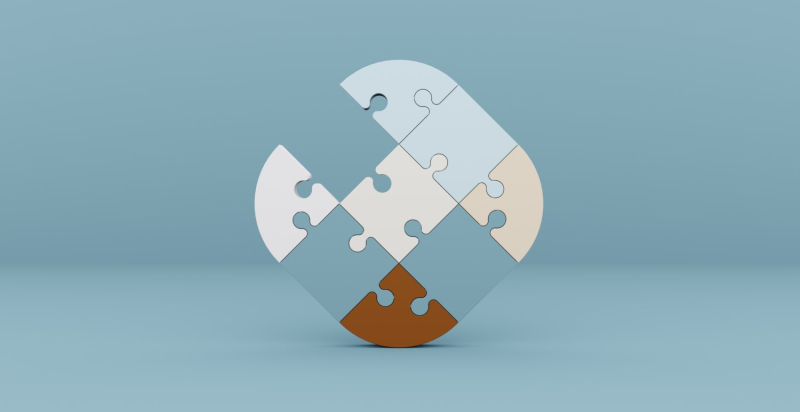Si l’élaboration des normes et standards repose sur un consensus, leur adoption reste largement volontaire, soulevant des questions sur leur rôle, leur accessibilité et leur pertinence. Entre cadre structurant et flexibilité, comment s’articulent ces référentiels dans nos pratiques professionnelles ?
Normes et standards : des outils au service des usages
Partons d’un constat initial faisant appel à un peu de sémantique, la norme est partout, de notre vie quotidienne à notre vie professionnelle : le rapport 2017 du Sénat sur la normalisation1 fait état de plus de 35 000 normes publiées en France dont près de 80 % émanent d’un niveau européen ou international. Appliquée dans un premier temps aux produits, notamment industriels, elle a suivi l’évolution de la société et s’intéresse de plus en plus aux services, à l’instar de la norme – ISO- 9001 sur la qualité, ou aux grands enjeux sociétaux (parité, transition écologique, etc.).
Dans notre domaine d’activité, elle traite aussi bien de la conservation (ISO 11799 - Exigences pour le stockage des documents d'archives et de bibliothèques), que de description bibliographique (ISO 999 - Principes directeurs pour l'élaboration, la structure et la présentation des index), d’identifiants pérennes (ISO 26324 - Système d'identifiant numérique d'objet), d’interopérabilité de nos systèmes informatiques (ISO 2709 Format pour l'échange d'information), de translittération (ISO 24229 - Codes pour les systèmes de conversion des langues écrites) ou d’indicateurs de performances (ISO 16439 - Méthodes et procédures pour évaluer l'impact des bibliothèques).
Aux normes, que la loi définit comme un « document de référence élaboré de manière consensuelle portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques »2 publié en France via l’AFNOR, s’ajoutent les standards, conçus plus spécifiquement dans le cadre d’une communauté restreinte mais que l’usage impose comme une norme de fait. De là à penser, comme on l’entend beaucoup, qu’il y a trop de normes, et partant trop de contraintes ?
Entre souplesse et contrainte : la normalisation en débat
Un distinguo s’impose d’emblée entre norme et réglementation. En effet, dans 99 % des cas, normes et standards ne sont pas obligatoires : il s’agit de consignes, de recommandations – on aimerait dire de communs – qui relèvent de ce que les juristes appellent le droit « souple », « fluide » ou « facultatif », dont les préconisations s’imposent par bon sens et souci d’efficience, en aucun cas par obligation légale. Ainsi, en France, seules quelques 300 normes sont d’application obligatoire. Relevant pour l’essentiel de questions de sécurité, elles assurent une articulation entre principes légaux et déclinaison opérationnelle, grâce à un processus de révision régulière qui permet de s’adapter aux évolutions de l’état de l’art.
La norme évolue également à travers les structures qui la portent. Rappelons que l’ISO a vu le jour en 1947, dans le contexte de création des grandes institutions économiques multilatérales issues des accords de Bretton Woods, ce qui positionne d’emblée la normalisation dans une dynamique économique. C’est dans ce cadre que s’inscrit, pour l’essentiel, le système français de normalisation. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, aux côtés de l’ISO gravitent de nombreux acteurs, qu’il s’agisse d’associations professionnelles telles que l’IFLA ou de consortia publics ou privés. Cette dynamique est particulièrement marquée dans les domaines des télécommunications et du numérique : on citera notamment le rôle structurant du W3C dans l’architecture d’Internet.
Est-ce le reflet d’un temps où le multilatéralisme des nations laisse place à des logiques plus bilatérales, entre consortia d’intérêts et communautés d’usagers ? Ou s’agit-il simplement d’une réponse à une exigence accrue de souplesse et de maîtrise de l’outil normatif ? De fait, la frontière s’avère rarement définitive entre norme estampillée ISO et standard de fait. D’abord, parce que les consortia peuvent contribuer aux travaux de l’ISO ; ensuite, parce que des proximités d’usage peuvent impliquer des liens entre communautés – comme en témoignent les identifiants ORCID et ISNI, qui, bien que couvrant des périmètres différents, communiquent entre eux ; enfin, parce qu’une volonté de pérennité peut conduire un consortium fondateur à faire évoluer un standard en norme, comme ce fut le cas par exemple pour le Dublin Core.
L’adoption d’une norme ou d’un standard par une communauté professionnelle implique, avant tout, comme la mise en adéquation entre une réponse d’usage à un besoin exprimé. Or, le fait que la norme soit d’application volontaire n’est pas anodin dans ce choix.
L’absence de portée réglementaire engendre en effet certains effets négatifs : normes et standards échappent aux exigences d’ouverture et de transparence imposées aux lois françaises ou européennes ; leur accessibilité, soumise au droit de la propriété intellectuelle, relève de la politique ou du modèle économique de l’organisme porteur, ce qui en complique l’appropriation, surtout lorsqu’ils sont payants. Opposer la fermeture des normes à l’ouverture des standards serait toutefois réducteur : le paysage s’avère plus nuancé, des solutions alternatives comme les SMART Standards (cf. https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php ?id =4360) constituent à ce titre une piste prometteuse.
Crédit photo Adobe Stock - sanchopancho
Construire l’avenir : quelle place pour les communautés professionnelles ?
A contrario, l’effet bénéfique de la norme posée comme d’application volontaire réside dans le fait que chaque communauté professionnelle a la faculté de s’emparer – ou non d’ailleurs - de la norme ou du standard qu’il estime le plus favorable à ses usages, selon les critères qui sont les siens, selon le rapport coût/bénéfice qu’il estime le meilleur. C’est ainsi que la communauté de la recherche – et c’est un choix porté par le ministère de l’Enseignement supérieur et le Comité pour la science ouverte (COSO) dont nos bibliothèques sont les premiers relais - s’est orientée vers l’identifiant ORCID, défini par et pour les chercheurs en lien avec les grands éditeurs scientifiques, plutôt que vers l’ISNI, identifiant pérenne porté par l’ISO, plus orienté pour la gestion des droits d’auteur dans l’édition tout public. C’est également dans le cadre de cette libre adoption du standard le plus adapté à l’environnement de travail que doit se poser le débat entre les deux formats que sont UNIMARC et BIBFRAME, un débat qui gagnerait à être dépassé dans une stratégie des missions et des usages.
En tout cas, si on applique une norme ou un standard pour leur adéquation à l’usage qu’on veut en faire, ceux-ci ne valent en retour que par leur utilisation, leur réponse pertinente à un besoin actuel et la qualité de leur maintenance. La norme, de fait, reste le meilleur levier pour favoriser le partage, garantir la protection des acteurs et accéder à l’innovation. D’où l’importance pour la communauté de s’investir dans son élaboration : pour être efficient, le consensus doit se nourrir des différentes opinions et expressions de besoins, qu’il s’agisse des choix de mise en œuvre ou de la réflexion sur sa validité. Quel que soit le périmètre d’action ou la gouvernance de la norme ou du standard, il nous revient d’en être les acteurs, d’où l’importance des experts, connaisseurs de leur communauté et représentants de leur structure, publique ou privée, ou de leur association professionnelle.
Ce dossier d’Arabesques révèle les contours bien particuliers d’une mobilisation d’expertises adaptée aux objectifs que nous venons de retracer à grands traits. Normaliser, c’est s’astreindre à une exigence collective de dialogue et d’investissement sur la durée où stratégie et coordination sont garantes d’une vision servie par la complémentarité des regards sur le temps long. Établir et faire vivre des standards revient à faire œuvre de bâtisseur et de rénovateur perpétuel. L’expertise et la pratique s’apprécient à l’échelle collective dans un effort pensé et soutenu.
Un panorama foisonnant donc, ponctué de choix d’usages et de trajectoires collectives qu’en tant que bibliothécaires et spécialistes de l’information scientifique, nous avons la responsabilité de porter, et dont nous espérons que ce dossier d’Arabesques atténuera la complexité pour en illustrer la richesse et en montrer les enjeux stratégiques.