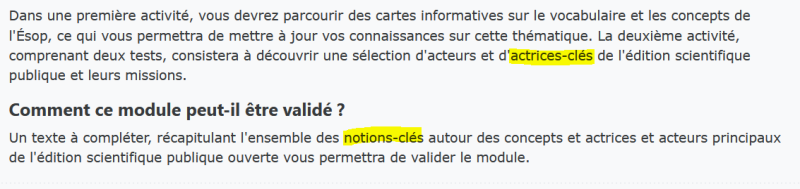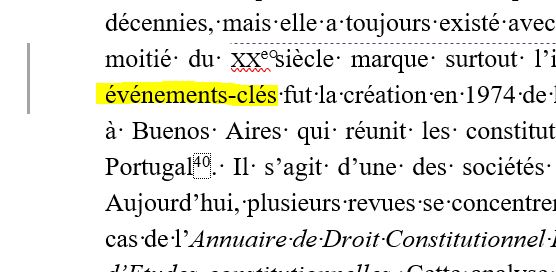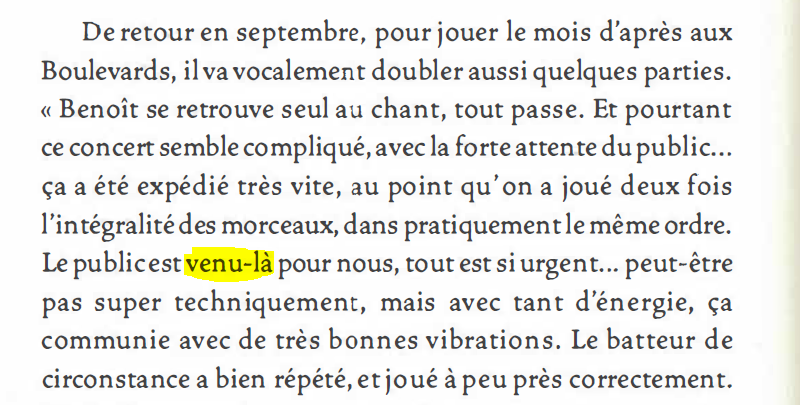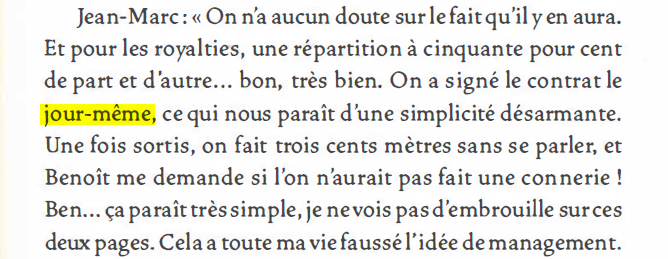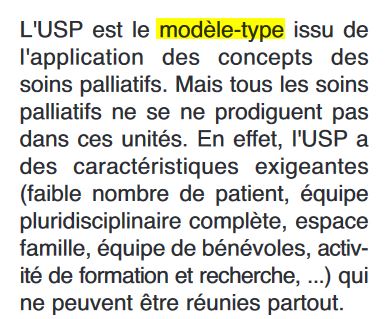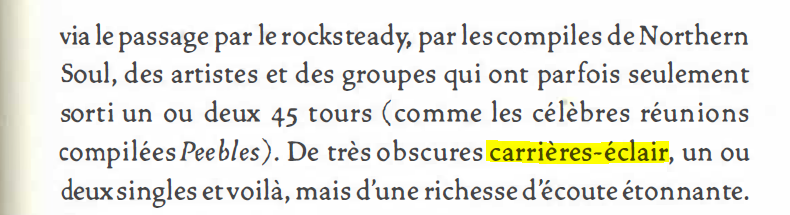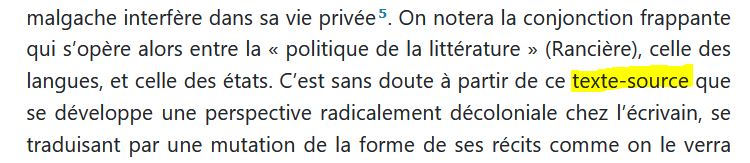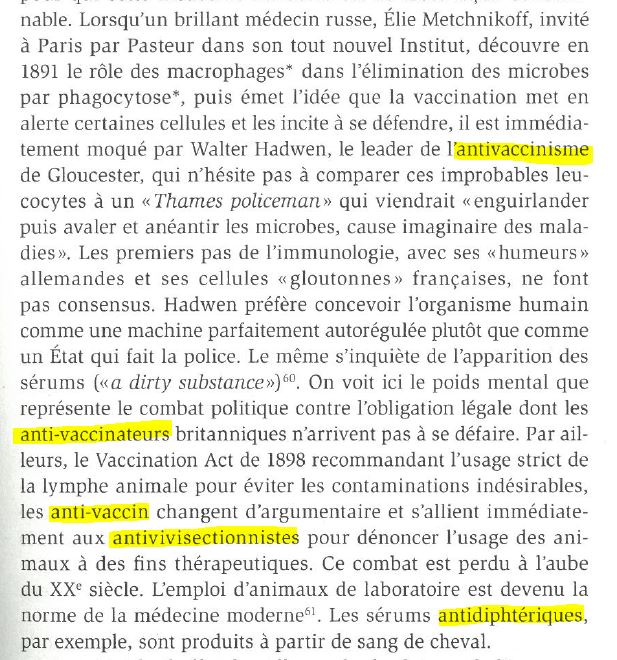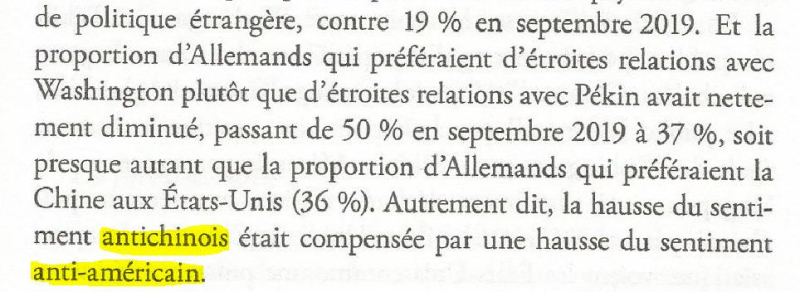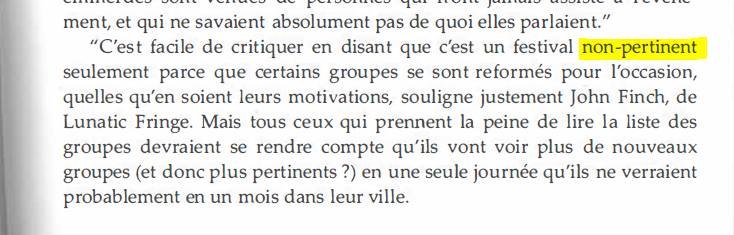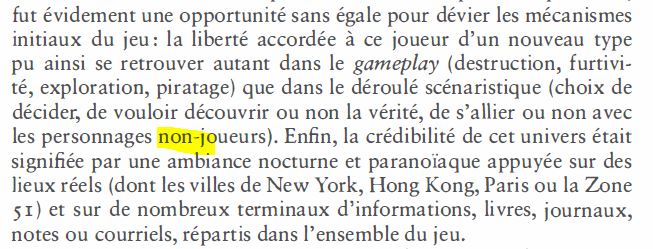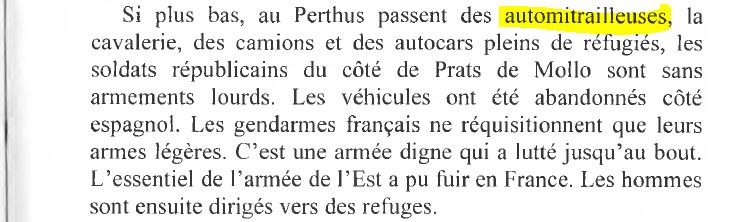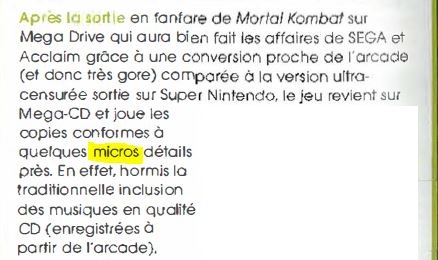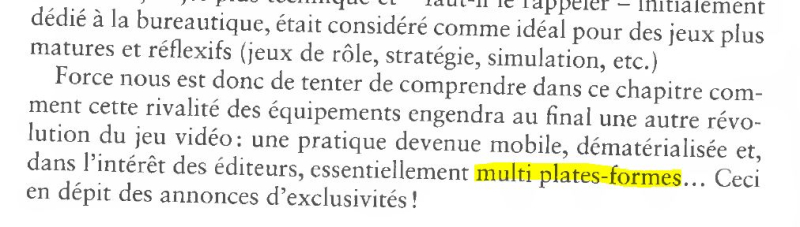Suffixe
Cas nº 1 : -clé
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Les manuels français hésitent quant à l’usage du trait d’union à apposer à clé. En général, ils adoptent une posture prudente autorisant l’emploi comme le non-emploi du trait d’union (voir Ramat ou Morell par exemple). Le Larousse, lui, est plus catégorique imposant une composition sans trait d’union. Toutefois, on s’abstiendra de chercher une justification dans l’un comme dans les autres. Le Grevisse est un peu plus assuré lorsqu’il affirme que lorsque le nom « est suivi d’une apposition non figée, le trait d’union n’est pas utile » mais ne peut que constater que « le trait d’union est loin d’être rare dans l’usage ». C’est au Canada que nous pouvons trouver un argumentaire permettant d’assurer une règle solide. Les composés avec clé ne sont pas lexicalisés car chacun des deux termes garde sa signification propre, clé n’ayant que la fonction d’attirer l’attention sur le substantif qui le précède. Un témoin clé dans une affaire criminelle reste d’abord un témoin, de première importance ensuite. Les deux termes conservent chacun leur sens indépendamment l’un l’autre. Pour être certain de n’être pas dans un cas de lexicalisation (comme c’est le cas dans porte-clefs), on peut ajouter un adjectif, par exemple un témoin oculaire clé (ou des évènements dramatiques clés dans l’exemple ci-dessus).
Commentaire : Un usage s’est largement répandu, de forge d’un véritable mot composé (mot-clé) qui, par imitation, est venu imposer un trait d’union à toutes sortes d’apposition avec clé comme dans les cas exposés ci-dessus. Pourtant un « mot-clé » n’est rien d’autre qu’un mot de première importance, le syntagme mot-clé n’ayant par conséquent pas de sens différent de celui de chacun de ses éléments pris isolément, il est par conséquent bien plus logique de composer mot clé sans trait d’union.
Sources : Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2016, p. 118.
Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 87.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 267.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 137.
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/21692/la-grammaire/le-nom/nombre-des-noms-dans-certains-emplois/nom-complement-dun-autre-nom/accord-de-cle-en-fonction-de-complement-du-nom
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/juridictionnaire/cle-clef.html
Cas nº 2 : -là
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : La règle de l’emploi du trait d’union devant là est complexe. Elle impose le trait d’union dans le cas où là est précédé d’un pronom démonstratif ou d’un nom lui-même précédé d’un pronom démonstratif : celle-là, cet homme-là. Ce trait d’union disparaît toutefois lorsqu’un complément vient s’intercaler entre ces éléments : cet homme âgé là (là ne se rapporte pas à âgé mais à homme). En tout état de cause, cette règle ne s’applique que lorsque là est précédé d’un pronom démonstratif et non d’un verbe comme dans le cas ci-dessus.
Sources : Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2016, p. 121.
Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 231.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 327.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 123.
https://www.sophieviguiercorrectrice.com/pages/mes-orthotrucs/grammaire/le-trait-d-union-de-la.html
Cas nº 3 : -même
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Même n’est lié avec un trait d’union que s’il est précédé d’un pronom personnel, et il est variable dans ce cas : moi-même, elles-mêmes. La composition correcte est ici : « On a signé le contrat le jour même ».
Sources : Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2016, p. 121.
Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 257.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 342.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 124.
Cas nº 4 : -type
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Type, lorsqu’il prend le sens de modèle, ne se lie pas avec un trait d’union. On écrit en conséquence, des contrats types, des formulaires types, un intellectuel type. Morell, tout comme l’Office québécois de la langue française, propose comme exception écart-type mais cette dernière est toutefois rejetée par le Robert.
Certains mots composés avec type sont lexicalisés comme prototype, archétype, stéréotype, logotype. De la même manière, on composera idéaltype, forme compatible avec l’absence de principe de trait d’union et conforme à la forge du mot idealtypus. Max Weber est celui qui l’a véritablement exposé sur la place publique en 1904 dans l’article « Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis ». Son traducteur français, Julien Freund, a d’ailleurs justement composé idéaltype, forme qui autorise la forme adjectivale idéaltypique sur le modèle des adjectifs archétypique ou prototypique.
Sources : Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 417.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 436.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 138.
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/21693/la-grammaire/le-nom/nombre-des-noms-dans-certains-emplois/nom-complement-dun-autre-nom/accord-en-nombre-du-complement-du-nom-type
Cas nº 5 : -éclair
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Éclair, lorsqu’il est apposé à un nom est synonyme de « rapide et bref » (comme l’éclair). C’est dire que ni le nom auquel il est apposé ni lui-même ne voient leur sens être modifié par l’apposition. En l’absence de lexicalisation, le Ramat impose donc très logiquement une composition sans trait d’union.
Sources : Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 137.
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/24531/la-grammaire/le-nom/nombre-des-noms-dans-certains-emplois/nom-complement-dun-autre-nom/accord-en-nombre-du-complement-du-nom-eclair
Cas nº 6 : -source
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Le mot source, lorsqu’il est placé en apposition ne se lie pas avec le terme qui le précède. Par conséquent, on compose sans trait d’union : code source, langue source ou encore texte source.
Commentaire : Le texte source se comporte différemment du roman-fleuve.
Source : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9S2303
Préfixe
Cas nº 1 : anti-
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Pourquoi antivaccinisme serait-t-il soudé lorsque anti-vaccinateurs et anti-vaccins ne le sont pas ? Du second exemple, nous pouvons au moins dégager une logique, l’élément auquel anti est lié débutant dans un cas par une consonne (chinois) et une voyelle (américain) dans l’autre. Selon les sources consultées, la règle peut fluctuer et l’un des éléments à l’origine de ce flottement est justement la présence de voyelles au début d’un mot. Toutefois, la succession i-a ne cause pas de difficulté de prononciation contrairement à son inverse a-i qui induirait un digramme prononcé [ɛ]. Rien n’interdisait de parler à l’identique des sentiments antichinois et antiaméricains.
Sources : Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 31.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 184.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 132.
Cas nº 2 : non-
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Pour former un substantif, non est joint par un trait d’union ; en position adjectivale, il ne l’est pas. « Le festival non pertinent » peut ainsi être réécrit « la non-pertinence du festival » et « les personnages non joueurs » plus simplement « les non-joueurs ».
Sources : Maurice Grevisse et André Goosse, Le bon usage, Louvain-la-Neuve, De Boeck supérieur, 2016, p. 118.
Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 278.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 353.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 133.
Cas nº 3 : auto-
Quelle est la règle : La plupart des sources s’accordent pour souder les éléments forgés avec auto, les hésitations n’ayant pour but que d’éviter les prononciations fautives. Par exemple, o-i [wa] si nous agglutinions autoimmunité ou o-u [u]. Thomas regrette la non-distinction entre auto, préfixe et auto, abréviation d’automobile. La composition la plus correcte selon cet auteur devant être autos-mitrailleuses. Si l’on suivait cette logique étymologique, nous devrions composer auto-route. On préférera donc une soudure dans tous les cas où une difficulté de prononciation n’est pas à redouter.
Sources : Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 45.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 251.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 132.
Cas nº 4 : micro-
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Comme pour le préfixe précédent, les mots composés avec micro sont soudés sauf en cas de risque de prononciation défectueuse. Par exemple, o-u [u] si nous agglutinions microunivers au lieu de micro-univers (le terme est issu de la linguistique) ou o-i [wa] si nous agglutinions microimpression au lieu de micro-impression. Certains, comme Thomas ou Morell, étendent la règle du trait d’union également à la rencontre de deux o comme dans micro-ordinateur, ce qui ne semble nullement nécessaire tandis que la réforme orthographique de 1990 promeut désormais microonde.
Le pluriel employé par le joueur ci-dessus ne peut qu’induire en erreur, les préfixes sont évidemment invariables. Les micros, au pluriel, ne peuvent donc être que des microphones, ce que le sens de la phrase dément. Il aurait été correct de composer : « à quelques microdétails prés » encore que le mot puisse être jugé pléonastique.
Sources : Adolphe V. Thomas et Michel de Toro, Dictionnaire des difficultés de la langue française, Paris, Larousse, 2001, p. 259.
Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 344.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 133.
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/21013/lorthographe/emploi-du-trait-dunion/mots-composes/mots-composes-avec-prefixe-ou-element-grec-ou-latin/trait-dunion-ou-soudure-avec-lelement-micro8209
Cas nº 5 : multi-
Quelle est la règle et pourquoi il y a une erreur ici : Les sources s’accordent pour souder les éléments formés à l’aide de multi, aucune difficulté de prononciation n’étant à craindre. L’Office québécois de la langue française penche néanmoins pour un trait d’union devant un i. Selon l’Office, il conviendrait de composer multi-instrumentiste alors qu’aucune source française ne semble refuser par principe multiinstrumentiste. C’est également l’avis des linguistes d’Antidote qui l’écrivent ainsi. Parmi les rares exceptions à cette règle générale, les mots composés avec un mot lui-même déjà composé. En ce cas et quelque soit le préfixe, la soudure devient impossible. C’est ainsi que l’on compose mini-sous-marin et c’est donc de la même manière qu’il convient d’écrire multi-plates-formes.
Sources : Georges Morell, Autour des mots. Le plus court chemin entre la typographie et vous, Paris, Direction des journaux officiels, 2005, p. 348.
Aurel Ramat et Romain Muller, Le Ramat européen de la typographie, Dijon, De Champlain, 2009, p. 133.
https://www.antidote.info/fr/blogue/enquetes/questions-multiples-sur-multi
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/21533/lorthographe/emploi-du-trait-dunion/mots-composes/mots-composes-avec-prefixe-ou-element-grec-ou-latin/trait-dunion-ou-soudure-avec-lelement-multi8209