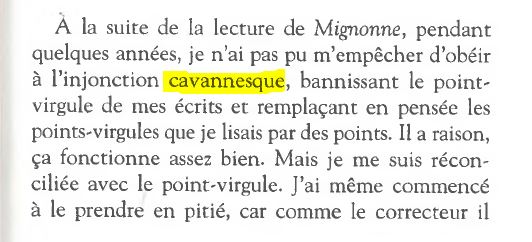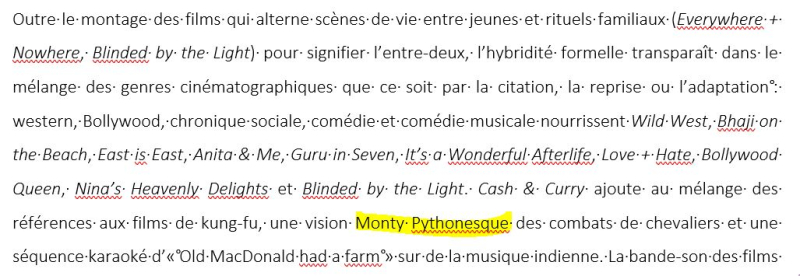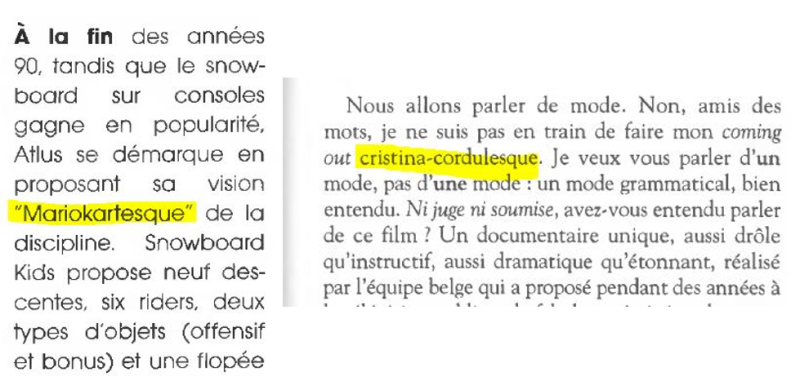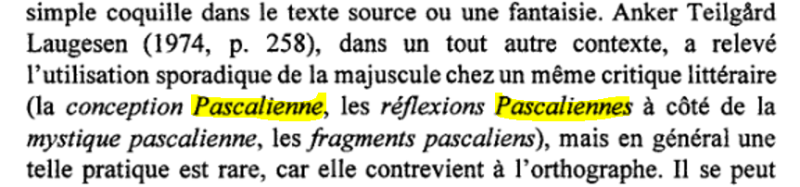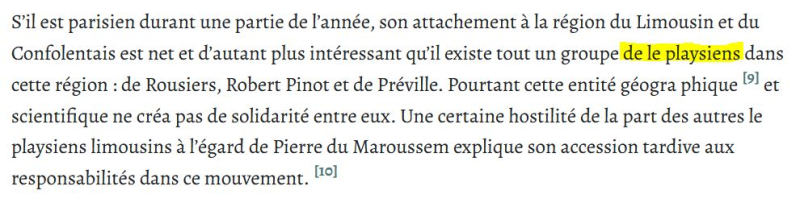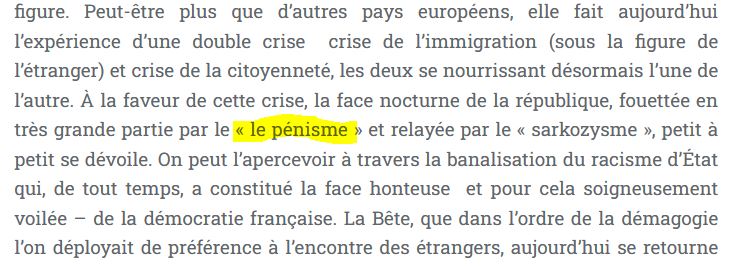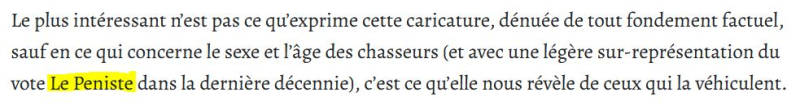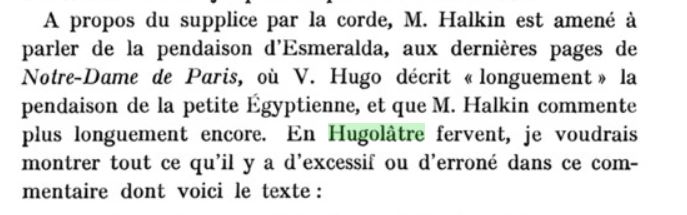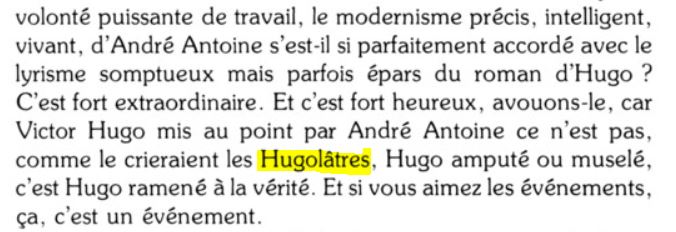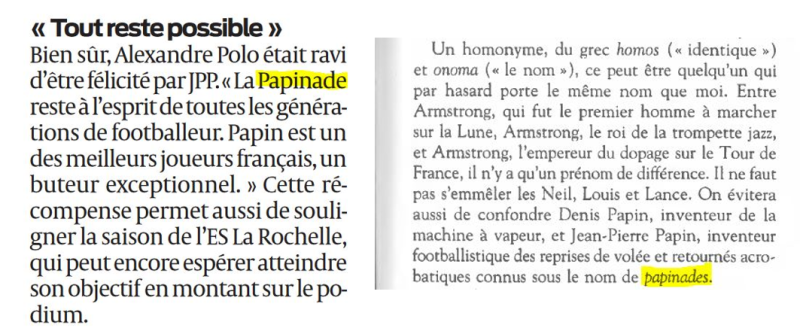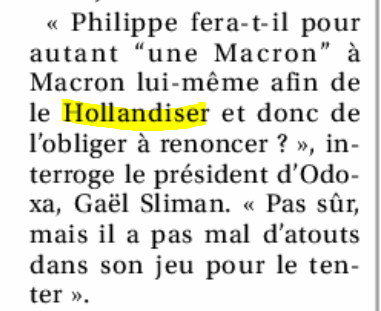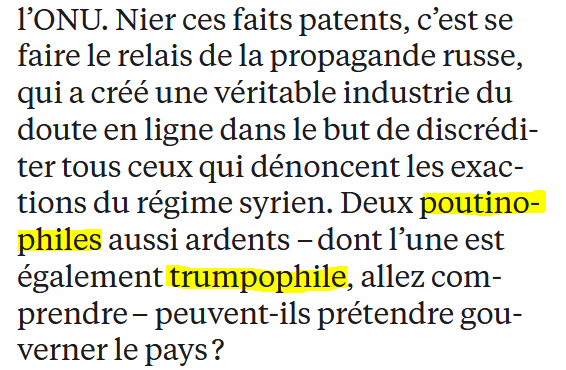Les cas relevés ci-dessous l’ont été soit dans des textes effectivement publiés tels quels, soit dans des tapuscrits avant travail de correction.
Un onomastisme est un mot forgé à partir d’un nom propre. Un gentilé est un onomastisme, mais nous allons nous pencher dans cette fiche sur une autre catégorie : des créations à partir de noms de personne.
Cas nº 1 : -esque
Le Trésor de la langue française informatisé nous apprend que le suffixe -esque exprime « une ressemblance, une manière d’être ou d’agir dont on accuse l’originalité dans un sens plus ou moins péjoratif ou laudatif ». Lorsque le radical désigne une personnalité, l’adjonction de ce suffixe signifie « à la manière de » ou « dans le style de ». Parmi les nombreux exemples fournis, il en est certains qui sont devenus si courants qu’ils ont intégré les dictionnaires depuis longtemps et dont le souvenir qu’ils sont issus de noms propres peut s’être estompé. Ainsi de rocambolesque, d’ubuesque et de dantesque, dérivés respectivement des créations de Ponson du Terrail et de Jarry, et, pour le dernier, du nom du poète florentin Dante Alighieri.
Comme ils sont issus d’un nom propre, la tentation est grande d’adjoindre une majuscule à ces termes. On s’en gardera bien, à l’exemple d’autres anthroponymes que nul n’écrirait autrement qu’en minuscule comme la pasteurisation, le saxophone ou la montgolfière. On trouve donc, sous la plume d’une correctrice de presse, un impeccable cavannesque.
Moins évidente est la suffixation en -esque de, non pas un mot, mais deux, comme l’attestent les trois exemples ci-dessous.
Trois exemples et trois manières de composer différentes : en majuscules et avec espace, en majuscule mais avec soudure et guillemets, en minuscules et avec trait d’union.
Le Trésor de la langue présente quelques constructions sur le même modèle et tirées de la littérature : donquichottesque, donjuanesque ou encore louisquatorzesque. Les dictionnaires Larousse et Robert ont déjà, quant à eux, admis l’adjectif donjuanesque. Ainsi, pour évoquer la vision des combats de chevaliers à la manière des Monty Python, on composera une vision montypythonesque et on louera cette simulation de snowboard mariokartesque.
Si la conservation du prénom des personnalités n’est pas la norme dans la forge de tels néologismes, le Trésor en présente toutefois quelques rares exemples : julesvernesque et sherlockholmesque. La composition sans trait d’union est préférable et notre troisième exemple ci-dessus admet la composition cristinacordulesque.
Cas nº 2 : -ien
D’après Monique Cormier et Jean Fontaine, « le formant -ien est le plus fréquent dans la dérivation à partir de noms propres […] ce formant est privilégié lorsqu’il s’agit de dériver d’un nom de personne un adjectif de connotation neutre, indiquant une simple relation avec la personne (kantien, balzacien, beethovénien)1 ». Le Trésor de la langue française informatisé renchérit lorsqu’il précise que les adjectifs ainsi formés ont le sens de « relatif à, qui a rapport à, qui tient de » et qu’employés comme substantifs ils prennent le sens de « adepte de, spécialiste de ». Les dictionnaires abondent d’exemples de ce type : aristotélicien, euclidien, cartésien, rabelaisien, cornélien. Tous ces mots débutent par une minuscule et c’est aussi la composition correcte dans l’exemple ci-dessous : la conception pascalienne, les réflexions pascaliennes.
La dérivation peut nécessiter des modifications importantes du radical, Giraudoux donnant giralducien, Foucault donnant foucaldien, Rimbaud donnant rimbaldien, Hugo donnant hugolien (ajout d’une lettre), Barrès donnant barrésien (modification de l’accentuation).
Qu’advient-il dans le cas de noms en plusieurs parties ? Les dictionnaires connaissent déjà les saint-simoniens, adeptes des théories économiques du comte de Saint-Simon. Le nom propre comportant un trait d’union, celui-ci est conservé dans le cas de la dérivation. De la même manière, on pourrait penser que l’espace présente dans le nom de Frédéric Le Play doit être conservée. Les dictionnaires connaissent déjà la politique gaullienne, la particule tombant purement et simplement. Qu’en est-il de l’article chez Le Play ? Les fréquences d’apparition, mesurables grâce à Gallicagram, permettent de dégager une tendance claire : playsien et le playsien sont très rares et en perte de vitesse, l’agglutination leplaysien prenant très nettement le dessus. Dans notre exemple, il aurait été préférable de composer un groupe de leplaysiens.
Cas nº 3 : -iste ou -isme
Le Trésor de la langue française informatisé distingue le sens des suffixes -ien et iste : « -iste accolé à un nom propre indique l’adhésion, l’appartenance à une doctrine, à une pensée élaborée par une personne dont le nom fournit la base du dérivé ; -ien indique ce qui est propre à un homme, ce qui lui appartient ». « Historiquement, continue le Trésor, -ien a tenu le rôle de -iste » et les deux suffixes sont encore parfois utilisés l’un pour l’autre : des militants gaullistes et giscardiens.
Les dictionnaires fournissent là encore de nombreux exemples, du fouriériste au gaulliste en passant par le boulangisme, ou du cartésianisme au plus inattendu rousseauiste comme ci-dessous.
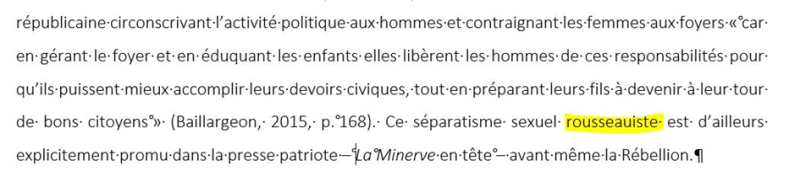 Comme dans l’exemple leplaysien entrevu ci-dessus, l’application des principes de lexicalisation est souhaitable. Suppression des guillemets, soudure, minuscule à l’initiale et accentuation offrent deux dérivés à Le Pen : lepéniste et lepénisme. L’accentuation est parfaitement conforme aux exemples déjà admis par les dictionnaires tels que machiavélisme, hitlérisme et fouriérisme, les noms propres dont ils dérivent n’étant, eux, pas accentués.
Comme dans l’exemple leplaysien entrevu ci-dessus, l’application des principes de lexicalisation est souhaitable. Suppression des guillemets, soudure, minuscule à l’initiale et accentuation offrent deux dérivés à Le Pen : lepéniste et lepénisme. L’accentuation est parfaitement conforme aux exemples déjà admis par les dictionnaires tels que machiavélisme, hitlérisme et fouriérisme, les noms propres dont ils dérivent n’étant, eux, pas accentués.
Cas nº 4 : -âtre
Le suffixe -âtre exprime « l’atténuation, et, corrélativement, l’approximation et la dépréciation », nous dit le Trésor de la langue française informatisé. Si les mots forgés avec ce suffixe sont nombreux (douceâtre, bellâtre, noirâtre, etc.), ceux dérivés d’un nom propre le sont beaucoup moins. Le Trésor nous livre néanmoins l’exemple hugolâtre dont la définition est « admirateur fanatique, inconsidéré de Victor Hugo, de son œuvre ». Le suffixe étant dépréciatif, les dérivés forgés sont péjoratifs, comme le signale le Trésor à propos d’hugolâtre. Dans les deux cas ci-dessous, la lexicalisation fait perdre la majuscule et ces hugolâtres se composent tout en minuscules.
Cas nº 5 : -ade
D’après le Trésor de la langue française informatisé, ce suffixe est « formateur de substantifs féminins exprimant l’idée d’action, de résultat d’une action ». S’il a servi à forger énormément de termes, peu sont issus d’un nom propre : la lapalissade, la tartarinade mais aussi ces créations issues de personnages de théâtre, la pantalonnade et la turlupinade.
Les exemples ci-dessous présentent un cas beaucoup plus moderne, le premier étant l’œuvre d’un journaliste sportif et le second d’une correctrice de presse qui l’a parfaitement lexicalisé en lui ôtant la majuscule et en lui donnant la marque du pluriel.
Cas nº 6 : -iser
Le Trésor de la langue française informatisé distingue deux sens différents des verbes dérivés d’un nom propre forgés avec le suffixe -iser, auxquels correspondent deux constructions grammaticales Employé transitivement, il signifie « faire à la manière de, traiter selon la méthode de », par exemple pasteuriser ses aliments. Employé intransitivement, il signifie « se comporter (et en particulier écrire, penser) comme ». Dans le poème Projet en l’air, Verlaine donne deux exemples d’emploi intransitif : « Je me souviens que j’aimais / À jamais / (Pensais-je à seize ans) la Gloire, / À Thèbes pindariser, / Puis oser / Ronsardiser sur la Loire ».
Les dictionnaires connaissent déjà quelques verbes en -iser dérivés de noms propres, tayloriser ou nobéliser en sont deux exemples. Le verbe hollandiser risque fort pour sa part de ne jamais intégrer nos usuels car sa naissance n’est dû qu’à une actualité, mouvante par essence.
S’agissant de verbes, les créateurs de néologismes semblent plus enclins à leur appliquer les attributs de la lexicalisation : ils les accordent avec leur sujet et leur font perdre la majuscule, le cas ci-dessous faisant exception.
Cas nº 7 : -phile et -phobe
Les dérivations en -phile/-philie ou en -phobe/-phobie sont courantes en français. Dans la majorité des cas, le radical se dote d’un o précédent le suffixe même lorsque ce radical n’en contient pas. Par exemple, claustrophobie tiré du verbe claustrer et qui donne aussi claustration ou haltérophile qui dérive du nom haltère. Le Trésor de la langue française informatisé note « la grande vitalité » de l’élément -phile et livre comme exemple hugophile. Quoique dérivés d’un nom propre, hugophile comme hugophobe sont des noms communs s’écrivant en minuscules.
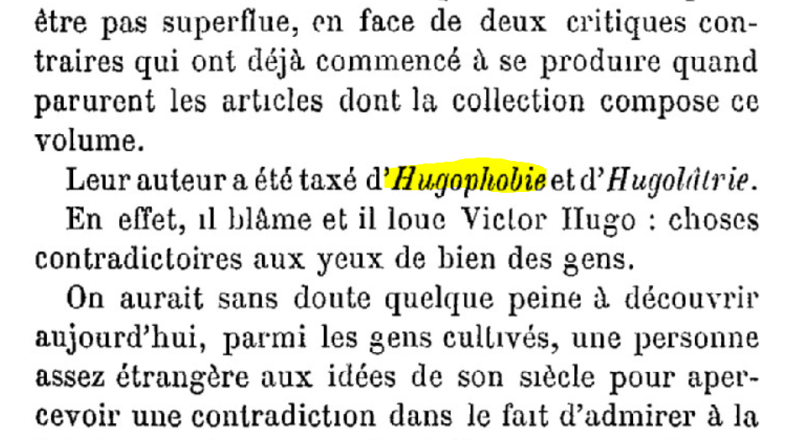 Si le nom de Victor Hugo se prête particulièrement bien à ces dérivations, c’est que sa dernière lettre est ce o fréquemment ajouté pour des raisons d’euphonie. Il existe néanmoins quelques contre-exemples comme agoraphobe, cinéphile ou transphobe. Mais s’agissant de noms propres, une finale en o est plutôt rare et les créateurs de néologismes rajoutent fréquemment cette voyelle comme dans l’exemple qui suit.
Si le nom de Victor Hugo se prête particulièrement bien à ces dérivations, c’est que sa dernière lettre est ce o fréquemment ajouté pour des raisons d’euphonie. Il existe néanmoins quelques contre-exemples comme agoraphobe, cinéphile ou transphobe. Mais s’agissant de noms propres, une finale en o est plutôt rare et les créateurs de néologismes rajoutent fréquemment cette voyelle comme dans l’exemple qui suit.
Conclusion
Pour finir, récapitulons quelques principes entrevus : la lexicalisation conduit à la soudure (montypythonesque), à la minusculisation, à l’accord avec le pluriel (papinades et hugolâtres), à l’accentuation (lepéniste, nobéliser) et à la modification euphonique du radical (trumpophile) si besoin.