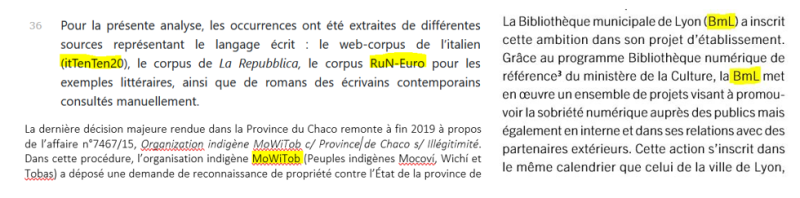Ces trois extraits d’articles scientifiques ont un point commun : ils utilisent une casse mixte, dite aussi casse chameau – la succession de minuscules et de lettres capitales à l’intérieur des mots évoquant les bosses des camélidés.
La page Wikipedia consacré au procédé signale un emploi courant dans les langages de programmation informatique dans lesquels les espaces sont proscrites et une récupération par les spécialistes de la mercatique afin de créer des noms de marques.
Le Bon Usage de Maurice Grevisse et André Goosse remarque que « selon la tradition française, c’est une anomalie de placer une majuscule à l’intérieur d’un mot. Cela se trouve pourtant » (p. 92). Puis les auteurs de lister quelques cas :
-
Dans des marques déposées : CinémaScope, PetroFina « mais cette façon d’écrire est heureusement peu suivie […] Plus répandu, l’iPhone » (p. 92) ;
-
Certains symboles d’unités : kW, le symbole du kilowatt ;
-
Dans les noms de famille écossais ou irlandais commençant par mac (« fils ») et les noms anglais commençant par fitz (« fils ») ;
-
Dans les noms de famille flamands du type t’Serstevens.
Prenons chacun des cas évoqués ci-dessus pour examiner la pertinence de ces majuscules dérogatoires aux règles de l’orthographe française.
Noms de famille flamands
Écartons rapidement le quatrième cas puisque le code typographique de l’Imprimerie nationale et Jean-Pierre Lacroux s’accordent tous les deux pour attribuer la majuscule à la particule flamande T’. Il convient donc de composer T’Serstevens.
Noms de famille anglo-saxons
Restons dans les noms de famille pour régler le cas de certains patronymes anglo-saxons. Notons tout d’abord que cette casse a tendance à s’exporter hors des « fils de » évoqués par Le Bon Usage. Ainsi des patronymes de l’écrivaine québécoise Monique LaRue, de l’ancien coureur cycliste Greg LeMond, de l’artiste Solomon LeWitt ou du cinéaste Cécil B. DeMille. Les dictionnaires sont hésitants quant au sort à faire à ces graphies : Le Grand Larousse illustré de 2016 compose Cecil B. De Mille avec une espace et propose, au choix, Solomon LeWitt ou Lewitt, quand de son côté, Le Petit Robert des noms propres de 2013 compose Cecil B. DeMille et Solomon Lewitt. Jean-Pierre Lacroux s’agace de ces graphies et persifle : « Chez nous, Greg LeMond deVient Lemond, comme Cecil B. DeMille est deVenu Demille (TiRobert) ou… De Mille (LaRousse, colors by DiLeuxe…)[…] AmiCaleMent, JeanPierre LaCroux ». Dictionnaires hésitants, typographe hostile, anomalie en orthographe française, la conclusion s’impose d’elle-même : Monique Larue, Greg Lemond, Solomon Lewitt et Cécil B. De Mille.
Pour les « fils de » Gerald, les dictionnaires et encyclopédies consultés ne proposent qu’une graphie, sans casse chameau : Fitzgerald. C’est elle que nous retiendrons aussi.
Le cas est beaucoup plus complexe pour les fils d’origine écossaise ou irlandaise. Le Grand Larousse illustré propose Harold Macmillan (Premier ministre britannique) et Kenneth MacMillan (danseur britannique), James Ramsay MacDonald (Premier ministre britannique), John Alexander Macdonald (homme politique canadien) et Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre Macdonald (maréchal napoléonien). Le Petit Robert des noms propres, s’il ne mentionne pas le danseur britannique, est en accord avec son concurrent sur les autres.
On cherche en vain une règle de composition de ces noms. Lacroux se borne à signaler le principe guidant leur classement dans un dictionnaire ou un index (tous doivent être classés comme s’ils s’écrivaient Mac, y compris les noms écrits Mc : MacDonald, McEnroe, MacLaren). De ce fait, il semble accréditer les capitales internes. Aurel Ramat nous aide un peu en affirmant que « l’important est de respecter la façon adoptée par chaque famille (Macintosh, MacIntosh, Mcintosh, McIntosh) » (p. 104), toutefois la page wiki consacrée à la particule précise qu’« il n'existe ni règle officielle ni convention concernant l'orthographe ». Elle ajoute que, contrairement à la préconisation de Ramat, le nom du maréchal Macdonald « a été retranscrit dans l'état civil français […] sans majuscule intérieure pour respecter l'usage français ». Il semblerait donc possible de composer avec la seule majuscule initiale l’ensemble de ces noms mais même les typographes les plus sourcilleux n’osent le recommander. Le recours aux dictionnaires s’impose par conséquent pour chaque cas rencontré.
Unités de mesure
Certaines unités de mesure, dont les abréviations sont conventionnelles, se composent avec des capitales inhabituellement placées. Ainsi du décibel dB ou de l’électronvolt eV. Des conventions existant en outre pour les multiples ou sous-multiples (M signifiant méga et m milli), certaines compositions prennent l’aspect de montagnes russes. Par exemple, le kilohertz kHz, le kilowattheure kWh, le kilopascal kPa ou le milliampère mA.
Lacroux reconnaît que « Les rares cas (à mon sens et à première vue) où les caps peuvent siéger dans des endroits étranges sont les symboles du genre “eV” (électronvolt) »
Noms de marques
Les entreprises, nous l’avons dit plus haut, sont friandes de ces casses mixtes. Le cinémaScope date déjà des années 1950 mais ces graphies se sont depuis multipliées : iPhone, eBay, YouTube, InDesign, MasterCard, PayPal, PlayStation.
Dans l’immense majorité, ces noms n’ont pas intégré les dictionnaires. C’est seulement le cas du plus ancien de la liste ci-dessus. Le Nouveau Petit Robert de 2003 propose cinémascope, mais Le Grand Larousse illustré, CinémaScope et le Dictionnaire d’orthographe d’André Jouette se place dans l’entre-deux avec son Cinémascope.
Sociétés commerciales
PayPal, eBay, MasterCard ou YouTube sont des sociétés commerciales. Tous les typographes consultés sont unanimes pour une composition en romain, l’emploi des capitales pouvant varier selon que la société est française ou non. Pour l’Imprimerie nationale, les sociétés françaises doivent être composées avec une capitale initiale au premier mot de la société en question, ainsi qu’aux articles et adjectifs antéposés (par exemple, la société toulousaine La Belle Liégeoise). Jean-Pierre Colignon est plus restrictif en la matière, n’imposant aux noms de sociétés commerciales et industrielles de majuscule qu’au premier mot de ces dénominations (entrée Majuscules ou minuscules). Pour les sociétés étrangères selon le code de l’Imprimerie nationale, à la capitale initiale, il convient d’en ajouter aux substantifs et aux adjectifs (par exemple, la Badische Anilin & Soda-Fabrik allemande). Il est en accord avec Ramat qui signale que « l’anglais utilise beaucoup plus les capitales que le français » et donne l’exemple de la société the Bell Telephone Company (p. 216). Dans tous les cas, la ou les majuscules ne se placent qu’à l’initiale des mots, et non à l’intérieur de ceux-ci, imposant de composer Paypal, Ebay, Mastercard ou Youtube.
Marques commerciales
iPhone ou InDesign sont des marques commerciales créées respectivement par les entreprises Apple et Adobe. Jean-Pierre Colignon les compose en romain non guillemeté et avec une majuscule initiale (entrée Marques commerciales). Cette recommandation est en accord avec celle du code typographique de l’Imprimerie nationale : « Un grand nombre de produits d'usage courant tirent leur nom d'une marque de fabrique, choisie par l'inventeur ou le fabricant et légalement déposée. Ce nom, qui reste invariable, sera composé en romain avec une capitale initiale » (p. 106). Lacroux (entrée Marque déposée) va lui aussi dans le même sens : « Les noms de marque se composent en romain. Ils prennent la majuscule et sont invariables ».
Ramat, tout en étant d’accord sur le principe (« Les produits […] qui portent des noms propres se composent en romain et prennent une capitale initiale. Ils restent invariables » – voir p. 139), croit devoir créer des exceptions, pour les noms des logiciels d’abord, et à l’usage exclusif des produits de la seule entreprise Apple ensuite ! « Les noms des logiciels et des polices s’écrivent en romain. Il faut respecter les capitales, même celles à l’intérieur d’un mot » affirme Ramat (p. 109). Et encore « Le préfixe i, qui s’adjoint à différents mots pour nommer un produit Apple, s’écrit en bas-de-casse et est suivi d’une capitale, sans espace. iPad iPod iPhone iTunes iBooks » (p. 120). Des règles typographiques patiemment élaborées et éprouvées doivent-elles s’effacer devant toutes les audaces graphiques des entreprises ? Et comment justifier d’exceptions pour la seule Apple et pas, par exemple, les créations du constructeur automobile Ford (modèle EcoSport, moteur EcoBoost) ? Comme Lacroux, qui affirme « j’écris “Xpress” et “Indesign” », nous composerons Iphone, Indesign et Playstation.
Organisations
La cOAlition S est un collectif international regroupant des organismes nationaux de financement de la recherche. Si ses membres ont souhaité rendre graphiquement leur engagement en faveur du libre accès à la science en majusculisant les initiales de l’expression anglaise open access présentes dans son intitulé, c’est là affaire de spécialistes de la communication. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun correcteur, d’aucune typographe, d’imposer aux gens de métier de la communication l’adoption des règles qui gouvernent l’édition. L’inverse doit également être vrai, imposant la composition Coalition S qui sied aux organismes internationaux.
Bibliothèques
L’un des exemples présentés en ouverture de cette fiche propose la composition BmL pour la bibliothèque municipale de Lyon, elle-même sans doute copiée de celle de la bibliothèque nationale de France (BnF). Ni l’une ni l’autre de ces compositions ne se justifient même si nous pouvons imaginer d’où elles procèdent. Sans doute aura-t-on voulu calquer une composition au long – tout aussi discutable – de Bibliothèque nationale de France et de Bibliothèque municipale de Lyon.
Discutable ? Voyons cela. Le code de l’Imprimerie nationale possède une entrée consacrée aux bibliothèques : « On mettra une majuscule au mot caractéristique, qui peut être un nom propre, un adjectif dérivé d'un nom propre, ou encore le mot Bibliothèque lui-même s'il est accompagné d'un adjectif non dérivé d'un nom propre » (p. 36). Selon cette logique, Lyon ainsi que France étant des noms propres, aucune majusculisation ne doit marquer le mot bibliothèque. La Bibliothèque nationale ne gagne une capitale que lorsqu’elle est suivie seulement d’un adjectif non dérivé d’un nom propre. C’est aussi l’opinion de Georges Morell (p. 255) et de Lacroux (entrée Musée, galerie, bibliothèque). À contrario, Colignon (entrée Bibliothèque) accorde une majuscule aux bibliothèques nationales par souci de cohérence avec la règle admise par tous que les organismes uniques dans un pays leur confèrent une valeur de nom propre et opte pour Bibliothèque nationale de France. Mais si cette dernière peut éventuellement être défendue, il n’en est pas de même de la bibliothèque municipale de Lyon que l’on doit composer en minuscules.
Mais revenons-en à nos sigles. Quelle que soit la graphie au long de nos bibliothèques, nous sommes ici face à des sigles et ce sont les règles applicables à ceux-ci qui doivent s’appliquer. Pour notre bibliothèque municipale de Lyon comme pour notre bibliothèque nationale de France, une seule composition est admissible, le tout en capitales : BML et BNF.
Laboratoires de recherche
« L’épouvantable contagion “logotypique” » (p. 123 du tome II) contre laquelle peste Jean-Pierre Lacroux touche aussi la manière de composer les noms des laboratoires de recherche. Ainsi des graphies GRePS (Groupe de recherche en psychologie sociétale), CeReS (Centre de recherches sémiotiques) ou encore CeRAP (Centre de recherche sur l’Amérique préhispanique). Dans tous ces cas, il s’agit de rendre compte de sigles partiellement syllabiques, l’ensemble des e présents n’étant nullement l’initiale d’un mot mais la seconde lettre de recherche ou de centre.
Si ce principe de minusculisation des seules lettres non initiales était admis, il fallait composer AssEDIC (Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce), SIREt (Système d'identification du répertoire des établissements), UniMaRC (Universal Machine Readable Cataloguing), BeNeLux (Belgique, Nederland, Luxembourg) ou encore AFNor (Association française de normalisation).
Pour Lacroux, « ASSEDIC est tolérable (pas par moi…), mais Assedic (acronyme partiellement syllabique) est bien préférable » (p. 143 du tome i). La règle qu’il propose est la suivante : « les sigles (purs ou acronymiques) sont composés en grandes capitales (ce qui indique qu’ils sont formés d’initiales) […] Les acronymes syllabiques ou pseudosyllabiques, n’étant pas composés (exclusivement) d’initiales, ne prennent la capitale qu’à leur première lettre (Afnor) » (p. 142 du tome i).
Il est cependant en désaccord avec le code typographique de l’Imprimerie nationale qui ne distingue pas entre les sigles composés uniquement d’initiales et les sigles syllabiques (p. 159-160) et compose donc AFNOR. La composition proposée a contrario de Benelux ne découle que d’une exception forgée pour les « sigles très répandus et de prononciation aisée [qui] peuvent se composer en bas de casse avec capitale initiale ».
Les dictionnaires sont eux aussi hésitants, Le Grand Larousse illustré de 2016 compose AFNOR, Benelux et, au choix, ASSEDIC ou Assédic.
Pour revenir à nos laboratoires de recherche, si une composition avec majuscule unique à l’initiale est préférable au tout en capitale, on composera Greps, Ceres et Cerap. Dans tous les cas, la casse chameau est à bannir.
***
Constatons pour finir que ces organismes savent parfaitement adopter des règles autres que les leurs s’ils y ont intérêt. L’adresse du site internet de la cOAlition S est en effet : www.coalition-s.org, celle de PayPal : www.paypal.com, celle de YouTube : www.youtube.com, celle de la PlayStation : www.playstation.com, celle des sites français de eBay : www.ebay.fr et de MasterCard : www.mastercard.fr. Les capitales sont pourtant permises dans les URL comme l’établit la syntaxe RFC 3986 mais elles complexifient inutilement le travail des robots indexeurs. Et pendant longtemps a régné l’inquiétude à propos d’une influence négative des capitales sur le référencement Web par Google.